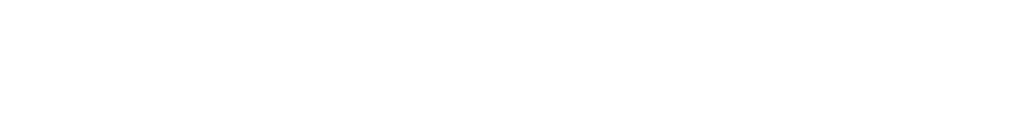L’enquête interne est une procédure quasi indispensable en matière de lutte contre le harcèlement. Que l’employeur soit à l’initiative ou que les élus la réclament, les modalités de l’enquête deviennent elles-mêmes sources de tensions : qui est entendu ? Dans quel ordre se font les auditions ? Quelles questions sont posées ? Qui rédige le rapport ? À qui le rapport est-il destiné… ?
Comment les représentants du personnel peuvent-ils s’emparer du sujet à froid ?
Quelques pistes de réflexion …
I. UN CADRE LÉGAL IMPRÉCIS …
1. Le CSE, la santé au travail et l’enquête
Le code du travail fait du CSE un acteur de la prévention des risques professionnels, tant en matière de santé physique que mentale. Notamment :
- La délégation du personnel a pour mission de contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise (L. 2312-5 c. trav.) ;
- Le CSE peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (L. 2312-9 3°)
- Il réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel (L. 2312-13 c. trav.).
Pour autant lorsque l’employeur a directement connaissance d’une situation problématique, les élus peuvent se trouver exclus d’une enquête qui peut alors être conduite exclusivement par l’employeur selon des modalités qu’il choisit.
En revanche, un élu peut imposer l’organisation d’une enquête conjointe avec un représentant de l’employeur en exerçant son droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, lequel vise spécifiquement les situations de harcèlement et de discrimination (L. 2312-59 c. trav). Mais là encore aucune méthodologie n’est imposée.
2. L’enquête conjointe : un cadre inexistant
Si la jurisprudence de la Cour de cassation admet la recevabilité de rapports d’enquêtes issus d’une méthodologie critiquable – laissant au juge du fond le soin d’en apprécier la valeur probante – il demeure qu’une enquête menée « à charge » ou s’appuyant sur des éléments tronqués peut affaiblir la position de l’employeur (Cass. soc., 9 février 2012, n°10-26.123, inédit ; Cass. soc., 18 juin 2025, n° 23-19.022), voire celle des élus.
Par ailleurs, une enquête « bâclée » alimente la défiance des salariés vis-à-vis de la Direction et dégrade le climat social.
II. … QUI PEUT ÊTRE AMÉLIORÉ
Comment, alors, mener une enquête « réussie » ?
L’ANI du 26 mars 2010 relatif au harcèlement et à la violence au travail et la décision-cadre du Défenseur des droits du 5 février 2025 ont précisé le cadre à respecter.
1. Les principes cardinaux de l’enquête : un cadre respectueux des droits fondamentaux
- Confidentialité (Recommandation n° 19 de la décision-cadre)
L’identité des personnes auditionnées et le contenu de leurs propos ne doivent être divulgués qu’aux personnes strictement habilitées (enquêteurs interne ou externe, juge en cas de contentieux).
L’ANI du 26 mars 2010 rappelle qu’aucune information non anonymisée ne doit être communiquée aux tiers.
Cette confidentialité est essentielle à la libération de la parole.
À notre sens, les comptes-rendus d’audition complets et nominatifs ne devraient être communiqués à la Direction (hors membres de la commission d’enquête) qu’en cas de contentieux prud’homal. L’obligation de confidentialité doit par conséquent être respectée par les représentants de l’employeur membres de la commission d’enquête.
- Impartialité (Recommandations n°20 à 23)
Les enquêteurs doivent pouvoir apprécier les faits avec distance et neutralité.
Ils ne doivent pas avoir de lien direct avec les protagonistes ni appartenir à un service impliqué, en ce compris les élus du CSE membres de la commission d’enquête.
La décision-cadre recommande, en cas de conflit d’intérêts potentiel, le recours à un prestataire externe disposant de compétences juridiques solides, et souligne que l’association du CSE constitue un gage supplémentaire d’impartialité.
Encore faut-il l’associer pleinement au processus, et non cantonné à un rôle de caution symbolique.
- Respect du contradictoire (Recommandation n°31)
Ce principe impose que la personne mise en cause soit informée de l’existence d’une enquête et puisse être entendue, produire des éléments et désigner des témoins, sauf circonstances particulières (agissements particulièrement graves, risques de pressions sur les victimes ou les témoins…).
L’absence de respect du contradictoire a été sanctionné par la jurisprudence (Cass. soc., 9 février 2012, n°10-26.123, précité).
2. Avant l’enquête : décider et préparer
- Évaluer la situation : enquêter ou non ?
Tout signalement ne justifie pas nécessairement une enquête formelle.
Après avoir invité l’auteur du signalement à fournir des éléments détaillés (article 4.2. de l’ANI du 26 mars 2010), une première analyse, partagée avec le CSE, permet d’évaluer si la situation relève d’un potentiel harcèlement, d’un conflit interpersonnel ou d’un dysfonctionnement de l’organisation.
Dans les deux derniers cas, des mesures alternatives (médiation, réorganisation, formation managériale) peuvent être privilégiées à une enquête, processus susceptible de générer des risques psychosociaux.
- Définir “à froid” un cadre général
La décision-cadre du Défenseur des droits (Recommandation n°15) invite les employeurs à formaliser, en amont de tout signalement, un processus clair d’enquête interne concerté avec le CSE.
Un document interne – charte, annexe au règlement intérieur ou accord collectif – négocié avec le CSE fixera les principes et le cadre méthodologique des futures enquêtes, en intégrant le CSE à chaque étape (méthodologie, rédaction du rapport, suivi…).
Ce cadre “à froid” garantit la célérité de la réaction de l’employeur en cas de signalement, tout en respectant les droits fondamentaux.
Il doit, selon nous, systématiser l’association du CSE à toute enquête harcèlement, hors droit d’alerte.
- Préparer la communication aux salariés concernés
Une fois l’enquête décidée, informer sobrement les personnes impliquées (auteur du signalement, témoins, et mis en cause) en rappelant l’objectif de l’enquête, à savoir, faire la lumière sur une situation, et en rappelant les garanties de neutralité, de confidentialité et la protection contre les représailles. Cette étape est primordiale pour rassurer les salariés et permettre la libération de la parole.
3. Pendant l’enquête : mise en œuvre des principes
Les auditions doivent être menées dans un climat de confiance et confidentiel (entretiens individuels, à huis clos, éventuellement à distance), par des enquêteurs formés, avec des questions neutres et ouvertes.
Les comptes rendus doivent être complets, relus et validés par les personnes entendues. Les enquêteurs analyseront également les éléments de preuve qui leur seront remis par les participants pour étayer les témoignages.
4. Après l’enquête : conclusions et suivi
Le rapport d’enquête doit synthétiser fidèlement l’ensemble des auditions, sans occultation sélective, et conclure sur l’existence ou non d’éléments laissant présumer un harcèlement et/ou une éventuelle faute (manquement à l’obligation de sécurité, exécution déloyale du contrat, …).
Au-delà de la qualification des faits, le rapport doit également formuler des préconisations de mesures individuelles et/ou collectives visant à améliorer la situation dénoncée : actions de prévention, formations, réorganisation, sensibilisation, médiation.
Au regard de ses prérogatives en santé-sécurité, le CSE devrait a minima avoir communication d’une synthèse anonymisée de l’enquête et de ses conclusions, et être associé au suivi des mesures individuelles et collectives préconisées, à l’exclusion des sanctions disciplinaires qui relèvent du seul pouvoir de direction de l’employeur.
En cas de désaccord sur les conclusions, le protocole défini à froid peut prévoir la possibilité pour les représentants du personnel d’exprimer leurs réserves ou d’annexer une note divergente.
Marion STOFATI
Avocate Bureau Marseille
Frédéric PAPOT
Juriste référent IDF