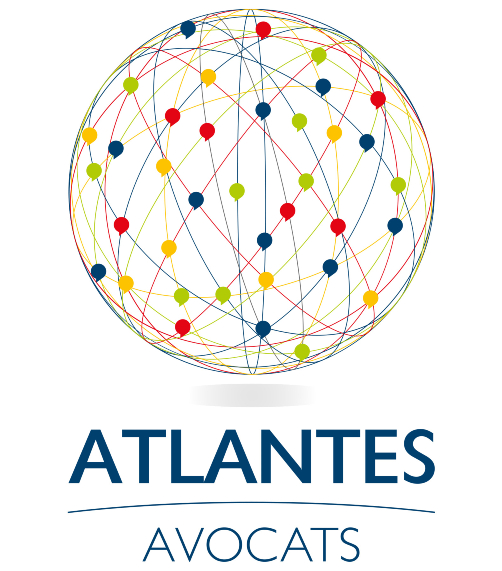


Une étude de la CFDT du printemps 2021 fait ressortir un niveau d’inquiétude des Français pour leur emploi à hauteur de 42 % (1). La Confédération des petites et moyennes entre-prises quant à elle, indique qu’en sortie de crise, 60 000 à 100 000 entreprises disparaîtraient…
Comme durant les deux précédents confinements, les restructurations se sont ralenties durant le troisième. Vont-elles ressurgir à la sortie du confinement comme l’été dernier ? On ne peut que le craindre, y compris durant la période estivale.
C’est dans ce contexte lourd de conséquences qu’ Atlantes a souhaité mettre à votre disposition le Livre blanc Le CSE et les organisations syndicales face aux restructurations afin que vous preniez non seulement connaissance des dispositifs possibles, voire alternatifs, en matière de restructuration mais que surtout vous, élus du CSE et délégués syndicaux, soyez alertés sur les points de vigilance qu’ils appellent nécessairement. Tel est notre objectif.
Vous ne trouverez donc pas dans ce Livre blanc, que nous avons voulu concis et opérationnel, le rappel de toutes les règles que l’on retrouve aisément sur notre ami Google ou sur le site du ministère.
Vous le savez tous, « le diable se trouve dans les détails » ! Et lors des négociations sur ces différents dispositifs auxquels vous pourriez vous trouver confrontés, ce sont effectivement les « détails » qui peuvent faire la différence.
Ce sont ces détails et ces questions qui méritent toute votre attention et qui nous ont animés dans la rédaction de ce Livre blanc que vous retrouverez dès le mois prochain sur notre site Internet.
(1) Retrouvez l’étude CFDT/Kantar
Evelyn BLEDNIAK / Fondatrice du cabinet Atlantes - Avocat associée au barreau de Paris
left>

L’actualité des dernières semaines vous a probablement invité à vous interroger sur les limites qui s’imposent à l’employeur en matière de surveillance et de contrôle de l’activité du salarié. En outre, la crise sanitaire a également induit d’autres façons de travailler et tout particulièrement le recours plus important au télétravail. En juin 2020, le cabinet de consultants ISG montrait que les intentions d’achat de logiciels de surveillance à distance des salariés ont augmenté de plus de 500 % entre juillet 2019 et mars 2020 (1).
Puisque visiblement, la confiance règne, il était nécessaire de faire le tour, ensemble, de cette épineuse question.
La subordination induite par le lien contractuel entre un salarié et son employeur implique la possibilité pour ce dernier de surveiller et de contrôler l’activité du salarié. Dès lors, pour la Cour de cassation « Le contrôle de l’activité d’un salarié, au temps et au lieu de travail par un service interne à l’entreprise chargé de cette mission, ne constitue pas en soi, même en l’absence d’information préalable du salarié, un mode de preuve illicite » (Cass. soc., 5 nov. 2014, n° 13-18.427). Il en est de même du contrôle qui peut s’opérer via les outils professionnels comme les sms envoyés d’un téléphone professionnel (Cass. com., 10 février 2015, n° 13-14.779, n° 181).
Les règles sont différentes s’agissant de la mise en œuvre de moyens et de techniques permettant le contrôle de l’activité des salariés. Le cas échéant, certaines règles devront être observées.
Conformément à l’article L.1121-1 du Code du travail « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »
Dès lors, les contrôles opérés devront veiller à respecter cette règle et c’est notamment ce que vérifiera le CSE.
Conformément à l’article L.2312-28 du Code du travail, le CSE est informé et consulté sur les moyens et techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés préalablement à leur mise en œuvre dans l’entreprise. Dès lors, la Cour de cassation considère que la mise en place d’un système de vidéosurveillance ne peut pas être employé afin de surveiller l’action des salariés si le CSE n’a pas été préalablement informé (Cass. soc., 11 déc. 2019, n° 17-24179).
Conseil Atlantes - Les membres du CSE disposent d’un droit d’alerte (2) en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché.
L’article L.1222-4 du Code du travail précise qu’« aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été préalablement à sa connaissance. » Les dispositifs de contrôle et de surveillance doivent donc donner lieu à une information préalable du salarié.
Il en va par ailleurs de même pour les salariés affectés sur le site d’une société cliente si les dispositifs sur place sont également utilisés pour surveiller l’activité des salariés (Cass. soc., 10 janvier 2012, n° 10-23482).
Conseil Atlantes - En l’absence d’information préalable du salarié, ces moyens de preuves sont inopposables aux salariés (Cass. soc., 22 mai 1995, n° 93-44.078). Étant précisé qu’il s’agit le cas échéant d’une atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles qui justifie pour un membre du CSE d’en demander le retrait dans le cadre de l’exercice de son droit d’alerte (Cass. soc., 10 déc. 1997, n° 95-42.661).
Attention aux infractions pénales, les règles sont différentes ! L’article 427 du Code de procédure pénale indique que « les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve. » La Cour de cassation précise que rien n’impose d’écarter des moyens de preuve quand bien même obtenus de façon illicite ou déloyale (Cass. crim., 6 avril 1994, n° 93-82.717).
Jusqu’au 24 mai 2018, les traitements automatisés d’informations nominatives devaient faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la CNIL. Cette obligation a été supprimée par le RGPD (Règlement général sur la protection des données - Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016).
NB : La CNIL n’a pas pour autant disparu mais elle opère désormais un contrôle a posteriori sur les traitements opérés par l’entreprise et leur conformité aux dispositions nationales et européennes. Ces contrôles pourront donner lieu à des sanctions administratives voire pénales.
Lors de la mise en œuvre d’un tel dispositif, les principes posés par le RGPD devront toutefois être observés :
• Le principe de finalité. Les données sont collectées pour un usage déterminé, explicite et légitime.
• Le principe de proportionnalité et de minimisation.
• Le principe d’une conservation des données limitée dans le temps en fonction de la finalité poursuivie.
• Un droit à une rectification lorsque les données sont personnelles et inexactes.
• Un droit d’opposition sauf s’il existe des motifs légitimes et impérieux.
• Un droit d’accès du salarié aux données le concernant.
Conseil Atlantes - Conformément à l’article 15 du RGPD, chaque salarié dispose de la possibilité d’obtenir de l’employeur la transmission des données personnelles le concernant sans avoir à justifier sa demande. Il peut également connaître les finalités du traitement, les destinataires de ces données et la durée de conservation des données ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée. Le responsable du traitement est tenu de répondre aux demandes émanant de la personne concernée dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai d’un mois.
L’atteinte doit être proportionnée au but recherché. En la matière, la CNIL considère que le recours à ce type de dispositif est justifié dans des circonstances particulières (notamment les salariés manipulant des biens ou de l’argent) et ne doit pas filmer les zones de pause, de repos ou les locaux syndicaux.
Dans une affaire qui a donné lieu à une décision de la CNIL en 2019, l’employeur avait installé deux caméras filmant en continu un poste de travail correspondant à la caisse du magasin et à un emplacement pour la préparation de commandes, non ouvert au public ; une caméra filmant une zone non ouverte au public correspondant à un couloir desservant plusieurs bureaux de salariés. L’employeur consultait les images à distance. Pour la CNIL, un tel dispositif de vidéo-surveillance conduit à placer le salarié occupant le poste concerné « sous surveillance permanente », considérant que « Si l’utilisation du dispositif vidéo à des fins de prévention des atteintes aux biens et aux personnes peut être considérée comme légitime, tel n’est pas le cas de la localisation des salariés par le gérant à des fins de surveillance. » (3)
La CNIL précise par ailleurs que la possibilité offerte de regarder les images à distance ne doit pas conduire à surveiller ses employés et à formuler des remarques sur la qualité du travail. La consultation des images doit se faire par des personnes habilitées par l’employeur. Il revient à l’employeur de définir la durée de conservation en lien avec l’objectif poursuivi. Cette durée ne doit pas dépasser un mois.
L’employeur ne pourra donc transformer la vie des salariés en lugubre émission de téléréalité et devra justifier, notamment au CSE, des nécessités de l’étendue du dispositif (4).
Pour contrôler l’activité des salariés, tous les moyens sont bons et sans même parfois qu’il soit nécessaire de se doter de nouveaux outils.
Dans un questions-réponses du 12 novembre 2020, la CNIL a répondu à certaines interrogations qui se posent sur le télétravail et notamment concernant la surveillance des salariés. Elle évoque certains dispositifs existants et sa réponse est sans équivoque : c’est NON.
La CNIL s’est prononcée sur :
• La surveillance vidéo constante au moyen d’une webcam.
• Le partage permanent de l’écran.
• L’utilisation de « keyloggers » à savoir des logiciels qui enregistre les frappes sur le clavier.
• L’obligation faite au salarié de démontrer à intervalles réguliers sa présence via une application dédiée.
Pour la CNIL, il s’agit de procédés particulièrement invasifs qui s’analysent en une surveillance permanente et disproportionnée.
NB : La CNIL préconise une adaptation des méthodes d’encadrement qui pourra passer par un contrôle de la réalisation des objectifs ou la demande d’un compte rendu aux salariés par exemple. (5)
Il s’agit là de dispositifs permettant la localisation des personnes ou des véhicules professionnels. Il peut s’agir d’un dispositif autonome ou d’un téléphone portable.
Pour la CNIL, la géolocalisation ne peut être installée que pour les motifs suivants :
• Suivre, justifier et facturer une prestation de transport de personnes.
• Assurer la sécurité de l’employé, des marchandises ou des véhicules (en cas de vol par exemple).
• Mieux allouer des moyens pour des prestations à accomplir.
• Respecter une obligation légale ou réglementaire.
• Contrôler le respect des règles d’utilisation du véhicule.
• Accessoirement, suivre le temps de travail, lorsque cela ne peut être réalisé par un autre moyen.
Conseil Atlantes - Pour la Cour de cassation, un dispositif de géolocalisation ne peut être installé que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen et à la condition que les salariés concernés ne disposent pas d’une liberté dans l’organisation de leur travail (Cass. soc., 18 janv. 2018, n° 16-20.618), comme cela peut être le cas pour un VRP ou un élu par exemple. La Chambre sociale a également pu considérer que le système de géolocalisation devait être le « seul moyen permettant d’assurer le contrôle de la durée du travail » (Cass. soc., 19 déc. 2018, n° 17-14.631,n° 1844). Lors de sa consultation, le CSE peut proposer des solutions alternatives (système autodéclaratif, contrôle par un responsable…).
En principe, les informations obtenues par la géolocalisation ne doivent pas être conservées plus de deux mois, et cinq ans s’agissant des données utilisées pour le suivi du temps de travail. En tout état de cause les salariés doivent avoir accès aux données collectées (6).
Si la tentation peut exister d’externaliser une formule de surveillance rapprochée particulièrement intrusive, la Cour de cassation a posé très tôt le principe de l’illicéité de la preuve obtenue par le recours à un détective privé (Cass. soc., 22 mai 1995, n° 93-44078 / Cass. soc., 17 mars 2016, n°15-11.412). Une solution identique a par ailleurs été retenue concernant
l’envoi de lettres piégées (Cass. soc., 4 juill. 2012, n° 11-30.266).
Ce procédé étant attentatoire à la vie privée du salarié, il caractérise un comportement déloyal justifiant l’octroi de dommage et intérêts (Cass. soc., 26 sept. 2018, n° 17-16.020).
À la frontière de la vie privée protégée par la jurisprudence, la permissivité de certains outils de communication place les salariés dans un risque juridique à notre sens encore trop peu considéré. En matière de courriel, les règles applicables se sont inscrites dans la logique jurisprudentielle applicable aux correspondances par courrier. Ne peuvent dès lors justifier un licenciement :
• Des courriels issus de la messagerie électronique personnelle du salarié (Cass. soc., 26 janv. 2016, n° 14-15.360).
• Des courriels issus de la messagerie professionnelle comportant en objet la mention « personnel » (Cass. soc., 2 oct. 2001, n° 99-42.942). Faute de mention, ils peuvent donc être ouverts (Cass. soc., 16 mai 2013, n° 12-11.866).
En revanche, on peut s’interroger sur le sort des messageries instantanées professionnelles dont l’ergonomie fait souvent oublier qu’il s’agit-là d’un outil réservé à ce cadre. Comment identifier qu’il s’agit d’échanges per-sonnels entre salariés ? En tout état de cause, en l’état du droit faute de mention, les échanges pourraient être à notre sens produits à l’appui d’une procédure disciplinaire.
Concernant les réseaux sociaux, les problématiques sont de deux ordres : le caractère public des propos fautifs et le temps qui peut y être consacré (7).
Les outils permettant une surveillance de l’activité des salariés sont nombreux et méritent une attention toute particulière des CSE comme des salariés. En outre, il convient de se rappeler que ces outils attentatoires à la vie personnelle du salarié peuvent être source de risques psychosociaux RPS pour les salariés.
(1) Étude réalisée par le cabinet ISG
(2) Tout savoir sur le droit d’alerte et la procédure applicable
(3) Décision MED-2019-025 du 5 novembre 2019
(4) La vidéosurveillance-vidéoprotection au travail du 27 nov. 2019
(5) CNIL Questions-réponses sur le télétravail du 12 nov. 2020
(6) CNIL La géolocalisation des véhicules des salariés du 25 juillet 2018
(7) Pour en savoir plus sur le sujet
Maxence DEFRANCE / Juriste - Atlantes Paris/Île-de-France
Souvent invoquée par l’employeur, nous vous proposons une clarification des règles en vigueur. Pour être consi-dérées comme confidentielles, l’employeur doit non seulement déclarer ces informations comme telles mais également qu’elles le soient au regard des intérêts légitimes de l’entreprise.
 Les membres suppléants sont concernés l’obligation de confidentialité
Les membres suppléants sont concernés l’obligation de confidentialitéTous les membres du CSE (titulaires et suppléants) ainsi que les représentants syndicaux sont soumis à l’obligation de confidentialité (article L. 2315-3 du Code du travail).
Dans les entreprises de plus de 50 salariés, le Code du travail prévoit une extension de cette obligation aux experts du CSE, aux membres de la CSSCT, à la commission des marchés ou encore à la personne chargée par le CSE de sténographier les réunions.
 L’employeur peut présenter un document de 40 pages au CSE comme étant confidentiel
L’employeur peut présenter un document de 40 pages au CSE comme étant confidentiel La Cour de cassation juge qu’en classant confidentiel l’ensemble d’un document remis au CSE, sans le justifier par la nécessité de protéger les intérêts légitimes de l’entreprise, l’employeur porte atteinte aux droits du CSE (Cass. soc., 5 novembre 2014, n° 13-17.270). Ainsi, il est peu probable qu’un document entier remplisse cette obligation. De la même manière, une information connue des salariés ou du public n’a que peu de probabilité d’être confidentielle.
De manière générale, la jurisprudence reconnaît comme étant confidentielles les informations non connues du public, les informations pouvant nuire à l’image de l’entreprise ou encore les annonces concernant les comportements individuels.
 L’employeur doit prouver que les données sont confidentielles
L’employeur doit prouver que les données sont confidentiellesLa Cour de cassation précise qu’il revient à l’employeur d’établir que les informations communiquées sont confidentielles. En effet, l’employeur semble le plus à même de pouvoir le prouver et c’est ce dernier qui impose une obligation particulière de non-divulgation au CSE (Cass. soc., 5 novembre 2014, n° 13-17.270). En outre, la confidentialité peut être évolutive dans le temps. L’employeur peut donc fixer une durée pendant laquelle l’information est réputée confidentielle.
En cas de contestation sur le caractère confidentiel, les membres du CSE peuvent saisir le juge. La sanction d’un classement confidentiel non justifié est la reprise de la procédure d’information/consultation du comité dès l’origine.
 Je peux être sanctionné pour violation de l’obligation de confidentialité
Je peux être sanctionné pour violation de l’obligation de confidentialité Dès lors que l’employeur présente l’information comme confidentielle et prouve le caractère confidentiel, un élu du CSE peut être sanctionné. Ces deux conditions sont cumulatives. Cette déclaration doit être préalable à l’information.
De manière générale, si l’employeur ne présente pas la confidentialité lors de la réunion de CSE, il ne pourra invoquer le manquement ultérieur du CSE. Néanmoins, aucune forme n’est imposée par la loi. Il peut s’agir d’une information verbale ou via un filigrane par exemple.
L’auteur de la violation engage par ailleurs sa responsabilité civile. Il peut être condamné à verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi. En outre, une sanction disciplinaire ou un licenciement pourraient être envisagés.
 Les informations contenues dans la BDES sont confidentielles
Les informations contenues dans la BDES sont confidentielles L’article L. 2312-36 du Code du travail prévoit que les informations contenues dans la BDES sont confidentielles si elles revêtent ce caractère et que l’employeur les présente comme telles.
Cela n’est donc pas automatique et s’applique également aux délégués syndicaux.
Audrey LIOTE / Juriste - Atlantes Lyon/Auvergne-Rhône-Alpes

<img975|center>
C’est à cette question qu’a dû répondre le Président du Tribunal judiciaire de Nîmes dans une affaire concernant la fermeture d’un site appartenant à un établissement public, créé depuis 2005, ayant une mission auprès du public d’information relative aux enjeux énergétiques (et notamment, relative au nucléaire), espace autrement dénommé « musée scientifique ».
Aux termes d’une ordonnance de référé du 11 février 2021, le Président du Tribunal judiciaire confirme ainsi l’importance du projet et par là même, l’obligation de consulter le CSE incombant à l’employeur.
Pour rappel, l’article L.2312-8 du Code du travail pose le principe selon lequel le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et identifie des cas particuliers, lesquels ne sont pas exhaustifs (1) (complété par l’article L.2312-37 du Code du travail). C’est au visa de cet article que la décision a été rendue.
À l’appui de sa position consistant à refuser de consulter le CSE, la direction a soutenu essentiellement que le projet n’avait aucun impact sur la marche générale de l’entreprise au motif que le site était géré par un prestataire extérieur (représentant 8 salariés).
Le CSE quant à lui a fait valoir, en premier lieu, l’importance du projet caractérisée par l’importance de la mission confiée au musée ainsi que l’impact sur la situation économique et les conditions de travail des salariés (tant du prestataire que ceux de l‘établissement).
Le Président a considéré que les pièces produites par le CSE (y compris le discours du ministre à l’Industrie le jour de l’inauguration du site) démontraient qu’une des caractéristiques du site de l’établissement est la présence de ce musée en son sein et en conclut que sa fermeture programmée intéresse l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.
La direction a effectivement mis en œuvre la procédure d’information-consultation et n’a pas contesté la décision désormais définitive.
Il peut être salué le travail de fond fourni par les élus pour étayer leur position mais surtout, le fait que la juridiction ait retenu un critère avant tout qualitatif quant à l’importance du projet ce qui est rare dans le paysage jurisprudentiel.
(1) Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs
[Découvrir ou approfondir sur les prérogatives du CSE->https://www.atlantes.fr/-Themes-de-formation-]
Laurence CHAZE / Avocate - Atlantes Marseille/Sud-Est

Le télétravail recommandé depuis plus d’un an dans les entreprises a fait émerger de nouveaux risques psychosociaux, ou tout du moins, les a accentués dans cette période humainement compliquée. Au-delà des risques professionnels clairement identifiés comme le risque d’isolement, les incivilités numériques se sont multipliées avec le travail à distance.
Selon une étude publiée en décembre 2020, le télétravail a tendu les relations interprofessionnelles : 48 % des salariés estiment que leurs clients sont plus agressifs depuis la crise du Covid-19, suivis par leurs collègues puis leurs managers (1).
La loi est silencieuse sur ce sujet épineux. À moins d’être qualifiés d’injure ou de diffamation, des propos irritants quotidiens ne trouvent aucune définition ni sanction assortie en droit français.
De manière plus générale, les incivilités au travail, renvoient « à la violation des règles de respect mutuel, au mépris porté aux autres sous toutes ses formes. Ce sont des comportements déviants, de faible intensité, qui s’opposent aux normes d’échange et au respect d’autrui attendues et nécessaires dans un cadre professionnel » (2).
Les outils de communication numériques (courriels, réseaux sociaux d’entreprise, sms, tchat d’entreprise) sont les canaux de diffusion de ces incivilités.
Il en existe plusieurs types :
• Les incivilités dans la forme qui proviennent de contenus ou de formes inappropriés dans les messages : le vocabulaire employé, le ton et les injonctions, l’absence de formules de politesse, des messages ambigus, la taille, la couleur et le choix des polices de caractère, l’utilisation des majuscules et de la ponctuation.
• Les incivilités dans les usages qui correspondent à des usages inappropriés ou non conventionnels des outils comme l’excès de pression issu des échanges, la surcharge informationnelle, le « flicage » de l’activité, la mise en copie systématique.
• Les incivilités automatisées qui sont produites par les outils eux-mêmes (courriel automatique, automatisation des formules de politesse, message « no reply »).
Porter le sujet en CSE notamment dans le cadre de la consultation sur la politique sociale mais pas seulement. En effet,
les incivilités ont une incidence sur la santé mentale des salariés et rappelons-le, l’employeur doit tout mettre en œuvre pour protéger la santé de ses collaborateurs.
La jurisprudence a déjà eu l’occasion de se prononcer sur un défaut d’implication de l’employeur dans la prévention des risques de violence et d’incivilités auxquels les salariés étaient exposés, les juges ont confirmé que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité (Cass. soc., 15 déc. 2016, n° 15-20.987). Les incivilités numériques représentant donc un risque contentieux car sa responsabilité pourrait être engagée.
De plus, les incivilités ont un impact sur la qualité du travail fourni, les salariés vexés, blessés ou déprimés pourront être moins productifs. Des incivilités répétées peuvent également conduire à un turn over important.
Inciter les salariés à faire remonter les incivilités numériques
L’objectif étant d’analyser ces incivilités à l’échelle du collectif et non de stigmatiser les personnes concernées. Pour cela,
le CSE ou la CSSCT peuvent construire un questionnaire anonymisé et proposer des campagnes de sensibilisation et des actions de formation. Une charte pourrait également être proposée.
En outre, les membres du CSE peuvent avoir recours au droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes dans la mesure où chaque salarié a le droit au respect et à la dignité dans le cadre professionnel, y compris lors des échanges dématérialisés.
À l’heure où le télétravail tend à prendre une place plus importante dans les relations de travail pour certaines populations de travailleurs, cette question mérite à notre sens une attention toute particulière afin de prévenir les risques psychosociaux RPS que ces pratiques engendrent.
(1) Selon le baromètre de la santé au travail réalisé par OpinionWay pour Empreinte Humaine, décembre 2020
(2) Ouvrage Le numérique : nouvelles formes d’incivilité au travail - Expériences, usages, droits, témoignages, définitions (84 pages, en .pdf)
Alison VILLIERS / Juriste - Région Ouest

« Nos juristes et nos avocats s’appuient sur les questions des élus du CSE, leurs témoignages et des cas pratiques réels récents pour les former. Des interrogations surgissent ensuite ?
Prolongeons le dialogue. »
Pendant votre formation, vous allez vous aguerrir aux règles de fonctionnement du CSE, découvrir vos droits et acquérir des outils face aux différentes stratégies de la direction de votre entreprise.
Les nouvelles règles du Droit du travail vous obligent à connaître des champs d’action diversifiés et complexes. De retour dans votre entreprise, vous êtes saisis des premiers cas concrets.
Que faire ? Vers qui se tourner ?
D’abord vers votre formateur.
La formation pilotée est là pour ça !
Le retour d’expérience entre vous et votre formateur, en complément de votre programme de formation CSE en intra :
• Un forfait pilotage de 450 €
• 100 % dédié à vos questions
• Avec votre formateur, en visioconférence
• Trois mois après votre formation
Préparez vos questions, votre formateur consacre deux heures à y répondre
• Nous avons rédigé notre règlement intérieur, avons-nous pensé à tout ?
• Nous voulons créer une commission aux activités sociales et culturelles, quels sont les points importants que nous devons prévoir ?
• Une négociation sur le télétravail vient de s’ouvrir, devrions-nous être consultés ?
• Des licenciements sont évoqués, que doit-on faire pour peser dans la procédure ?
• …
Parlez-en à votre conseiller en formation au 01 56 63 65 05
et réservez-la en même temps que votre formation CSE en intra.
L’actualité du droit du travail et de ses évolutions… du bout des doigts.
En savoir plus