Anne-Sophie LARIVE
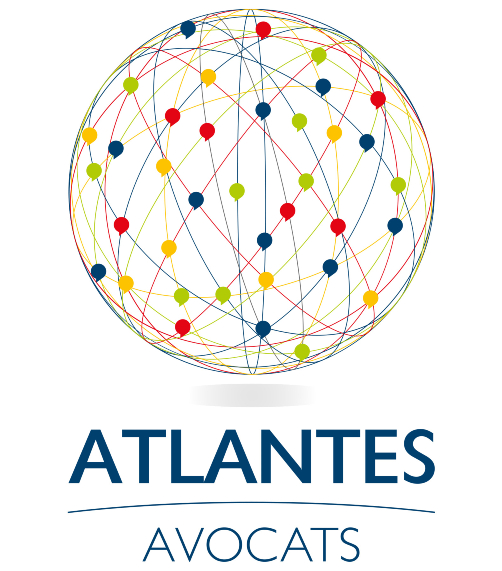


Une fois de plus le gouvernement a décidé de s’attaquer aux représentants du personnel en présentant un projet de loi au Parlement courant mars, pour adoption avant l’été, visant à supprimer les attributions dont bénéficient actuellement les CSE dans les entreprises de 50 à 250 salariés.

Suppression de la personnalité juridique des CSE ayant notamment pour effets :
Ce projet aurait pour raison d’être le « fardeau administratif dont souffrent les entreprises ».
Considérer que la présence de représentants du personnel doi être mise sur un même pied d’égalité résulte d’un raisonnement irationnel et infondé qui ne prend pas en compte la vigueur du dialogue social dans les PME PMI. C’est à tout le moins présenter une vision hors sol et caricaturale de la démocratie sociale.
Cette tentative d’invisibilisation n’est pas nouvelle :
Les CSE ne doivent pas devenir les victimes collatérales de l’exaspération des employeurs liée à l’excès de normes produites par la Puissance Publique, sauf à désigner ceux-ci comme les éternels boucs émissaires de tous les maux de l’entreprise et militer pour leur disparition définitive.
Supprimer les CSE c’est renoncer à dialoguer et ne plus permettre aux 4.3 millions de salariés concernés de comprendre et d’adhérer au projet de l’entreprise. Ce grand bond en arrière donnera toute sa force à la formule utilisée par Jean Auroux il y a plus de 40 ans évoquant l’entreprise comme le lieu du bruit des machines et du silence des hommes.
Nous ne pouvons l’accepter et vous invitons à vous emparer du sujet en sollicitant votre député (e) à sa permanence ou directement par mail
 Retrouvez votre député avec ce lien ou ce QR code
Retrouvez votre député avec ce lien ou ce QR code
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/vos-deputes
Nous n’en resterons pas là et vous informerons très régulièrement de nos futures actions et communication.
Les nouveaux fossoyeurs du dialogue social (PDF)
(1)Les élections professionnelles dans le secteur privé, 22 février 2024 (https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/les-elections-professionnelles-dans-le-secteur-prive
Les règles en matière de bénéfice de l’Allocation d’Aide au retour à l’Emploi (ARE) ne sont pas toujours parfaitement lisibles. L’occasion pour nous de faire le point sur les principales questions qui peuvent se poser.
Dans quel cas une rupture de contrat de travail donne-t-elle droit à l’indemnité chômage ?
Depuis 2018, l’Assurance chômage a fait l’objet de réformes qui ont modifié en profondeur ses règles. Outre la réforme de la gouvernance de l’Assurance chômage, ces mesures ont modifié les conditions d’ouverture des droits, les modalités d’indemnisation et ont créé de nouveaux droits au fonctionnement encore incertain. Les observateurs de l’Assurance chômage[1] parlent de « nombreuses incohérences » qui « rendent souvent imprévisible la protection contre le chômage »[2].
La rupture du contrat de travail n’implique pas toujours une indemnisation par l’assurance chômage, loin de là. Pour tenter d’y voir plus clair, il est possible de s’appuyer sur un principe clé de l’assurance chômage : l’indemnisation repose sur la perte involontaire d’emploi. Reste alors ensuite à comprendre ce qu’il faut entendre par perte involontaire d’emploi…
LA RUPTURE A L’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR
Dans ces cas-là les règles semblent assez simples : dès lors que la rupture est à l’initiative de l’employeur, le salarié est considéré comme ayant involontairement perdu son emploi et peut ainsi bénéficier de l’assurance chômage.
Le licenciement
C’est l’une des principales causes de rupture à l’initiative de l’employeur :
Licenciement pour motif économique
Il trouve sa justification dans des éléments objectifs qui sont extérieurs au salarié (difficultés économiques, mutations technologiques, sauvegarde de la compétitivité).
Licenciement pour motif personnel
Qu’il soit disciplinaire (faute, faute grave ou encore faute lourde) ou bien pour un motif non-disciplinaire (insuffisance de résultats, insuffisance professionnelle, inaptitude médicalement constatée, etc.).
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, un salarié faisant l’objet d’un licenciement disciplinaire, y compris pour faute grave ou lourde, conserve son droit à l’indemnisation chômage.
Mise à la retraite d’office
Pour les salariés âgés de 67 à 70 ans, l’employeur peut demander chaque année, 3 mois avant la date d’anniversaire, si la personne en question souhaite partir à la retraite.
Pour les salariés âgés d’au moins 70 ans, l’employeur peut d’office et sans son accord mettre le salarié à la retraite.
Dans les deux cas, la rupture est à l’initiative de l’employeur pourtant le salarié ne bénéficie pas de l’indemnité chômage, celui-ci bénéficiant alors de la pension retraite.
LA RUPTURE CONVENTIONNELLE
La rupture conventionnelle consiste en un accord entre l’employeur et le salarié sur le principe et les modalités de la rupture du contrat de travail. Dès son origine, la rupture conventionnelle a été considérée comme ouvrant droit à l’indemnité chômage.
Et ce y compris lorsque c’est le salarié qui propose la rupture conventionnelle à son employeur. En effet, en droit, la rupture conventionnelle est considérée comme un accord mutuel des deux parties, peu importe si le salarié a pris l’initiative de la proposer.
RUPTURE A L’INITIATIVE DU SALARIE
En principe, la rupture à l’initiative du salarié s’oppose à la logique d’indemnisation du chômage selon lequel le salarié doit perdre involontairement son emploi.
Toutefois, le législateur a prévu des exceptions au principe de la perte involontaire d’emploi : soit parce que la rupture apparait comme légitime soit parce qu’elle est considérée comme relevant, en réalité, de manquements de l’employeur.
Démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail[3]. Par définition, la démission est aux antipodes du principe d’indemnisation de l’assurance chômage, elle ne permet donc pas de bénéficier de l’indemnité chômage.
Pourtant, deux exceptions permettent tout de même de bénéficier de l’indemnité chômage en cas de démission :
La démission légitime
Il s’agit d’une démission justifiée par un motif reconnu comme légitime, à savoir :
- mariage ou PACS avec un changement de lieu de travail,
- mineur quittant son emploi pour suivre ses parents,
- accompagnement d’un enfant handicapé admis dans une structure d’accueil hors lieu de résidence,
- victime de violences conjugales.
Démission pour une reconversion
La démission peut donner droit à une indemnisation chômage à condition d’être en CDI et d’avoir travaillé durant 5 années avant la démission qui doit être justifiée par un projet préalablement validé par Pôle Emploi.
Bien que volontaires, ces types de démission sont reconnus par le législateur comme devant faire l’objet d’une indemnisation chômage.
Rupture à l’initiative du salarié résultant de manquements de l’employeur
Le Code du travail prévoit des cas de rupture à l’initiative du salarié mais étant provoquées par des manquements particulièrement graves de l’employeur à ses obligations (non-paiement du salaire, harcèlement, discrimination, etc.). Cette rupture peut être actée par le salarié lui-même (prise d’acte de la rupture du contrat de travail) ou faire l’objet d’une saisie du Conseil des prud’hommes (résiliation judiciaire).
Dans les deux cas, si la rupture est considérée comme résultant du comportement fautif de l’employeur, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié bénéficie alors d’une indemnisation chômage
Attention, en cas de prise d’acte, si le juge estime que la rupture n’est pas justifiée, elle produit les effets d’une démission. Dans ce cas, le salarié ne bénéficie pas d’indemnité chômage.
Le départ volontaire à la retraite
Le départ volontaire à la retraite intervient à la demande du salarié et entraine la liquidation de la pension retraite (excluant donc le bénéfice de l’indemnité chômage).
L’abandon de poste désormais assimilé à une démission
L’abandon de poste caractérise la situation dans laquelle un salarié cesse spontanément et sans justification de se présenter à son poste de travail. L’absence injustifiée du salarié suspend le contrat de travail (l’employeur n’est pas tenu de rémunérer le salarié, ni de le licencier, ni non plus de délivrer une attestation Pôle Emploi).
La loi du 21 décembre 2022 prévoit désormais qu’un salarié qui abandonne son poste et qui ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure (par LRAR) peut être considéré comme démissionnaire par son employeur (qui n’a donc plus à le licencier pour s’en séparer). Le salarié considéré démissionnaire ne peut donc pas bénéficier de l’indemnité chômage.
Et la période d’essai dans tout ça ?
Si la rupture de la période d’essai est autorisée par le Code du travail, pour la réglementation assurance chômage, en revanche, elle produit les effets d’une démission dès lors qu’elle est à l’initiative du salarié.
Le salarié à l’initiative de la rupture de la période d’essai n’aura donc, en principe, pas le droit à l’allocation chômage sauf si son initiative est considérée comme une démission « légitime ».
Arthur MOREAU
Juriste
[1] C’est le cas du Médiateur national de Pôle emploi qui évoque, dans le cas des démissions notamment, « un foisonnement de textes complexes » qui en rend la compréhension inaccessible à la plupart des demandeurs d’emploi ainsi qu’à beaucoup de conseillers pôle emploi… (Rapport Médiateur National Pôle Emploi 2016).
[2] Bruno Coquet, « les deux réformes de l’assurance chômage », OFCE, n°03-2022.
[3] cass. Soc. 9 mai 2007 n°05-40.518
Un nombre important de salariées vivent malgré elles une interruption spontanée de grossesse, autrement dit, en dehors de toute intervention médicale (IMG) ou volontaire (IVG).
Jusqu’alors, la loi se concentrait sur les droits des salariées en cas d’interruptions spontanées de grossesse plus tardives (à partir de 22 semaines de grossesse d’aménorrhée). Pour les autres femmes, celles pour qui l’évènement s’est présenté plus tôt, le Code du travail était muet et ne prévoyait aucun dispositif d’accompagnement en particulier.
Depuis sa publication au JO le 8 juillet 2023, une loi est désormais venue créer deux nouveaux droits à l’attention des salariées concernées par cette situation :
Suppression des 3 jours de carence pour le versement des IJSS maladie en cas d’arrêt maladie
Jusqu’à la publication de la loi, la salariée qui se faisait arrêter par son médecin l’était dans les conditions de droit commun, soit :
Depuis le 8 juillet, le premier délai de carence est supprimé. Le second délai demeure applicable.
Pour bénéficier de la suppression du délai de carence de 3 jours, l’arrêt doit faire suite à une interruption spontanée de grossesse, ayant eu lieu avant la 22e semaine d’aménorrhée.
Cette mesure s’appliquera aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date à préciser par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.
Et après la 22e semaine ?
La salariée va bénéficier d’un dispositif différent, déjà existant. Dans ce cas, les salariées peuvent bénéficier du congé de maternité qui leur est dû, sans délai de carence, et perçoivent alors des indemnités journalières maternité par la sécurité sociale.
Protection contre le licenciement
Désormais, l’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d’une salariée pendant les 10 semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre les 14e et 21e semaines d’aménorrhée incluses.
Cette protection ne s’applique pas :
Anissa CHAGAL
Juriste
Références : loi 2023-567 du 7 juillet 2023, art. 2, V ; c. séc. soc. art. L. 323-1-2 ; c. trav. art. L. 1225-4-3 ; c. trav. art. L. 1225-6.
Tel un marronnier de mauvaise presse, la question de l’acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie revient fréquemment en fin de période estivale.
Cette redondance thématique trouve son origine dans la lenteur de la France à adapter notre législation interne à la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003.
Pour rappel, à date, sauf pour les périodes assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou par une disposition conventionnelle, les absences pour maladie non professionnelle n’entrainent pas acquisition de congés payés.
Pour autant, ce principe posé par l’article L3141-5 du Code du travail est non conforme à l’article 7 de la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 qui prévoit que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins 4 semaines pour une période de référence complète, sans distinguer selon l’origine d’éventuelles absences
La Cour de cassation, de son coté, a pris une position stricte (Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-22.285) et a refusé de reconnaître aux dispositions de cette directive un effet direct.
Pour autant, quand bien même les salariés ne peuvent se prévaloir devant les tribunaux d’une application directe de cette directive, il leur reste possible d’engager la responsabilité de l’Etat pour défaut de mise en conformité de notre droit national avec la directive européenne précitée.
C’est sur cet argumentaire que les syndicats CGT, FO et SUD ont récemment attaqué l’Etat et obtenu gain de cause devant la Cour administrative d’appel de Versailles (CAA Versailles, 17 juill. 2023, n°22VE00442).
Cette dernière reconnait ainsi aux organisations syndicales la capacité d’agir du fait d’un préjudice moral collectif des salariés qu’elles représentent et condamne l’État à leur verser la somme de 10 000 euros chacune.
La Cour considère par ailleurs que sont bien contraires à l’article 7 de la directive 2003/88/CE les dispositions du Code du travail qui n’assimilent pas à du travail effectif, pour la détermination de la durée des congés payés, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de maladie.
Précisons enfin, que cette décision s’inscrit dans la suite d’un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sur le même sujet et pour lequel l’Etat avait déjà été condamné.
A cette occasion, le tribunal avait rappelé que la transposition en droit interne des directives européennes est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui revêt en outre le caractère d’une obligation constitutionnelle (TA Clermont-Ferrand, 6 avril 2016, n° 1500608).
Nous ne pouvons qu’espérer que cette décision entrainera une réaction du législateur et qu’il soit rapidement mis fin à plusieurs décennies de non-conformité au droit européen sur le sujet.
Justin Saillard-Treppoz
C’est l’un des principaux points de tension des ordonnances de 2017 : le barème Macron plafonnant les indemnités en cas de licenciement injustifié ou abusif.
Pour l’exécutif, ce barème visait à donner plus de sécurité aux employeurs dans les réparations financières à payer en cas de licenciement irrégulier. Cette sécurité devait faciliter les embauches… Cinq ans plus tard, le bilan économique et social est plus contrasté. La sécurité annoncée n’a pas permis aux embauches en CDI de prendre le pas sur les embauches en CDD (qui restent 7,5 fois plus importantes). En outre, les licenciements pour faute grave ont augmenté (+32,3% en quatre ans) signe, selon l’hypothèse faite par un rapport de la DARES[#_ftnref1" style="color :#0563c1 ; text-decoration:underline" title="">[1], que la contestation en justice par le salarié licencié serait moins imprévisible et moins risquée pour l’employeur.
Pour tenter d’assurer une indemnisation adaptée, différentes décisions[2] de justice ont rejeté l’application du barème en se fondant notamment la Convention n°158 de l’OIT[3]. Son article 10 prévoit que l’indemnité pour licenciement injustifié doit être « adéquate ». Pourtant, le 11 mai 2022, la Cour de cassation jugeait le barème Macron « compatible » avec le texte de l’OIT. Le barème semblait donc conforté.
Deux décisions de justice résistent au barème Macron
Quelques mois après l’arrêt de la Cour de cassation, la Cour d’appel de Douai affirme, dans une autre affaire, qu’« il n’est pas démontré que le barème […] puisse assurer, dans tous les cas, une protection suffisante des personnes injustement licenciées »[4]. Comment, en effet, assurer une réparation « adéquate » face à la réalité du préjudice subi alors que l’indemnité prononcée par le juge est elle-même limitée par un barème impératif inscrit dans la loi ?
En mars dernier, un arrêt de la Cour d’appel de Grenoble[5] rappelle que la Cour de cassation a jugé ce barème « compatible » à la convention de l’OIT mais qu’elle ne l’a pas pour autant jugé « conforme ». La juridiction présente une argumentation originale : elle s’appuie sur les recommandations du comité d’experts de l’OIT rendues le 16 février 2022 invitant le gouvernement français à examiner à intervalles réguliers les modalités d’application du barème et son adéquation avec les préjudices subis. Relevant qu’« aucune évaluation n’a été faite » par l’Etat depuis l’entrée en vigueur de la réforme en 2017, la Cour d’appel affirme « qu’il manque une condition déterminante pour que les barèmes de l’article L.1235-3 puissent trouver application dans le litige soumis à la juridiction ». En conséquence, la juridiction considère « qu’il y a lieu [d’] écarter purement et simplement » l’application du barème Macron. L’indemnité octroyée à la salariée licenciée s’élève à 40 000€ au lieu des 24 800€ prévus en application du barème.
Comment évaluer la réalité du préjudice subi ?
Ces récentes décisions semblent avoir ouvert une brèche dans l’application du barème Macron. Le caractère impératif et fixe des indemnités semble pouvoir être remis en cause au nom du principe d’une réparation intégrale et individualisée du préjudice subi.
Toutefois, au-delà de ces éléments de droit, ces deux récents arrêts opposent au barème impératif et fixe de l’article L.1235-3 une prise en compte plus large et plus précises des circonstances : outre l’ancienneté et le salaire moyen pris en compte par la loi, ces récentes décisions de justice invitent à plaider les conditions du salarié et notamment les charges de famille impérieuses, la précarité économique et les difficultés à retrouver un emploi.
L’enjeu stratégique de la remise en cause du barème Macron est sans doute là : dans la démonstration d’un préjudice subi excédant le plafonnement de ce barème à partir d’un plaidoyer précis sur les conditions et circonstances particulières des salariés licenciés injustement. Cinq ans après l’entrée en application du barème Macron, le débat n’est pas clos …
Arthur MOREAU
[1] https://www.humanite.fr/social-eco/licenciements/licenciements-le-bilan-explosif-des-ordonnances-macron-800240
[2] Jugement du 16 mai 2022 du Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand (CPH Clermont-Ferrand, 16 mai 2022, n°F20/00340, Mme B. c/ SARL Coup de pouce) ; Cour d’appel de Riom rendu le 22 novembre 2022 (CA Riom, 22 novembre 2022, n°20/00479, demande jugée recevable mais infondée en l’espèce)
[3] L’Organisation Internationale du Travail est une agence de l’Organisation des Nations Unies (ONU) qui poursuit notamment comme objectif de promouvoir des standards minimaux en matière de droit du travail.
[4] Cour d’appel de Douai, Chambre sociale, Arrêt nº 1736 du 21 octobre 2022, Répertoire général nº 20/01124
[5] CA Grenoble, ch. soc. sect. B, 16 mars 2023, no 21/02048
[FC1]Ces deux paragraphes finaux sont à mon sens à reformuler pour plus de clarté et de précision sur les enjeux contentieux, tout en rappelant que ces deux arrêts sont des exceptions face au principe contentieux qui reste celui de l’application du barème.
Lorsque le mercure grimpe, les interrogations sur les adaptations des conditions de travail habituelles se multiplient : la loi prévoit-elle une température maximale pour les locaux de travail ? Le travailleur peut-il adapter sa tenue vestimentaire ? L’employeur doit-il proposer davantage de pauses ?
Notre sélection des questions les plus fréquentes.
1. A quelles obligations générales l’employeur est-il tenu ?
Comme le rappelle le ministère du travail sur son guide de prévention des risques liés aux vagues de chaleur 2023, l’employeur doit :
2. Le Code du travail envisage-t-il une température maximale à ne pas dépasser dans les locaux ?
Aussi étonnant que cela puisse paraître, le Code du travail ne prévoit pas de dispositions concernant la température maximale ou minimale sur poste de travail.
La norme NF X35-203/ISO 7730 relative au confort thermique, non actualisée depuis 2006, précise les seuils suivants :
Il est à noter que l’INRS (Institut national de recherche et de sécurité) considère qu’au-delà de 30 °C pour un salarié sédentaire et 28°C pour un travail nécessitant une activité physique, la chaleur peut constituer un risque pour la santé des salariés.
Rappelons que l’employeur est investi d’une obligation générale de santé et de sécurité à l’attention du personnel. Cette obligation lui impose de prendre toutes « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » (C. trav., art. L. 4121-1).
L’employeur a donc intérêt, si la température surpasse les limites précitées par l’INRS, à agir sans délai pour assurer la sécurité des salariés, en y intégrant les conditions de températures.
Conseil : Que peut faire le CSE si les températures deviennent insupportables pour les salariés ?
N’hésitez pas à alerter immédiatement l’employeur si les températures dépassent les 30 ou 28 C° précités, afin qu’il puisse prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés :
3. Est-il possible d’adapter sa tenue en fonction des fortes chaleurs (exemple : bermuda, vêtements plus courts) ?
La réponse dépend de ce qui a été décidé au niveau de l’entreprise.
L’employeur peut apporter des limites à la liberté de se vêtir :
A titre d’exemple, les juges ont validé les licenciements de salariés qui portaient : bermudas, tongs, jogging, parcequ’ils étaient alors en contact avec la clientèle. En résumé, si l’employeur peut démontrer en quoi porter un short ou des tongs nuit à l’image de l’entreprise, ou ne répond pas aux impératifs de sécurité, il peut interdire à ses collaborateurs de les porter au travail.
Enfin, il est également possible de se fonder sur le guide de prévention des risques liés aux vagues de chaleur 2023 du ministère du travail qui indique aux travailleurs de : « Porter des vêtements légers qui permettent l’évaporation de la sueur (ex. : vêtements de coton), amples, et de couleur claire si le travail est à l’extérieur ».
Conseil : à défaut de prendre des initiatives unilatérales et de risquer une sanction disciplinaire, nous vous invitons à porter ces sujets sur un ordre du jour d’une réunion du CSE, afin de pouvoir négocier des mesures exceptionnelles en matière de tenue vestimentaire pendant ces périodes de fortes chaleurs. Il est également judicieux de vérifier ce qui a été prévu au sein du règlement intérieur de l’entreprise.
4. Qu’en est-il de la fourniture d’eau dans l’entreprise ?
De façon générale, en dehors des épisodes de fortes chaleurs, l’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche (C. trav. art. R 4225-2).
De plus, lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l’employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée (C. trav. art. R4225-3).
Les boissons et les aromatisants mis à disposition sont choisis en tenant compte des souhaits exprimés par les travailleurs et après avis du médecin du travail.
Nous invitons le CSE à vérifier l’emplacement des postes de distribution des boissons, notamment leur proximité avec les postes de travail.
5. Le droit de retrait peut-il être mis en œuvre dans une situation de grosses chaleurs ?
C’est une question qui nous est souvent posée, notamment par des représentants du personnel sollicités par les salariés.
En ce qui concerne les principes régissant le droit de retrait, l’article L. 4131-1 du Code du travail dispose que :
« Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. »
L’article L. 4131-3 du Code du travail ajoute qu’« aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux. »
Sous réserve de l’appréciation des tribunaux, le droit de retrait pourrait être invoqué par les salariés exposés à de très fortes chaleurs. À cet égard, le Haut conseil de la santé publique a recommandé aux salariés de cesser immédiatement toute activité dès qu’apparaissent des signes de malaise et de prévenir les collègues, l’encadrement et le médecin du travail.
Du côté des tribunaux, plusieurs arrêts ont été dans le sens du salarié :
Nous vous invitons, avant de songer à l’exercice du droit de retrait, d’inciter l’employeur à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la sécurité des salariés.
6. Les alertes « vigilances rouges » de Météo France étant plus fréquentes ces derniers étés, existe-il des obligations supplémentaires ?
Absolument. Dans une instruction interministérielle relative à la gestion des vagues de chaleurs en date du 12 juin 2023, il est précisé que l’employeur doit :
Le CSE peut tout à fait s’appuyer sur le service de santé de prévention et de santé au travail, et de la DREETS si besoin.
Vous pouvez retrouver les instructions et guides précités sur ces liens :
Anissa CHAGHAL
Passée un peu sous les radars, la loi de finances rectificative portant réforme des retraites du 14 avril 2023 est venue modifier le régime social et fiscal des indemnités de rupture conventionnelle individuelle intervenant à compter du 1er septembre 2023.
Aujourd’hui, lorsque l’employeur négocie avec l’un de ses salariés une rupture conventionnelle, l’indemnité de rupture est soumise, pour l’employeur :
Partant du constat que le nombre de ruptures conventionnelles individuelles augmente chaque année chez les salariés âgés de plus de 50 ans, le gouvernement considère que le régime social actuel incite les employeurs à se séparer de leurs seniors.
Par ailleurs, la possibilité d’être couvert par Pôle emploi au moins jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite peut également encourager certains seniors à solliciter une telle rupture.
Afin de favoriser l’emploi des seniors et diminuer le nombre de ruptures conventionnelles en fin de carrière, le législateur entend désormais surtaxer les indemnités de rupture conventionnelle en mettant à la charge de l’employeur une contribution patronale de 30% (et non plus un forfait social de 20%) sur les indemnités de rupture versées au salarié, et ce quelque soit l’âge de ce dernier.
Cette nouvelle mesure sera effective « aux indemnités versées à l’occasion des ruptures de contrat de travail intervenant à compter du 1er septembre 2023 ».
Il convient donc de retenir la date de la rupture du contrat de travail (avant ou après le 1er septembre 2023) et non la date de versement des indemnités, pour déterminer l’application ou non de ce nouveau régime.
Cette réforme n’est pas sans conséquence puisqu’elle concerne toutes les ruptures conventionnelles qu’elles soient conclues avec des salariés en fin de carrière ou pas. Elle a un impact direct sur les possibilités de rupture du contrat de travail amiable et l’engouement des employeurs comme des salariés pour la rupture conventionnelle.
En parallèle, le régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle ne variera désormais plus selon que le salarié est en droit ou non de prétendre à une pension de retraite de base.
Ainsi, quel que soit l’âge du salarié, l’indemnité de rupture conventionnelle inférieure à 10 PASS (soit 439 920€ en 2023) sera exonérée :
Exemple : un salarié perçoit une indemnité de rupture conventionnelle de 150.000€ correspondant au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
L’indemnité sera totalement exonérée d’impôts pour le salarié si ce dernier n’est pas en droit de prétendre à une pension de retraite de base au moment de la rupture.
Pour les cotisations de sécurité sociale : le montant assujetti à cotisations est de 150.000€ - 87984€ = 62 016€
Pour la CSG et la CRDS, comme l’indemnité conventionnelle est supérieure à la part exclue de l’assiette de cotisations de sécurité sociale, c’est cette dernière limite qui s’applique. Le montant assujetti à CSG-CRDS sera de 62 016€
L’employeur devra, quant à lui, verser une contribution spécifique de 30% sur la fraction de l’indemnité exonérée de cotisations, soit du 1er euro jusqu’à 87 984€ = 26 395.2 €
Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif du régime social et fiscal des indemnités de rupture conventionnelle avant/après le 1er septembre 2023.
|
Régime social et fiscal de l’indemnité de rupture conventionnelle individuelle |
||
|
Cotisations/impôts sur le revenu |
Régime jusqu’au 31/08/23 |
Régime à compter du 01/10/23 |
|
Salarié n’ayant pas un droit à une pension de retraite de base |
||
|
Impôts sur le revenu
|
Non soumise à l’IR dans la limite la plus élevée entre : - 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail ou 50 % du montant de l’indemnité si cette valeur est supérieure (dans la limite de 263 952 euros, soit 6 PASS) - ou le montant de l’indemnité de licenciement conventionnelle ou légale |
|
|
Cotisations sociales |
Exonérée pour sa fraction imposable dans la limite de 87 984 euros (soit 2 PASS) |
|
|
CSG et CRDS |
Exonérée (sans abattement d’assiette) pour sa fraction exonérée de cotisations sociales dans la limite de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement |
|
|
Contributions patronales |
Forfait social de 20% sur la fraction exonérée de cotisations sociales |
30 % sur la fraction exonérée de cotisations sociales |
|
Salarié ayant droit à une pension de retraite de base |
||
|
Impôts sur le revenu
|
Soumise à l’IR dès le premier euro |
|
|
Cotisations sociales |
Soumise à cotisations sociales dès le premier euro |
Exonérée à hauteur de la fraction imposable calculée comme pour le salarié n’ayant pas droit à une pension de retraite de base, dans la limite de 87 984 euros (soit 2 PASS) |
|
CSG et CRDS |
Soumise à CSG/CRDS dès le premier euro |
Exonérée (sans abattement d’assiette) pour sa fraction exonérée de cotisations sociales dans la limite de l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle |
|
Contributions patronales |
Aucune |
30 % sur la fraction exonérée de cotisations sociales |
Source : L. n° 2023-270, 14 avr. 2023, art. 4 : JO, 15 avr
Anne-Lise Massard
C’est la loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesure d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, parue au Journal Officiel du 22 décembre qui est à l’origine de la présomption de démission en cas d’abandon de poste.
Le 18 avril 2023, le décret n°2023-275 du 17 avril 2023 sur la mise en œuvre de la présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire d’un salarié a enfin été publié.
Désormais, le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai (L. 1237-1-1 du Code du travail).
NB : Il paraît difficile d’imaginer qu’un salarié absent pourrait se voir remettre une mise en demeure en main propre par son employeur.
Le décret du 17 avril 2023 en son nouvel article R. 1237-13 précise que :
Le terme « notamment » signifie que cette liste de motif n’est pas exhaustive. A l’avenir, le contentieux nous dira si d’autres motifs peuvent être considérés comme légitimes, et ainsi faire obstacle à la présomption de démission…
A défaut de réponse dans le délai laissé par l’employeur (quinze jours minimum), le salarié est présumé démissionnaire. Ce qui entraîne la privation du bénéfice de l’allocation chômage.
L’article L. 1237-1-1 du Code du travail énonce que le salarié a la possibilité de contester la rupture de son contrat de travail sur le fondement de la présomption de démission en saisissant le conseil de prud’hommes. Le texte prévoit une saisine directement devant le bureau de jugement avec une décision dans un délai d’un mois à compter de cette saisine, ce qui, en réalité est impossible...
Cette possibilité de contestation peut permettre de démontrer que l’abandon de poste était justifié. A titre d’exemple, le salarié peut faire valoir qu’il ne pouvait pas informer son employeur car il était hospitalisé. Dans cette hypothèse, la présomption de démission pourrait être renversée.
Par ailleurs, le texte indique que la procédure s’applique si l’employeur « entend faire valoir la présomption de démission ». A priori, l’employeur n’aurait donc pas d’obligation de mettre en demeure le salarié qui se trouverait en abandon de poste.
Pour autant, d’après le Questions-Réponses publié le 18 avril 2023 par le gouvernement, en cas d’abandon de poste :
« L’employeur conserve le salarié dans ses effectifs. Le contrat de travail du salarié n’est pas rompu mais seulement suspendu ; la rémunération du salarié n’est donc pas due.
A contrario, si l’employeur désire mettre fin à la relation de travail avec le salarié qui a abandonné son poste, il doit mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et de présomption de démission. Il n’a plus vocation à engager une procédure de licenciement pour faute. ».
A la suite de la publication de ce Questions-Réponses ayant suscité de nombreuses réactions soulignant un manque de clarté quant à la possibilité ou non pour l’employeur de choisir de mettre en œuvre une procédure de licenciement pour faute en cas d’abandon de poste, le Ministère du Travail avait apporté une première précision supplémentaire en indiquant :
« Si une mise en demeure est effectuée à la suite d’un constat d’un abandon de poste et qu’aucun motif légitime n’est apporté par le salarié concerné, si l’employeur souhaite se séparer de son salarié, ce dernier n’a désormais pas d’autre choix que de déclarer le salarié comme démissionnaire. Il ne peut en revanche pas utiliser le licenciement pour faute. Le choix de la procédure à appliquer poserait en effet un problème d’égalité devant les charges publiques. En revanche, l’employeur n’est pas forcément tenu de mettre en demeure le salarié et de s’en séparer. »
Restait alors en suspens la question de savoir si le Ministère entendait exclure tout licenciement disciplinaire en cas d’abandon de poste.
Le Ministère du travail avait alors clarifié sa position en précisant que :
« Si la rupture de contrat est motivée par l’abandon de poste, l’employeur est obligé de mettre en demeure et d’attendre un délai de 15 jours. Pour constater un abandon de poste, l’employeur est [tenu] aujourd’hui d’effectuer cette procédure. L’employeur ne peut désormais plus utiliser l’abandon de poste comme un fait motivant une faute grave ou lourde. »
Cette réponse semblait correspondre à l’esprit de la loi de considérer un salarié qui ne se présente pas au travail comme démissionnaire et donc de le priver du bénéfice des allocations chômage.
Or, le Questions-Réponses a depuis été retiré du site du Ministère du Travail à la suite de l’incertitude soulevée par celui-ci et aux contentieux portés devant le Conseil d’Etat pour demander son annulation.
Pour autant, restent en suspens la question de la valeur de la FAQ (désormais supprimée) et des précisions du ministère. Ces règles sont-elles impératives ?
En principe, non. Les Questions-Réponses de l’administration n’ont pas de caractère impératif ou normatif, il s’agit d’interprétations de textes légaux ou règlementaires. Toutefois, il n’est pas impossible dans les contentieux futurs que les juges s’appuient sur ces préconisations pour motiver leurs décisions.
Un certain nombre de problématiques reste non résolu.
Est-il possible pour l’employeur qui ne souhaitant pas se prévaloir d’une démission, procède à un licenciement disciplinaire pour abandon de poste ?
Qu’en est-il pour les cas où la convention collective impose au salarié souhaitant démissionner de produire un écrit ?
A priori, la démission du salarié ayant abandonné son poste n’a pas à être formalisée. À cet égard, l’administration recommande aux partenaires sociaux « de mettre à jour les conventions collectives afin de prévoir explicitement que l’exigence d’une démission exprimée par écrit ne s’applique pas dans le cadre de la présomption de démission ».
Reste également en suspens la question du préavis.
En effet, en cas de démission, un salarié est censé effectuer un préavis. Ainsi, l’employeur pourrait donc en présence d’un abandon de poste qualifié de démission solliciter le remboursement des mois de préavis qui auraient dû être effectués par le salarié.
Ce risque pourrait donc être de nature à limiter les velléités de contestation des salariés, qui souhaiteraient éviter une demande d’indemnisation du préavis de la part de l’employeur…
Les contentieux à venir permettront, nous l’espérons, de répondre à ces interrogations.
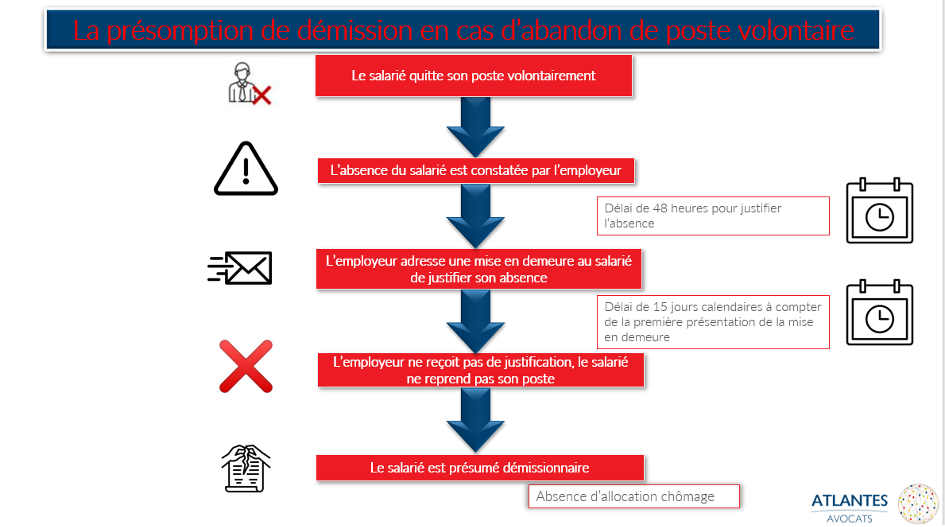
L’exercice d’un mandat a nécessairement des conséquences sur l’activité professionnelle, il est, ainsi, crucial, tant pour les représentants du personnel que pour l’employeur de pouvoir discuter, en amont, de l’articulation entre les deux.
A ce titre, le législateur a prévu « l’entretien de début de mandat » visant à prendre en compte et à valoriser le parcours professionnel des représentants du personnel.
L’entretien de début de mandat est, néanmoins, conditionnel puisque sa tenue suppose une demande préalable du salarié. La loi ne prévoit aucune obligation d’information des représentants du personnel par l’employeur de l’existence de ce droit. Cela explique, en partie, les raisons pour lesquelles ce dispositif reste encore largement méconnu, alors même que ce dernier est prévu par le code du travail et fait partie des dispositions d’ordre public.
Qui est concerné par ce droit à entretien ?
A la lecture de l’article L2141-5 du code du travail, seuls sont concernés le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical, et le titulaire d’un mandat syndical incluant, ainsi, le RSS, le RS au CSE ou au CSE central. L’examen des débats parlementaires permet également de considérer que la notion de « titulaire de mandat syndical » ne se limite pas aux mandats au sein de l’entreprise, et doit s’étendre aux conseillers prud’homaux, les conseillers du salarié, les défenseurs syndicaux ainsi que les administrateurs de caisses de sécurité sociale, de retraite, et des allocations familiales.
[ Nous vous invitons à étendre ce dispositif aux membres suppléants du CSE par accord d’entreprise ou via le règlement intérieur du comité. Les suppléants pouvant être amenés à remplacer un titulaire, il serait, en effet, souhaitable qu’ils puissent bénéficier également d’un tel entretien. De la même façon, il pourrait être utile de l’étendre aux représentants de proximité dans les entreprises qui en sont dotées. ]
A quel moment solliciter cet entretien ?
La loi est muette sur ce point. A défaut de dispositions conventionnelles, le sujet mériterait d’être abordé lors de la première réunion CSE organisée post-élections.
L’idée étant d’interroger l’employeur sur les modalités concrètes d’organisation des entretiens de début de mandat (Qui, Quand ? Comment ?..).
[Il peut être opportun de laisser passer un peu de temps après le début de la mandature avant d’organiser ces entretiens. Cela permettra aux représentants du personnel concernés par ce droit d’avoir une idée de ce que leur mandat implique et du temps que cela peut leur prendre…]
Qui peut assister à cet entretien ?
Du côté du salarié, la loi prévoit qu’il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Du côté de l’employeur, c’est bien souvent le DRH qui mène l’entretien. Toutefois, le manager du salarié devrait être présent à l’entretien. Sa présence devrait même être rendue obligatoire, compte tenu des préjugés de certains managers sur les représentants du personnel.
Quel est l’objet de l’entretien ?
Pour éviter toute difficulté découlant des absences du salarié à son poste de travail du fait de l’exercice de son mandat, le salarié est invité à discuter des mesures tendant à l’adaptation/l’aménagement de sa charge de travail durant les périodes d’absences. A titre d’exemple, on peut citer les mesures suivantes : le remplacement du salarié absent, la redistribution des tâches, l’adaptation des objectifs notamment si ces derniers permettent de déterminer la rémunération variable, l’aménagement des horaires de travail… Il conviendrait de veiller à ce que l’adaptation de la charge de travail soit accompagnée d’une information du manager et des collègues de travail du salarié. En effet, il ne s’agirait pas que les absences du représentant du personnel entrainent une surcharge de travail pour ses collègues.
Cela peut également être l’occasion de faire un point sur la liberté de circulation dans l’entreprise, la liberté d’expression, la prise des heures de délégation... Cet entretien ne doit pas permettre à l’employeur d’exercer une quelconque pression sur le salarié nouvellement élu ou désigné. De telles pratiques pourraient être considérées comme une entrave à l’exercice du mandat pouvant également constituer une discrimination.
[Les parties sont invitées à rédiger un compte-rendu de l’entretien afin d’acter les mesures prises pour permettre au salarié d’exercer sereinement son mandat et de le concilier avec son activité professionnelle.]
Anne-Lise Massard- Juriste référent régional Ouest
Jusqu’où va la protection de l’exercice du droit de grève ? La Cour de cassation y apporte une précision intéressante -et brûlante d’actualité- dans un arrêt du 23 novembre 2022 (n°21-19.722).
La protection du droit de grève découle de l’alinéa 7 du préambule de la constitution de 1946 et des engagements nationaux ratifiés par la France1. Elle se traduit dans le code du travail aux articles L. 1132-2 et L. 2511-1, ce dernier disposant que :
« L’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
(…) Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit. »
La jurisprudence de la Cour de cassation considère de longue date que la protection instituée par ces articles empêche non seulement de licencier un salarié en raison de sa participation à une grève, mais encore en raison des faits qu’il a commis pendant cette grève, tant que ceux-ci participent de son exercice normal.
Relevons d’emblée que de tels faits, insusceptibles de sanction s’ils relèvent de l’exercice du droit de grève, pourraient en revanche constituer une faute (grave) dans le cadre de l’exécution normale du contrat de travail.
Mais qu’en est-il du salarié qui incite ses collègues à faire grève non pas pendant, mais avant le début d’une grève ?
C’est à cette question que la Cour de cassation répond dans son arrêt du 23 novembre 2022 (n° 21-19.722).
L’espèce porte sur un salarié occupant des fonctions de « responsable de produit », qui est licencié en 2016, pour faute grave.
Entre autres motifs, la lettre de licenciement énonce :
« Vous êtes passé à une véritable intention de nuire à notre société en incitant les membres de votre équipe à faire grève. Ainsi, le 9 février dernier, nous avons appris que vous aviez, le 10 décembre 2015, […] contacté les membres de votre équipe …] pour leur faire part de votre intention de vous mettre en grève dès le lendemain et, en ce qui concerne un collaborateur, pour l’inciter à faire de même. »
Le salarié conteste la validité de son licenciement devant le conseil de prud’hommes, considérant que les termes de la lettre de licenciement caractérisent une atteinte illicite à l’exercice du droit de grève.
Toutefois les juges du fond ne suivent pas cet argument.
En résumé, la Cour d’appel de Paris3 considère que la règle interdisant le licenciement d’un salarié en raison de faits commis au cours de la grève n’avait pas vocation à s’appliquer, puisqu’au moment où le salarié incitait ses collègues à faire grève, celle-ci n’était pas encore commencée.
Bien heureusement, la Cour de cassation censure cette position.
Elle juge de façon très claire que :
« la lettre de licenciement reprochait au salarié d’avoir tenté d’inciter les membres de son équipe à mener une action de grève en réponse au refus de la direction d’engager du personnel supplémentaire, ce dont il résultait que les faits reprochés avaient été commis à l’occasion de l’exercice du droit de grève ».
En d’autres termes, inciter à faire grève constitue déjà un acte relevant de l’exercice de la grève, pour lequel le salarié ne peut être sanctionné.
Un licenciement sur ce fondement est nul.
Cette solution est parfaitement logique puisqu’elle assure l’effectivité du droit de grève.
Il se concevrait mal, en effet, que le fait d’être en grève soit protégé mais que le fait d’appeler à la grève ne le soit pas.
L’on peut se demander si la solution aurait été la même dans l’hypothèse où le salarié aurait appelé à une cessation collective du travail qui ne répondait pas à la définition juridique la « grève » (ex : absence de revendications professionnelles, « grève politique »).
Notons enfin que dans l’espèce soumise aux juges, de très nombreux autres griefs étaient formulés à l’encontre du salarié.
Le licenciement aurait peut-être trouvé une cause réelle et sérieuse si l’employeur s’était contenté d’invoquer ces autres griefs. Mais ces motifs ne devraient en principe, jamais être examinés par les juges, conformément à la jurisprudence dite du motif « contaminant » : le simple fait d’avoir invoqué le motif illicite relatif à l’exercice du droit de grève suffit, à lui seul, à entraîner la nullité du licenciement6.
Victor Colombani
Avocat
Les travailleurs en ESAT ne relèvent pas du Code du travail mais bien du Code de l’action sociale et des familles, un statut qui ne leur permet pas de jouir des mêmes droits que les salariés de droit privé.
Un salarié qui conclut un contrat de travail, bénéficie des dispositions du Code du travail, il s’engage à occuper un poste de travail en contrepartie duquel, il perçoit une rémunération.
Un travailleur en ESAT conclut un contrat de soutien et d’aide par le travail, après décision favorable de la CDAPH[1], ce contrat précise à la fois les activités professionnelles mais aussi les modalités de mise en place d’un soutien médico-social ou éducatif.
Un décret publié en décembre 2022[2] renforce les droits de ces travailleurs pour se calquer davantage sur ceux des salariés de droit privé et fixe des règles pour faciliter l’intégration de ces personnes en milieu ordinaire. Toutes ces nouvelles modalités étant applicables depuis le 1er janvier 2023.
Il est désormais prévu la possibilité de prendre le congé annuel de 30 jours ouvrables[3] au cours de l’année de son acquisition et un report est bien prévu en cas d’absence pour maladie, pour accident du travail ou maladie professionnelle, ou retour d’un congé de maternité ou d’adoption. Il est donc instauré un droit au repos plus accessible et flexible.
Les congés exceptionnels pour événements familiaux ont été modifiés en intégrant des nouveaux cas (congés en cas de décès d’un enfant ou d’une personne à charge effective) et en se calant sur le droit des salariés (trois jours de congés en cas de décès des parents).
Les travailleurs peuvent donc bénéficier de :
- quatre jours en cas de mariage mais aussi, désormais, de conclusion d’un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
- trois jours pour chaque naissance ou arrivée d’un enfant en vue de son adoption ;
- cinq jours pour le décès d’un enfant (sept jours dans certaines situations, notamment lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans ou s’il est lui-même parent) ;
- huit jours de congé de deuil, fractionnable et à prendre dans un délai d’un an, en cas de décès d’un enfant ou d’une personne à sa charge effective et permanente de moins de 25 ans ;
- trois jours pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire de Pacs ;
- trois jours pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;
- un jour pour le mariage d’un enfant (sans changement) ;
- deux jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap ou d’une maladie grave chez un enfant.
Les travailleurs en ESAT ont également accès à tous les congés liés à la parentalité qui sont désormais clairement identifiés par un article consacré[4] : autorisations d’absence liées à la grossesse, à l’accouchement et à la procréation médicalement assistée, ainsi qu’aux congés maternité, paternité et d’accueil de l’enfant, parental d’éducation, pour enfant malade, de présence parentale, de solidarité familiale et de proche aidant.
Le travail du dimanche est désormais bordé : la loi exige l’accord du travailleur, le bénéfice d’un repos compensateur en complément du repos hebdomadaire et une rémunération garantie « au moins égale au double de la rémunération garantie normalement pour une durée du travail équivalente ». Cette rémunération doublée est également prévue pour le 1er mai spécifiquement.[5]
Enfin, la loi consacre un droit à la représentation collective et permet la mise en place d’un délégué des travailleurs handicapés, élu tous les trois ans dans chaque ESAT. La loi prévoit que le candidat doit avoir une ancienneté d’au moins six mois. Ce dernier bénéficiera d’une formation prise en charge par l’Ésat ainsi que d’un crédit d’heures de délégation d’au plus cinq heures par mois. Le délégué des travailleurs handicapés sera chargé « de les représenter sur des situations d’ordre individuel » et sera membre de droit du conseil de la vie sociale (CVS) de l’Ésat, avec voix consultative.
Pour les problématiques santé, sécurité et conditions de travail, les travailleurs de l’Esat pourront participer à l’instance mixte composée en nombre égal de représentants des usagers et de représentants de salariés de l’établissement et service, ayant un rôle de consultation et de proposition sur la qualité de vie au travail, l’hygiène et la sécurité, ainsi que l’évaluation et la prévention des risques professionnels. Cette instance devant se réunir au moins une fois par trimestre.
ð Il est regrettable que la loi n’ait pas prévu plusieurs délégués en fonction du nombre de travailleurs, et donc de la taille de l’ESAT. Le fait de se retrouver seul pour formuler des demandes n’est pas non plus très confortable pour ce travailleur confronté à ce nouvel exercice.
Par ailleurs, la grande nouveauté est la création de cadres légaux prédéfinis facilitant l’expérimentation en milieu ordinaire. Concrètement, le travailleur en Esat aura la possibilité de :
Ø Quitter un Ésat pour le milieu ordinaire et continuer de se faire accompagner par un professionnel de l’Ésat, avec la sécurité d’être réintégré en cas de rupture de son contrat de travail (sur maximum trois ans).
Ø Travailler simultanément dans une autre structure (ordinaire ou adaptée) ou en indépendant. L’activité salariée à temps partiel pourra être exercée pour le compte de tout type de structures (entreprise, collectivité territoriale, association, entreprise adaptée personne physique, etc.) et dans le cadre de tout type de contrats de travail (dont l’alternance ou le travail temporaire).
En conclusion, la loi 3DS qui octroie de nouveaux droits aux travailleurs, à titre individuel et collectif, et qui prône la double activité et encourage à la découverte du milieu ordinaire, sécurise les parcours professionnels de ces travailleurs et c’est une bonne chose. Reste à voir si les moyens humains seront suffisants pour gérer ces accompagnements et permettre une réussite de leurs projets.
Alison VILLIERS – Juriste
Région OUEST
Pour rappel, en 2017, les ordonnances Macron créent un barème lié aux indemnités de licenciement jugé abusif (sans cause réelle et sérieuse), qui fixe un plancher et un plafond exprimés en mois de salaire brut qui dépend de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Ce barème est controversé en France notamment car il permet de d’anticiper les éventuels coûts en cas de licenciement abusif et limite les prérogatives des juges sur l’appréciation du préjudice. Ce barème est critiqué par plusieurs organisations syndicales qui estiment qu’il viole les droits des travailleurs.
Puis, récemment, la Cour de Cassation[1] a décidé de valider ce barème et les cours d’appels ne semblent plus faire résistance à l’application de ce plafonnement (contrairement à leur posture antérieure à la décision de la Cour de Cassation).
Ne reste donc plus que l’avis des cours européennes qui doivent se prononcer sur le sujet et éventuellement condamner ce barème.
Le CEDS a notamment été saisi par FO et CGT. Celui-ci a pour mission de surveiller l’application de la Charte Sociale Européenne. Cette dernière énonce les droits sociaux et économiques fondamentaux tels que le droit au travail, la protection sociale, la santé, l’éducation, ainsi que des droits spécifiques pour les groupes vulnérables, comme les enfants et les personnes âgées.
Les décisions prises par le CEDS ne sont pas contraignantes, mais elles peuvent avoir un impact sur les politiques et les pratiques des Etats en matière de droits sociaux.
En l’espèce, le débat porte sur l’application du barème Macron par rapport à l’article 24.b de la Charte sociale européenne et la convention 158 de l’Organisation Internationale du Travail.
Pour rappel, l’article 24b de la charte sociale européenne consacre « le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée ».
Or, selon le CEDS, le barème Macron prévu par l’article L. 2315-3 du Code du travail ne respecte pas ce principe en présentant quatre arguments[2] :
- La fourchette d’indemnisation n’est pas assez large ;
- Le barème constituerait une « incitation pour l’employeur à licencier abusivement des salariés » en permettant aux employeurs de faire « une estimation réaliste de la charge financière que représenterait pour eux un licenciement injustifié sur la base d’une analyse coûts-avantages » ;
- Le barème ne permet pas de prendre en compte la « situation personnelle et individuelle du salarié » ;
- Le salarié ne bénéficie pas d’une « voie de droit alternative à part entière », étant entendu que le droit commun de la responsabilité civile reçoit une application restreinte.
Le CEDS a appelé la France à revoir le barème pour garantir une indemnisation adéquate pour les salariés injustement licenciés. Le gouvernement français a réagi avec prudence à cette décision du CEDS. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a déclaré que le gouvernement français allait étudier attentivement la décision du CEDS et qu’il était prêt à travailler avec les partenaires sociaux pour trouver une solution qui soit compatible avec la Charte sociale européenne.
A noter que ce n’est pas la première fois que le CEDS juge un barème non conforme. Cela a déjà été le cas pour l’Italie[3] ainsi que pour la Finlande[4].
Pour donner suite à la précédente décision de la CEDS, la Cour de cassation a rappelé, dans le cadre de son communiqué accompagnant ses arrêts du 11 mai 2022 confirmant l’application du barème, que « les décisions que prendra ce comité ne produiront aucun effet contraignant, toutefois, les recommandations qui y seront formulées seront adressées au gouvernement français ».
Dans une nouvelle décision du 5 juillet 2022, le CEDS réitère sa position en estimant que le barème français n’est pas conforme à la Charte Sociale Européenne.
Le Comité renvoie expressément à sa précédente décision notamment en ce que les « plafonds d’indemnisation fixés par l’article L.1235-3 du code du travail ne sont pas suffisamment élevés pour réparer le préjudice subi par la victime et être dissuasifs pour l’employeur. En outre, le juge ne dispose que d’une marge de manœuvre étroite dans l’examen des circonstances individuelles des licenciements injustifiés. Pour cette raison, le préjudice réel subi par le travailleur en question, lié aux circonstances individuelles de l’affaire peuvent être prises en compte de manière inadéquate et, par conséquent, ne pas être corrigées ».
En outre, le CEDS prend note de la décision de la Cour de Cassation mais s’y oppose. En effet, il indique que la « Charte énonce des obligations de droit international qui sont juridiquement contraignantes pour les États parties et que le Comité, en tant qu’organe conventionnel, est investi de la responsabilité d’évaluer juridiquement si les dispositions de la Charte ont été appliquées de manière satisfaisante ».
Le débat n’est donc pas terminé à ce jour. Les juridictions nationales vont-elles finalement s’y opposer comme on le voit récemment dans deux décisions de Cour d’Appel[5] ? Le législateur va-t-il s’emparer du sujet ? La CJUE pourrait-elle écarter le barème ?
A suivre donc…
Audrey LIOTÉ, Juriste AURA
[1] Cass. Soc. 11 mai 2022 n°21-15.247 et 21-14.490 et Cour de cassation, chambre sociale, 1er février 2023, n° 21-21.011
[2] Décision sur le bien-fondé des réclamations n° 160/2018 et n° 171/2018
[3] Décision no 158/2017 du 11 septembre 2019, CGIL C. Italie
[4] Décision no 2016/2016 du 8 septembre 2016, Finnish Society of Social Rights C. Finlande
[5] Cour d’appel Grenoble 16 mars 2023 n°21/02048 et cour d’appel de Douai 21 octobre 2022 n°1736/22
Le litige concerne la contestation de la rupture de son contrat de travail par un salarié ayant été promu Directeur puis licencié pour insuffisance professionnelle par son employeur.
Ce dernier lui reproche en partie son comportement critique et son refus de partager les valeurs de la société, notamment la valeur « fun and pro ». Celles-ci consistent notamment à la participation à la célébration des succès, générant une consommation d’alcool excessive des participants, encouragés par les associés du cabinet de conseil et entraînant divers excès et dérapages.
La Cour de cassation est venue rappeler que, sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression. Le caractère illicite du motif de licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Chambre sociale selon laquelle le licenciement prononcé par l’employeur pour un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression est nul (Cass. soc. 22-6-2004 n°02-42.446 ; Cass. soc. 16-2-2022 n°19-17.871).
L’arrêt vient donc réaffirmer le principe de liberté d’expression, liberté fondamentale permettant à un salarié d’exprimer son opinion vis-à-vis des pratiques de son entreprise.
Cette jurisprudence s’inscrit d’ailleurs dans la continuité d’une autre décision rendue quelques mois auparavant (Cass. soc., 29 juin 2022, no 20-16.060)[1].
Le message de la Cour de cassation semble clair, en vertu de leur liberté d’expression, les salariés peuvent exprimer librement leurs opinions sur leur Direction sans que cela ne puisse constituer un motif de licenciement !
Rappelons tout de même qu’il existe une limite à l’exercice de cette liberté d’expression : l’abus de droit. Sont reconnus comme abusifs, les propos injurieux, diffamatoire, ou excessifs (Cass. soc., 9 nov. 2004, n°02-45.830[2] ; Cass. soc., 7 oct. 1997, no 93-41.747[3]). Ainsi, sauf abus, il ne peut être apporté à la liberté d’expression des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (Cass. soc., 24-11-21, n°19-20.400[4]).
Enfin, l’arrêt met également en exergue un principe constant de la Chambre sociale selon lequel : en cas de pluralité de motifs de licenciement, si un seul est susceptible d’entraîner l’annulation, alors la nullité du licenciement doit être prononcée (Cass. Soc., 8 juill. 2009, no 08-40.13)[5].
En conclusion, en réaffirmant la liberté d’expression comme une liberté fondamentale, l’arrêt admet qu’elle puisse permettre la critique des valeurs de l’entreprise au même titre que la possibilité pour le salarié d’exprimer une opinion et de tenir des propos sur l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise, dès lors que ce dernier ne tient aucun propos abusif, injurieux ou diffamatoire.
Abdou-Paul BOUSSO / Juriste IDF
[1]Le salarié avait adressé une lettre au président du directoire du groupe, pour dénoncer la gestion désastreuse de la filiale roumaine tant sur le terrain économique et financier qu’en termes d’infractions graves et renouvelées à la législation sur le droit du travail. La Cour d’appel avait exactement retenu que les termes employés n’étaient ni injurieux, ni excessifs, diffamatoires à l’endroit de l’employeur et du supérieur hiérarchique.
[2] Dans ce cas, la salariée concernée avait qualifié son directeur d’agence de « nul et incompétent » et les charges de gestion de « bœufs ».
[3] Une salariée d’un cabinet médical avait déclaré en public qu’un docteur ne prenait pas les mesures nécessaires à la stérilisation des aiguilles qu’il utilisait. Il avait été retenu l’existence d’une violation de l’obligation de discrétion et d’une volonté délibérée de nuire à la réputation de l’employeur.
[4] Cette décision vise l’article L. 1121-1 du Code du travail selon lequel « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. ».
[5] Dans ce cas parmi les motifs de licenciement, était reproché la participation à une grève.
Expression du droit de participation des agents à la détermination des règles individuelles et collectives qui les concernent, les élections professionnelles dans la fonction publique se sont tenues du 1er au 8 décembre 2022. A cette occasion, ce sont près de 5,6 millions d’agents publics qui ont été appelés à se rendre aux urnes afin de renouveler près de… 20 000 instances !
Ces élections qui interviennent tous les quatre ans sont donc d’une importance particulière pour l’ensemble des versants de la fonction publique.
A cette occasion, nous vous proposons de faire le point sur certains enjeux fondamentaux liés au renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
Les élections professionnelles dans la fonction publique sont en premier lieu l’occasion de mesurer la représentativité des organisations syndicales à tous les niveaux du dialogue social.
Cet enjeu est d’autant plus important que la négociation collective a été introduite dans la fonction publique depuis l’ordonnance du 17 février 2021. Désormais, les organisations syndicales représentatives peuvent en effet participer à la négociation en vue de la conclusion d’un accord collectif.
Or, la capacité pour une organisation syndicale à négocier un accord collectif avec l’administration est appréciée à l’aune des résultats aux élections professionnelles au niveau duquel l’accord est négocié, la condition de représentativité étant subordonnée à la disposition d’au moins un siège au sein d’une instance de représentation du personnel.
Ex : Au niveau d’un hôpital, ne pourront participer à la négociation que les organisations syndicales qui disposent d’au moins un membre élu au sein du CSE.
La mesure de la représentativité des organisations syndicales devient d’une importance d’autant plus grande que les futurs élus vont potentiellement être amenés à avoir un impact encore plus direct sur la réalité de l’organisation et des conditions de travail des agents au moyen de la négociation d’accords collectifs.
Ø Une Organisation Syndicale est représentative dès lors qu’elle dispose d’au moins un siège au sein d’un Comité social
La loi de transformation de la fonction publique de 2019 avait pour ambition de rapprocher le modèle de représentation du personnel existant dans la fonction publique de celui existant depuis 2017 dans le secteur privé.
Cette volonté de simplification et de rénovation du dialogue social passe par la création d’une nouvelle instance de dialogue social qui remplace les anciens Comités Techniques et Comités d’Hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Lors des élections du mois de décembre, les agents publics ont voté pour élire les membres des Comités Sociaux qui se substituent à ces deux anciennes instances.
Il convient de relever que le Comité Social prend un nom spécifique selon le versant de la fonction publique qui est concerné :
- Comité Social d’Administration (CSA) dans la fonction publique d’Etat ;
- Comité Social Territorial (CST) dans la fonction publique territoriale ;
- Comité Social d’Etablissement (CSE) dans la fonction publique hospitalière.
Cette nouvelle instance dispose donc de compétences particulièrement étendues, accroissant d’autant la charge de travail ainsi que les responsabilités des futurs élus.
Or, le bilan que l’on peut tirer du passage en Comité Social Economique dans le secteur privé n’est pas flatteur : entre éloignement du terrain et manque de moyens, la simplification rime avec dévalorisation et démotivation.
Depuis le 1er janvier 2020, les CAP ont vu leurs compétences restreintes aux seules décisions individuelles défavorables, se réunissant en Conseil de discipline pour émettre un avis sur la situation de l’agent concerné. De la même manière, les CCP ont également vu leurs compétences être bornées aux seules décisions individuelles défavorables.
L’évolution des CAP se poursuit avec leur réorganisation, depuis le 1er janvier 2022, par catégorie hiérarchique (A, B ou C), à l’exception du versant hospitalier qui conserve une particularité tenant à certaines filières spécifiques (soignants, personnel technique, etc.).
Bien que voyant leurs compétences se restreindre, ces instances continuent de jouer un rôle absolument déterminant dans le cadre des procédures disciplinaires les plus graves, ce qui justifie de leur accorder une attention forte à l’occasion du processus électoral.
Les élections qui viennent de s’achever revêtent donc, au regard des mutations profondes qui traversent la fonction publique, une importance toute particulière.
Il est fondamental que les agents et leurs représentants se préparent au mieux aux bouleversements auxquels la fonction publique est amenée à être confrontée dans le prolongement de la loi de transformation de 2019.
Nos équipes sont à vos côtés pour vous accompagner face à ces mutations.
Franck CARPENTIER, avocat
Il résulte de l’arrêté du 9 décembre 2022 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2023 (publié au JO du 16 décembre 2022) que le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est en 2023 de : 3 666 euros.
Il en découle que le CSE bénéficie d’une tolérance pour les cadeaux et bons cadeaux distribués aux salariés et dont le montant par salarié ne dépasse pas 5% du PMSS soit 183 € par année ou par évènement
Frédéric PAPOT
Comme la chaîne de prêt-à-porter Camaïeu, placée en liquidation fin septembre Go Sport est une filiale du groupe Hermione, People and Brands (HPB).
Des procédures d’alerte économique ont été lancées en octobre par les commissaires aux comptes et par le CSEC, les élus du CSEC ont également découvert que des remontées d’argent, pour un montant estimé à 36,3 millions d’euros, avaient été effectuées sur la trésorerie de Go Sport vers HPB.
L’expert du CSE ainsi que les commissaires aux comptes, ont présenté lundi un rapport concluant à un état de cessation de paiement.
Comme l’a indiqué Evelyn BLEDNIAK, avocat associé du cabinet à l’AFP "le tribunal a considéré que la situation était urgente, qu’il fallait agir vite"
Le tribunal sera amené à se prononcer très prochainement.
TF1
CAPITAL
Le Monde
Sud-Ouest
LSA
https://www.lsa-conso.fr/go-sport-devant-le-tribunal-de-commerce-de-grenoble,427164
Libération champagne
Zone bourse
Le parisien
BFMTV
Le Dauphiné libéré
Le Figaro
Challenges
Journal l’union
https://www.lunion.fr/id438436/article/2022-12-18/la-justice-se-penche-sur-les-finances-de-go-sport
Les Echos
Le JDD
https://www.lejdd.fr/Economie/go-sport-va-t-il-sombrer-a-son-tour-4153569
France 3
Cette procédure s’impose également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur ; sauf lorsque ces modifications mettent en œuvre une demande de l’inspection du travail. La procédure s’applique également aux notes de service ou tout autre document assimilés au règlement intérieur.
Les juges ont déjà eu l’occasion de préciser quelle est la conséquence d’un défaut de consultation. Le règlement intérieur n’est alors pas opposable aux salariés. Il en va de même lorsque la clôture de la consultation du CSE a lieu après que le règlement intérieur a été adressé à l’inspection du travail.
La consultation du CSE est donc une condition essentielle à la validité du règlement intérieur (cette condition n’est toutefois pas suffisante, la législation imposant d’autres formalités essentielles, telle la communication du texte à l’inspection du travail, après consultation du comité).
Nul doute que le CSE pourrait agir en justice pour imposer cette consultation et exiger la suspension de l’application du règlement intérieur tant que la consultation n’aura pas eu lieu. En agissant de la sorte, le CSE défend sont intérêt, son droit à être consulté sur le projet de règlement intérieur ou de modification du règlement intérieur.
Mais, un syndicat peut-il agir pour demander la suspension du règlement intérieur en l’absence de consultation du CSE ?
Une décision de la chambre sociale de la Cour de cassation donne une réponse affirmative : Un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d’une entreprise en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur des formalités substantielles tenant à la consultation des institutions représentatives du personnel.
En revanche, la même décision précise que le syndicat n’est pas recevable à demander au Tribunal judiciaire par voie d’action au fond la nullité de l’ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l’entreprise, en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur de la consultation (Cass. soc. 21 septembre 2022, n° 21-10.718).
Frédéric PAPOT
Juriste
La loi de finances rectificatives pour 2022 permet aux salariés, avec accord de l’employeur, de racheter les jours de réduction du temps de travail (RTT) non pris.
Cette mesure concerne toutes les entreprises, peu importe leur effectif.
Il est possible de racheter des jours de RTT à compter du 1/01/2022 jusqu’au 31/12/2025.
Tous les salariés sauf ceux bénéficiant d’une convention de forfait en jours sont concernés (pour ces derniers il est déjà prévu par l’article L. 3121-59 du Code du travail un dispositif de renonciation à des jours de repos).
Il peut s’agir de journées ou demi-journées mais uniquement de RTT.
Pour être précis, le Bulletin officiel de sécurité sociale (BOSS) indique que les jours de repos concernés sont ceux acquis en application (BOSS-Exo.HS-820) :
- d’un accord de réduction du temps de travail antérieur à la loi du 20 août 2008 et toujours en vigueur ;
- ou d’un accord d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Ne sont donc pas concernés les jours de repos des salariés au forfait jour, les jours déposés sur un compte épargne-temps, les jours de repos compensateur venant en remplacement du paiement des heures supplémentaires.
Une problématique se pose concernant les jours acquis par le biais de dispositifs d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine mis en place de manière unilatérale par l’employeur. Le BOSS semble les exclure, contrairement au question/réponse du gouvernement du 27 octobre.
Voir à ce sujet la réponse à la question n°8 (https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/questions-reponses-rachat-de-jours-de-repos# : :text=Un%20salari%C3%A9%20peut%2Dil%20renoncer,et%20des%20temps%20de%20repos.)
Le salarié prend l’initiative de renoncer à ces jours de repos par tout moyen. Un écrit est toutefois fortement recommandé. Le travailleur peut faire plusieurs fois cette demande à n’importe quel moment dans l’année. Il n’y a pas de plafond de jours de repos pouvant être monétisés.
L’employeur peut accepter tout ou partie ou refuser la demande. Aucun motif n’est nécessaire. Le rachat n’est donc pas automatique et l’employeur ne peut obliger le salarié de renoncer aux RTT.
Ces jours suivent le régime des heures supplémentaires.
Ainsi, ils donnent droit à une majoration de 25%. Attention, ce taux peut être augmenté ou diminué par un accord d’entreprise ou une convention collective nationale.
En outre, ces jours donnent droit à l’exonération d’impôt sur le revenu prévu à l’article 81 quater du CGI dans la limite de 7500 € par an. Cette limite s’apprécie en prenant en compte les jours de repos monétisés ainsi que les heures supplémentaires réalisées par le salarié.
Attention, ce revenu est soumis à la CSG et CRDS et rentre dans le revenu fiscal de référence.
Audrey Lioté, Juriste AURA
Il faut tout d’abord savoir que le Code du travail interdit aux salariés de prendre leur repas dans les locaux affectés au travail (article R. 4225-19).
De plus, les dispositions diffèrent selon l’effectif de l’entreprise : + de 50 et – de 50 salariés.
A noter : ces normes ont été modifiées le 1er janvier 2020. Auparavant, les employeurs étaient dans l’obligation de mettre en place un local de restauration dès lors qu’au moins 25 salariés souhaitaient prendre leur repas sur leur lieu de travail. Dans ce cas, la direction doit maintenir ce local jusqu’au 31 décembre 2024.
· Le calcul de l’effectif : un indispensable pour connaître les dispositions applicables
Le calcul s’effectue selon les modalités de l’article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale (moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente).
Le franchissement à la hausse du seuil de 50 salariés n’est pris en compte que lorsque celui-ci a été atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives.
Dans les entreprises ayant plusieurs établissements, l’effectif est décompté par établissement.
· Dans les établissements de plus de 50 salariés : un local aménagé obligatoire (article R. 4228-22 du Code du travail)
L’employeur est dans l’obligation de mettre à disposition des salariés un local de restauration après avis du CSE.
Celui-ci doit être pourvu :
- De sièges et de tables ;
- D’un robinet d’eau potable pour 10 usagers ;
- D’un moyen de conservation ou de réfrigération ;
- D’une installation permettant de réchauffer les plats.
La direction doit assurer le nettoyage de ce local.
A noter : L’employeur ne peut se soustraire à cet impératif même en mettant en place des titres-restaurant (CE, 11 décembre 1970, n°75398).
· Dans les établissements de moins de 50 salariés : un simple emplacement (article R. 4228-23 du Code du travail)
Les textes obligent l’employeur de mettre à disposition un emplacement permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
Aucun équipement n’est prévu par les textes. Se pose donc la question de comment un salarié peut être en bonne condition de santé et sécurité sans équipement pour conserver ses aliments en période caniculaire ou réchauffer ses plats en plein hiver… Le bon sens semble donc nécessaire.
A noter : cet emplacement, après déclaration auprès de l’inspection et du médecin du travail peut être aménagé dans les locaux affectés au travail dès lors que l’activité de ces locaux ne comporte pas l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.
Audrey LIOTÉ, Juriste AURA
Ainsi, le code du travail énonce que les lavabos sont mis à disposition à raison d’un lavabo à eau potable pour dix travailleurs au plus ; la température doit être réglable (article R.4228-2 c. trav.)
Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs (art. R. 4228-8). La température de l’eau des douches est réglable. (art. R. 4228-9 c. trav.)
Lorsque des locaux sont affectés à l’hébergement de travailleurs, des lavabos à eau potable et à température réglable ainsi que des serviettes et du savon, à raison d’un lavabo pour trois personnes (art. R. 4228-33 c. trav.).
Quant à l’hydratation ; l’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour la boisson (art. R. 4225-2 c. trav.).
L’employeur est tenu de mettre gratuitement au moins une boisson non alcoolisée à disposition des travailleurs dont les conditions particulières de travail les conduisent à se désaltérer fréquemment (art. R. 4225-2 c. trav.)
L’employeur doit :
- installer des postes de distribution des boissons (eau potable fraîche et autres), à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d’hygiène
- veiller à l’entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution, à la bonne conservation des boissons et à éviter toute contamination.
(art. R. 4225-4 c. trav)
Le plus souvent, l’accès à l’eau pour s’hydrater prendra la forme de la mise à disposition d’une ou plusieurs fontaines à eau et de verres ou gobelets propres.
Frédéric PAPOT
Face à l’inflation galopante qui touche les français depuis le début de l’année 2022, le Gouvernement a porté plusieurs projets de loi visant à soutenir le pouvoir d’achat des Français.
La loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est venue instaurer un dispositif de déblocage anticipé de l’épargne salariale (qui, en temps normal, est bloquée durant 5 ans).
A cette occasion, Atlantes vous présente les principales règles qui encadrent cette mesure exceptionnelle.
Sont concernées les sommes issues de l’intéressement et de la participation lorsqu’elles ont été placées sur un plan d’épargne salariale (PEE, PEI, PEG) avant le 1er janvier 2022. L’abondement versé par l’employeur à l’occasion de l’investissement de ces sommes est également concerné.
En revanche, sont exclues du dispositif les sommes :
· Affectées à un plan d’épargne retraite quel qu’il soit (PERCO, PER, etc.) ;
· Investies dans un fonds solidaire ;
· Consacrées à l’acquisition d’actions de l’entreprise au titre de stock-options ou dans le cadre d’un plan d’épargne salariale ;
· Affectées à un compte courant bloqué géré par l’entreprise
Les entreprises disposent d’un délai de 2 mois à compter de la promulgation de la loi (soit jusqu’au 16 octobre) pour informer les salariés de l’existence de ce dispositif exceptionnel et de ses modalités de mise en œuvre. Cette information peut se faire par tout moyen (courriel, courrier recommandé, affichage, etc.).
A cette occasion, il revient à la direction de préciser les modalités que doivent respecter les salariés afin de bénéficier d’un déblocage anticipé de leur épargne salariale (demande à effectuer directement auprès de l’entreprise ou de l’organisme gestionnaire, sur un formulaire dédié ou sur papier libre, etc.).
Enfin, il convient de souligner que la demande doit impérativement être présentée avant le 31 décembre 2022. Passé cette date, le dispositif disparaîtra.
Attention : le bénéficiaire ne peut présenter qu’une seule demande dans le cadre de ce dispositif exceptionnel. Il convient donc d’être particulièrement attentif si vous souhaitez débloquer une partie de votre épargne salariale en ayant bien défini en amont le montant dont vous souhaitez recevoir le versement.
La loi précise que le montant des sommes débloquées ne peut excéder 10 000 €.
Cette somme est calculée sur les montants perçus par les salariés après déduction des prélèvements sociaux sur les revenus de placement. Les prélèvements sociaux sont à la charge du bénéficiaire.
Il convient de souligner que le déblocage anticipé n’a aucun impact sur le régime social et fiscal spécifique de la participation et de l’intéressement qui s’applique normalement.
Par principe, les salariés qui débloquent leur épargne salariale n’ont pas à justifier de l’utilisation de leur argent.
Toutefois dans le cadre de ce dispositif exceptionnel, l’administration fiscale est susceptible de contrôler l’utilisation faite par le salarié des sommes débloquées.
En effet, loi prévoit expressément que le déblocage anticipé ne peut être demandé que pour financer l’achat d’un ou de plusieurs biens ou la fourniture d’une ou de plusieurs prestations de services.
Le législateur impose ainsi aux bénéficiaires d’un déblocage anticipé de l’épargne salariale de conserver pendant trois ans les justificatifs qui attestent effectivement de l’usage des sommes débloquées.
L’administration fiscale souhaite en effet éviter que les sommes débloquées ne soient pas utilisées pour soutenir le pouvoir d’achat mais pour être en réalité réinvesties sur d’autres supports de placement supposément plus avantageux.
En pratique, il vous suffit simplement de conserver les factures des achats que vous effectuerez en vue de Noël et au fil de l’année 2023 (téléphone portable, aspirateur, frigo, télévision, console de jeux-vidéo, ordinateur, etc.).
Franck CARPENTIER,
Avocat
Abandon de poste : Dans le cadre du projet de loi de réforme de l’assurance chômage, l’Assemblée nationale a adopté un amendement proposé ce mercredi prévoyant que les salariés qui abandonnent leur poste seront considérés comme démissionnaires.
🔵 L’abandon de poste, c’est quoi ?
L’abandon de poste n’est pas un mode de rupture du contrat de travail. Le salarié est placé en absence injustifiée ce qui constitue un comportement fautif. Durant cette période le salarié ne bénéficie pas de l’ARE, ni de son salaire. Loin d’être une situation confortable.
Dans cette situation, l’employeur a la possibilité de licencier le salarié en raison de la faute commise : à savoir l’absence injustifiée. C’est une faculté.
🔵 Qu’est ce qui pourrait changer ?
Les salariés licenciés pour faute bénéficient de l’ARE ce qui n’est pas le cas pour les salariés démissionnaires. L’amendement prévoit d’assimiler le salarié qui a abandonné son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure comme étant démissionnaire.
🔵 Pourquoi ce texte pose problème ?
Il convient de noter en premier que ce texte remet en cause la jurisprudence (Cass. Soc. 21 octobre 2020, n°19-10635) pour laquelle la démission doit être claire et non équivoque. Elle ouvre de ce fait à de nombreuses interrogations juridiques.
Il convient également de rappeler qu’à ce jour il n’existe aucune mesure, aucune donnée chiffrée relative aux abandons de poste.
En outre et comme le soulève de nombreux syndicats le problème est sans doute ailleurs :
Quelles sont les raisons impliquant ces abandons ? comment prendre en compte les raisons de santé et de sécurité ? La problématique est ailleurs.
En conclusion, ce texte donne clairement l’état d’esprit du gouvernement et de la droite parlementaire quant à l’adoption de la future réforme de l’assurance chômage. La sémantique politique sera moralisatrice et pointera du doigt celles et ceux qu’elles considèrent comme oisifs.
La chasse aux sorcières est ouverte.
Maxence DEFRANCE
Juriste
Entre septembre 2020 et juin 2022, plusieurs revalorisations salariales ont été mises en œuvre pour les professionnels des secteurs privé de la santé et du médicosocial. Entre Segur de la santé, accords Laforcade et conférence des métiers, il n’est pas évident de s’y retrouver.
Pour rappel à la suite du « Ségur de la santé », le gouvernement a acté une revalorisation salariale de 183 € net par mois pour les salariés des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).
Ces revalorisations salariales ont ensuite été étendues aux salariés de nouvelles catégories d’établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), puis aux travailleurs sociaux.
Faisons le point sur ces différents mécanismes.
Fin 2020, par une décision unilatérale du 26 octobre 2020 agrée par un arrêté du 8 décembre 2020 la FEHAP (Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne privés solidaires) a mis en place une indemnité forfaitaire Ségur aux personnels des établissements de santé.
Etablissements Concernés | Professionnels concernés | Professionnels exclus | Montant et versement | ||||
|
|
|
A compter de septembre 2020 avec un versement en 2 fois :
|
Fin 2021 des négociations s’ouvrent dans le secteur privé pour transposer les revalorisations de grilles salariales entrées en vigueur au sein de la Fonction publique hospitalière.
Finalement les regroupements des syndicats employeur des secteurs (FEHAP et NEXEM) prennent deux recommandations patronales les 5 et 11 janvier 2022 agréées par un arrêté du 21 Janvier 2022.
Etablissements Concernés | Professionnels concernés | Professionnels exclus | Montant et versement |
|
|
|
A partir du 1er Janvier 2022 :
|
Face notamment à une la forte mobilisation des professionnels du secteur, les revalorisations sont étendues par les accords « Laforcade » qui se traduisent dans le secteur privé par une Recommandation patronale prise par AXESS (la confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif) le 21 décembre 2021 agréée par arrêté du 06 janvier 2022.
Etablissements Concernés | Professionnels concernés | Professionnels exclus | Montant et versement |
|
Etablissements et services tarifés par l’ARS et/ou le Conseil départemental suivants : CAJ, RA, SSIAD, établissements expérimentaux
Secteur PH Adultes : MAS, FAM, SAMSAH, ESPO, ESRP, ESAT, FH, FV, FO, SAVS, EAM, ENM Secteur PH enfants : IME, IEM, IMPRO, DITEP, SESSAD, SSEFIS, CAMSP, CMPP, EEAP
ONDAM : CSAPA, LHSS, CAARUD, LAM, ACT |
|
|
A compter du 1er novembre 2021 : Pour un salarié en temps plein : 238 € bruts/mois |
Suite à la conférence des métiers du social et du médico-social du 18 février 2022 le gouvernement annonce que la filière sociale éducative regroupant notamment les travailleurs sociaux sera également concernée par les revalorisations salariales. Cela se traduit par un récent accord conclu entre la confédération AXESS et la CFDT agréé le 17 juin 2022.
Etablissements Concernés | Professionnels concernés | Professionnels exclus | Montant et versement |
|
Entités accompagnant les publics vulnérables des secteurs suivants :
|
|
Métiers non mentionnés dans la liste |
Ces seront dues à partir du mois d’avril 2022, et versées au plus tard en juin. Pour un salarié en temps plein : 238 € bruts/mois |
Conclusion :
Si avec cette dernière vague de revalorisation quasiment tout le secteur a été couvert, il reste toujours des « oubliés du Ségur » (personnels administratifs, d’encadrement, des sièges sociaux...) par ailleurs, il n’est pas certain que ces mesures soient suffisantes pour rendre ces secteurs attractifs tant la crise du recrutement (et des vocations) qu’ils traversent semble profonde.
Justin SAILLARD-TREPPOZ, juriste, région AURA
Dans notre numéro paru en mai 2022, nous avons exposé les éléments permettant d’appréhender globalement les négociations préélectorales.
Il convient à présent de s’intéresser au protocole d’accord préélectoral (PAP) dont la négociation permet à l’employeur et aux organisations syndicales de déterminer le cadre matériel des élections.
Plus qu’une étape obligatoire dans l’organisation des élections, le PAP est un enjeu politique pouvant avoir des incidences sur la configuration et le fonctionnement du dialogue dans l’entreprise.
Contrairement aux accords d’entreprise classiques, le PAP est négocié entre l’employeur et les syndicats intéressés et non obligatoirement représentatifs, bien que ces derniers y prennent également part.
Il en résulte que les OS disposent d’une grande liberté dans le choix des personnes pouvant être mandatées.
C’est pourquoi la question de la constitution de son équipe de négociation dans la perspective d’une échéance élection révèle une importante pratique (1).
Par ailleurs, et dès lors que le temps de la négociation est assez contraint et le cadre circonscrit par rapport à l’objet des échanges, opérer des choix devient tout aussi important pour la gestion de son agenda (2), et des thèmes sur lesquels se focaliser dans ses propositions (3).
Toutefois, il est utile de prêter une attention particulière à des sujets techniques relatifs aux conditions de majorité sur lesquels reposent la validité de l’accord qui sera trouvé avec la direction de l’entreprise (4).
Le code du travail ne limite pas les organisations syndicales dans le choix des personnes qu’elles mandatent pour la négociation du PAP.
En application de l’article L. 2314-5, al. 1 du code du travail, la négociation du PAP débute par l’invitation, par tout moyen, des organisations syndicales intéressées, c’est-à-dire, celles qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise.
En revanche, les organisations syndicales :
doivent être invitées par courrier par l’intermédiaire du délégué syndical désigné[1], ou à défaut, des structures syndicales au niveau des branches ou des unions de syndicats auxquelles elles ont adhéré[2].
Dans les entreprises multi-établissements, cette invitation est envoyée au syndicat représentatif au niveau de l’entreprise et/ ou au délégué syndical central.
A priori, le syndicat peut mandater aussi bien un salarié de l’entreprise qu’une personne extérieure.
Mais attention ! Un mandat tacite est insuffisant[3], il est prudent d’adresser formellement l’identité des personnes mandatées pour négocier le PAP.
Faut-il pour autant toujours désigner les salariés de l’entreprise susceptibles de se porter sur les listes électorales comme négociateurs du PAP ?
La réponse n’est pas aussi évidente !
|
CONSEIL ATLANTES,
Le partage des rôles étant important pour les élections et le fonctionnement du dialogue social, un syndicat a intérêt de prévoir une équipe de négociation constituée autour :
Les règles de la négociation collective sont applicables au PAP, et sauf accord de l’employeur, chaque délégation ne peut dépasser le nombre de 3 ou 4 membres en fonction de l’effectif de l’entreprise.
|
Dans le cadre de la négociation du PAP, l’employeur est tenu d’une obligation d’information à l’égard des organisations syndicales intéressées.
L’article L. 2314-5 du code du travail, précise que l’invitation des OS par l’employeur doit leur parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation, les laissant très peu de temps pour constituer leur équipe de négociation.
L’employeur entame le processus électoral deux mois avant la date d’expiration des mandats, et le premier tour a lieu dans la quinzaine précédent cette date.
La négociation se déroule pendant cette période au cours de laquelle l’employeur est tenu de fournir aux syndicats participants à la négociation les éléments nécessaires au contrôle de l’effectif équivalent temps plein et de la régularité de la liste électorale.
Au regard des délais contraints pour la tenue des élections, il peut être difficile de mener sereinement les négociations sans l’élaboration d’un calendrier prévisionnel en retenant les dates importantes ci-après :
- L’expiration du mandat des élus en cours,
- Signature du protocole d’accord,
- Organisation des élections, le 1er tour des élections
- Première réunion du CSE
La négociation du PAP porte sur plusieurs thèmes dont certains doivent être obligatoirement abordés (la répartition des sièges à pourvoir entre les collèges, et la fixation des modalités pratiques du vote), et d’autres relèvent de la faculté des parties.
L’attention des négociateurs doit être portée sur la clause relative à la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral en vue d’observer l’égalité femme/homme[4].
Les Parties ont toutefois la faculté de jouer sur des leviers de fonctionnement en insérant dans le PAP :
Le cas des heures de délégations, qu’il est possible d’augmenter mécaniquement pour chaque membre du CSE, en réduisant le nombre d’élus au CSE, parait une hypothèse pragmatique de la portée des clauses facultatives.
|
CONSEIL ATLANTES,
Il est important de déterminer ses choix sur le plan organisationnel après un état des lieux des quatre dernières années, pour fixer les priorités de équipes sur les thèmes de négociation.
Ainsi, dans l’exercice de leur droit à l’information, les négociateurs (avec l’appui du délégué syndical), peuvent effectuer un travail préparatoire et de remise en perspective des accords d’entreprises relatifs à l’exercice du droit syndical ainsi que des textes applicables au CSE.
|
La conclusion d’un PAP est soumise à une double majorité de signature[7] :
Que signifie la majorité ?
La circulaire DGT 2011-6 du 27 juillet 2011, précise que pour obtenir la majorité, il faut recueillir au moins plus de la moitié.
Quel syndicat (s) compte dans le calcul de la majorité ?
Le simple fait de participer à la première réunion suffit pour être qualifié de syndicat intéressé, et par conséquence, d’être comptabilisé pour le calcul de la majorité des signataires[8].
En l’absence de syndicat représentatifs dans l’entreprise, seule la condition relative à la signature par la majorité des syndicats intéressés ayant participé à la négociation s’applique.
Attention !
Il convient de retraiter les pourcentages en présence des syndicats catégoriels comme la CFE-CGC, syndicat catégoriel pour lequel le calcul est effectué à partir des suffrages exprimés en sa faveur à l’ensemble des suffrages exprimés au niveau de l’ensemble de l’entreprise[9].
[1] Cass. Soc. 13 février 2003, n°01-60813, BC V n°56 ; Cass. Soc. 5 avril 2011, n°10-18813 D
[2] Cass. ass. Plén. 5 juillet 2002, n°00-60275, B. ass. Plén. n° 2
[3] Cass soc 17 avril 1991, n°89-61556
[4] Art. L 2314-13 du code du travail
[5] Art. L2314-7 du code du travail
[6] Favorables aux salariés par rapport à ce que prévoit la loi ou la convention collective
[7] Article L 2314-6 du code du travail
[8] Cass. Soc. 26 septembre 2021, n°11-60231
[9] Cass. Soc. 16 janv. 2008, n°07-60163
L’arrivée des fortes chaleurs à venir est accompagnée de son lot annuel d’interrogations : puis-je adapter ma tenue en conséquence ? L’employeur doit-il veiller à la température dans les locaux ? Doit-il fournir de l’eau gratuitement au personnel ? Notre sélection des questions les plus fréquentes.
La réponse dépend de ce qui a été décidé au niveau de l’entreprise.
L’employeur peut apporter des limites à la liberté de se vêtir :
A titre d’exemple, les juges ont validé les licenciements de salariés qui portaient : bermudas, tongs, jogging, parce alors qu’ils étaient en contact avec la clientèle. En résumé, si l’employeur peut démontrer en quoi porter un short ou des tongs nuit à l’image de l’entreprise, ou ne répond pas aux impératifs de sécurité, il peut interdire à ses collaborateurs de les porter au travail.
Conseil : à défaut de prendre des initiatives unilatérales et de risquer une sanction disciplinaire, nous vous invitons à porter ces sujets sur un ordre du jour d’une réunion du CSE, afin de pouvoir négocier des mesures exceptionnelles en matière de tenue vestimentaire pendant ces périodes de fortes chaleurs. Il est également judicieux de vérifier ce qui a été prévu au sein du règlement intérieur de l’entreprise.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, le Code du travail ne prévoit pas de dispositions concernant la température maximale ou minimale sur poste de travail.
La norme NF X35-203/ISO 7730 relative au confort thermique, non actualisée depuis 2006, précise les seuils suivants :
- dans les bureaux : 20 à 22 °C ;
- dans les ateliers pour une activité physique moyenne (travail debout sur machine par exemple) : 16 à 18 °C ;
- dans les ateliers pour une activité physique soutenue (manutention manuelle par exemple) : 14 à 16 °C.
Il est à noter que l’INRS (Institut national de recherche et de sécurité) considère qu’au-delà de 30 °C pour un salarié sédentaire, et 28°C pour un travail nécessitant une activité physique, la chaleur peut constituer un risque pour la santé des salariés.
Rappelons que l’employeur est investi d’une obligation générale de santé et de sécurité à l’attention du personnel. Cette obligation lui impose de prendre toutes « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » (C. trav., art. L. 4121-1).
L’employeur a donc intérêt, si la température surpasse les limites précitées par l’INRS, à agir sans délai pour assurer la sécurité des salariés, en y intégrant les conditions de températures.
Conseil : Que peut faire le CSE si les températures deviennent insupportables pour les salariés ?
N’hésitez pas à alerter immédiatement l’employeur si les températures dépassent les 30 ou 28 C° précités, afin qu’il puisse prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés :
De façon générale, en dehors des épisodes de fortes chaleurs, l’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour la boisson (C. trav. art. R 4225-2).
De plus, lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l’employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée (C. trav. art. R4225-3).
Les boissons et les aromatisants mis à disposition sont choisis en tenant compte des souhaits exprimés par les travailleurs et après avis du médecin du travail.
Nous invitons le CSE à vérifier l’emplacement des postes de distribution des boissons, notamment leur proximité avec les postes de travail.
C’est une question qui nous est souvent posée, notamment par des représentants du personnel sursollicités par les salariés.
En ce qui concerne les principes régissant le droit de retrait, l’article L. 4131-1 du Code du travail dispose que :
« Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. »
L’article L. 4131-3 du Code du travail ajoute qu’« aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux. »
Sous réserve de l’appréciation des tribunaux, le droit de retrait pourrait être invoqué par les salariés exposés à de très fortes chaleurs. À cet égard, le Haut conseil de la santé publique a recommandé aux salariés de cesser immédiatement toute activité dès qu’apparaissent des signes de malaise et de prévenir les collègues, l’encadrement et le médecin du travail.
Du côté des tribunaux, plusieurs arrêts ont été dans le sens du salarié :
Nous invitons, avant de songer de prime abord à l’exercice du droit de retrait, d’inviter l’employeur à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la sécurité des salariés.
Anissa CHAGHAL, Juriste IDF
Comme l’illustre cette nouvelle décision de la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc. 24-11-2021 n° 20-19.040 F-D), un employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ne dispose pas de toute latitude lorsqu’un salarié par ailleurs représentant du personnel, s’oppose à un changement de ses conditions de travail.
L’attention qui doit être portée à l’égard de toute modification concernant un salarié protégé n’est pourtant pas nouvelle depuis l’arrêt Perrier du 21 juin 1974 (extrait) : « les dispositions législatives soumettant (...) à la décision conforme de l’inspecteur du travail le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, ont institué, au profit de tels salariés et dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit par suite à l’employeur de poursuivre par d’autres moyens la résiliation du contrat de travail » (Cass. ch. mixte, 21 juin 1974, n°71-91.225, Bull. civ. ch. mixte, n°2).
Un employeur ne peut imposer unilatéralement à un représentant du personnel, une modification de son contrat ou un simple changement de ses conditions de travail, sans recueillir son consentement express.
Ainsi, dans le cadre des dispositions de l’article L.2421-3 du code du travail, si l’employeur considère qu’il est dans son droit et que le refus du salarié est illégitime, il peut :
- Soit engager une procédure de licenciement en saisissant l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement après consultation du CSE,
- Soit renoncer à cette modification ou à ce changement et poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures.
Cette procédure protectrice a un objectif clair : éviter que la proposition de modification du contrat de travail ne soit animée par la volonté d’exercer des pressions sur le représentant du personnel, de le discriminer ou de s’en « séparer » via un licenciement.
Mais ne nous y trompons pas, ce statut protecteur ne consacre pas pour autant au bénéfice du représentant du personnel une immunité absolue.
En d’autres termes, refuser un changement des conditions de travail peut légitimer le licenciement pour faute d’un salarié protégé, si l’initiative de l’employeur est exempte de tout vice.
Dans cette affaire, consécutivement à la perte d’un marché de prestations de sécurité, un employeur avait décidé d’affecter un salarié à l’époque des faits délégué du personnel, sur un nouveau site en faisant jouer la clause de mobilité, manifestement prévue dans son contrat de travail.
Ce salarié avait alors signalé qu’il refuserait de s’y rendre. Son employeur constatant que celui-ci ne s’était pas présenté sur son nouveau lieu de travail décidait de suspendre sa rémunération.
Privé de sa rémunération, le salarié décidait de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et saisissait la justice considérant que la privation de sa rémunération était abusive et injustifiée.
Rappelons que la prise d’acte est une décision unilatérale prise par un salarié de rompre le contrat de travail qui le lie à son employeur. Elle est en générale motivée par un manquement grave de l’employeur qui empêche le salarié de poursuivre son contrat de travail.
Cette rupture a pour conséquences si les faits invoqués par le salarié sont reconnus par la justice, de produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mais dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.
Cette initiative et la procédure qui s’en suit n’est donc pas à prendre à la légère par tout salarié qui entendrait prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Après une première décision du Conseil de prud’homme favorable au salarié, son employeur obtenait gain de cause devant la Cour d’appel jugeant que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d’une démission. Elle le déboutait alors de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, d’indemnité pour violation du statut protecteur, de rappel de salaire pour les mois d’avril et mai 2015, de congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement nul, et de dommages et intérêts pour comportement déloyal.
La Chambre sociale de la Cour de cassation, va pourtant censurer l’arrêt rendu le 21 mars 2019 par la Cour d’appel, en rappelant les principes de droit suivants.
« Aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de
travail ne peut être imposé à un salarié protégé. En cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l’employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l’autorité administrative d’une demande d’autorisation de licenciement. Il appartient à l’employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l’inspecteur du travail n’a pas autorisé son licenciement.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le changement de site d’affectation décidé par l’employeur à compter du 7 avril 2015 avait été refusé par le salarié, titulaire d’un mandat de délégué du personnel, et que l’inspecteur du travail n’avait pas autorisé le licenciement de ce dernier à la suite de ce refus, ce dont elle aurait dû déduire que l’absence de rémunération constituait un manquement grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ».
Cet arrêt entend rappeler à l’instar pourtant de nombreuses jurisprudences qui l’ont précédé, qu’en cas de refus d’un changement des conditions de travail d’un salarié exerçant un mandat de représentant du personnel, l’employeur n’a d’autres solutions que de soit renoncer à la modification envisagée, soit saisir l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement.
Toute autre voie l’expose à une condamnation.
Aurélien LADUREEE
Juriste référent IDF
Certains salariés seront amenés à travailler lors des prochains scrutins qui doivent se tenir les dimanches 10 et 24 avril 2022. Les salariés qui ne souhaitent pas voter par procuration pourront-ils se rendre à l’isoloir ?
Si le jour de repos hebdomadaire est, en principe, accordé aux salariés le dimanche (article L.3132-3 du Code du travail), Il existe toutefois des exceptions notamment sur dérogation accordée par le maire ou dans le cadre des zones touristiques et commerciales.
Pour ces situations, le Code du travail indique que « L’employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche. » (Article L.3132-25-4 et L.3132-26-1 du Code du travail).
Attention : A la lecture du texte, il convient de comprendre qu’il ne s’agit pas d’un droit à s’absenter à la convenance du salarié. Le soin est laissé, à chaque entreprise, de fixer les modalités d’organisation du travail sur cette journée afin de permettre aux salariés travaillant le dimanche de voter : changement horaires, roulement, autorisation d’absence rémunérée ou non ?
Notre conseil :
Au regard du caractère imprécis du texte, Il ne fait nul doute que le CSE devra intervenir en amont la direction sur le sujet afin de trouver clarifier l’organisation du travail mise en place.
Maxence DEFRANCE
Juriste IDF
Les modalités de prise des congés payés sont souvent sources de débat au sein des entreprises.
Par un arrêt du 2 mars 2022, la Cour de Cassation précise que le délai de prévenance pour les congés conventionnels est identique à celui des congés payés légaux, soit 1 mois.
|
Rappel A défaut de dispositions conventionnelles (accord de branche ou d’entreprise), l’employeur doit : - définir la période de prise des congés après avis du comité social et économique. - informer les salariés de la période de prise des congés, et ce, au moins 2 mois avant l’ouverture de celle-ci L’employeur ne peut pas modifier l’ordre ou les dates des congés, moins d’1 mois avant la date prévue du départ sauf circonstances exceptionnelles. Se posait la question du régime juridique des congés conventionnels et notamment des congés d’ancienneté.
|
Dans cette affaire, l’employeur, à la suite d’une grève, a imposé aux salariés non-grévistes de prendre des congés. Un syndicat a saisi le tribunal de grande instance afin de faire reconnaitre l’illicéité de cette pratique.
L’employeur soutenait que n’obéissait pas aux même règles que les congés payés principaux :
- La 5e semaine de congés payés
- Les congés d’origine conventionnelle
La cour de Cassation consacre ici un régime unique « Après avoir énoncé à bon droit qu’il n’y avait pas lieu de distinguer selon que les congés concernés relevaient de la cinquième semaine ou étaient d’origine conventionnelle, la cour d’appel, qui a constaté que l’employeur ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles et avait imposé aux salariés de prendre des congés sans respecter le délai de prévenance, a exactement décidé qu’un tel dispositif était illicite. »
On notera que dans son attendu la chambre sociale de la Cour de cassation n’ouvre la porte à aucune exception.
La Cour de Cassation le déboute de sa demande en considérant que, même s’il s’agissait de congés conventionnels, le délai de prévenance de 1 mois doit être respecté sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Toutefois la chambre sociale précise que la grève ne répond pas à la définition de circonstances exceptionnelles.
L’employeur doit donc respecter un délai de prévenance de 1 mois pour imposer les dates de congés payés légaux ou conventionnels. Il doit donc également respecter ce délai s’il souhaite modifier les dates de départ en congés.
Cass. soc., 2 mars 2022, no 20-22.261 FS-B
Audrey LIOTÉ
L’index égalité femmes hommes, dernière mesure en date de nature à appréhender et à engager des actions afin de réduire les inégalités entre les femmes et les hommes, est obligatoire dans toutes les entreprises d’au moins 50 salariés depuis le 1er mars 2020.
Ce dispositif poursuit l’objectif, comme toutes les mesures qui ont précédé, de garantir notamment que « Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes »[1].
Cet index, assorti d’une obligation de publication au plus tard le 1er mars de chaque année[2], résultent de la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel »[3] et d’un décret d’application du 8 janvier 2019[4]. Ce dispositif a été complété plus récemment par la loi du 24 décembre 2021[5] visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle et par un décret du 25 février 2022[6].
Pour rappel, 4 indicateurs (entreprise de 50 à 250 salariés) ou 5 indicateurs (pour les entreprises de plus de 250 salariés) doivent obligatoirement être renseignés.
Chaque indicateur fait l’objet d’une graduation en fonction des écarts constatés au détriment des femmes et est pondéré de 0 à 10, 15, 20, 35 voire 40 points au maximum.
L’évaluation de l’entreprise se fait au global sur 100 points.
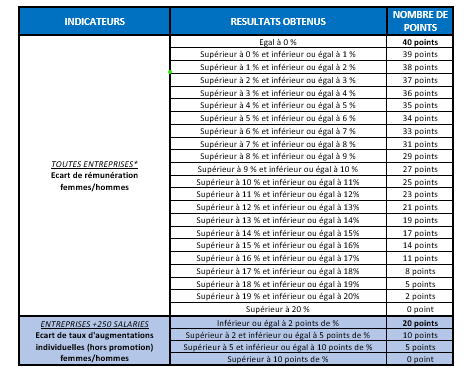
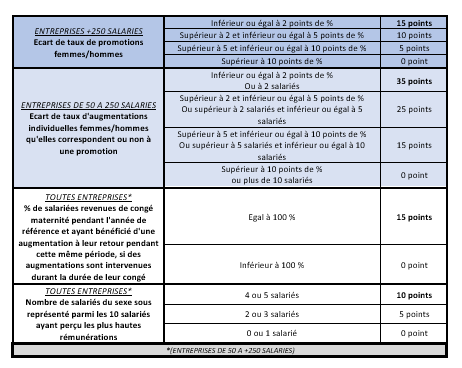
Plus les différences constatées au détriment des femmes sont importantes, plus la note de l’entreprise est faible et de nature à révéler l’existence d’inégalités qu’il importe de corriger. Cette obligation ne s’impose pourtant que si la note globale ainsi obtenue est inférieure à 75 points sur 100.
Plusieurs sujets justifient une attention particulière du CSE.
Les indicateurs sont calculés à partir des données collectées sur 12 mois consécutifs qui précédent l’année de publication. Il peut s’agir de l’année civile n-1 (1er janvier au 31 décembre de l’année), ou par exemple du 1er juin de l’année n-2 au 31 mai de l’année n-1, pour une publication au plus tard le 1er mars de l’année n. La période de référence choisie par l’entreprise ne peut d’une année sur l’autre être modifiée sauf raisons particulières et exceptionnelles[7] qu’il conviendra de justifier auprès de la DREETS.
Quand bien même l’entreprise disposerait de toute latitude pour déterminer la période de référence, l’année civile est à privilégier par le CSE. Nombre de données à caractère social figurant déjà dans la BDESE imposent une distinction entre femmes et hommes et sont arrêtées au 31/12 (évolution des emplois par catégorie professionnelle, bilan des actions comprises dans le plan de formation, conditions de travail, données relatives à l’égalité professionnelle…).
Privilégier des données arrêtées au 31/12 est donc de nature à favoriser une appréhension d’ensemble de l’égalité professionnelle, faciliter le recoupement entre les informations et plus pertinemment encore dans le cadre de la consultation du CSE au titre de la politique sociale, des conditions de travail et d’emploi relative notamment à l’égalité professionnelle.
Contrairement à la période de référence qui, par principe, n’a pas vocation à changer d’une année sur l’autre, la répartition des effectifs par catégories de postes équivalent permettant de mesurer les écarts de rémunération, d’augmentation, de promotion, peut évoluer d’une année sur l’autre[8].
Rappelons que s’agissant des catégories de postes équivalents, l’employeur peut répartir les salariés, après consultation du CSE, par niveau ou coefficient hiérarchique (en application de la classification de branche) ou d’une autre méthode de cotation des postes. La méthode de cotation des postes est adoptée après avis du CSE. Si l’employeur ne souhaite pas répartir les salariés par niveau ou coefficient hiérarchique ou selon une autre méthode de cotation des postes, ou si ces méthodes de répartition ne permettent pas de calculer un indicateur, il doit alors répartir les salariés entre les quatre catégories socioprofessionnelles suivantes : ouvriers /employés /techniciens et agents de maîtrise/ingénieurs et cadres.
Le CSE doit être éclairé sur les motivations qui conduisent à privilégier une répartition plus qu’une autre et plus encore lorsqu’il s’agit d’en changer. Le recours à un expert[9] dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi peut permettre d’objectiver ce choix, cerner plus finement encore les éventuelles inégalités qui pourraient exister et analyser d’autres informations que les seules traitées dans l’index.
Le niveau de résultat (note globale) de l’index et les résultats obtenus pour chaque indicateur[10] doivent être publiés chaque année au plus tard le 1er mars sur le site internet de l’entreprise[11] (et non pas intranet) ; à défaut d’en disposer, sur le site internet du groupe[12], à défaut communiqués aux salariés par tout moyen.
En revanche, à cette même échéance et selon la même périodicité, le CSE doit pouvoir prendre connaissance dans la BDESE du niveau de résultat de l’année précédente des 4 voire 5 indicateurs précités, selon la classification de postes équivalents retenue par l’entreprise.
Ces informations sont accompagnées de toutes les précisions utiles à leur compréhension, notamment à la méthodologie appliquée et le cas échéant des mesures de correction envisagées ou déjà mises en œuvre. Elles peuvent donc parfaitement justifier débats et questionnements en réunion de CSE.
Selon l’administration du travail, ces informations doivent être transmises au CSE avant la première réunion qui suit la publication de l’index.[13]
Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs précités, se situent en-deçà de 75 points, la négociation sur l’égalité professionnelle doit porter sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial[14].
Des objectifs de progression doivent en outre être définis (et également publiés) pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte, si la note globale de l’index est inférieure à 85 points.
En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, voire en l’absence d’organisations syndicales représentatives, celles-ci sont déterminées unilatéralement par l’employeur, après consultation du CSE[15]. L’avis motivé du CSE apparait une fois de plus essentiel et peut utilement être communiqué à la DREETS.
La décision unilatérale de l’employeur, voire l’accord collectif est déposé auprès de la DREETS qui peut alors présenter des observations au regard des mesures correctrices envisagées.
Dans tous les cas l’entreprise dispose d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité.
La DREETS occupe une place importante dans l’accompagnement des entreprises[16], dans le suivi des résultats de l’index[17] et dans le prononcé d’éventuelles sanctions.
Si à l’expiration du délai de trois ans, les résultats de l’entreprises sont toujours inférieurs à 75 points, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière fixée par la DREETS d’au maximum 1% de la masse salariale[18], au terme d‘une procédure qui laisse une large place à la concertation.
En revanche, si au cours de cette période de trois ans, elle atteint un résultat au moins égal à 75 point un nouveau délai de trois ans lui est accordé pour se mettre en conformité.
La DREETS peut également sanctionner l’entreprise[19] de cette même pénalité en l’absence de publication des informations relatives à l’index égalité femmes/hommes ou de mesures correctrices.
Informer la DREETS et pas seulement à l’occasion de la publication de l’index, apparait indispensable afin que le CSE puisse s’assurer que celle-ci dispose d’informations régulières, précises, objectives, des enjeux d’égalité femmes/hommes dans l’entreprise.
La loi du 24 décembre 2021 a par ailleurs accentué le caractère public et l’affichage des résultats des entreprises en la matière. Désormais la note globale mais également les résultats obtenus pour chaque indicateur de l’index seront publiés sur le site internet du ministère du travail, au plus tard le 31 décembre de chaque année.
La bataille est loin d‘être gagnée sur le terrain de l’égalité professionnelle comme l’ont hélas démontré les réformes successives. Au regard de leurs attributions, le CSE et les organisations syndicales conservent un rôle essentiel dans la révélation, la résorption voire la dénonciation de persistantes inégalités entre les femmes et les hommes dans l’entreprise.
[1] Article L.3221-2 du Code du travail
[2] Article L.1142-8 du Code du travail
[3] Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, publiée au JO le 6 septembre 2018
[4] Décret n°2019-15 du 8 janvier 2019, publié au JO le 9 janvier 2019
[5] Loi n°2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle, publiée au JO le 26 décembre 2021
[6] Décret n°2022-243 du 25 février 2022, publié au JO le 26 février 2022
[7] Par exemple un changement dans la constitution de l’UES, avec ventes ou acquisition d’une des entreprises la composant, ou difficulté économique modifiant la configuration de l’entreprise
[8] Index de l’égalité professionnelle : calcul et Questions/réponses du ministère du travail de l’emploi et de l’insertion professionnelle, mis à jour le 11 février 2021 (https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/indexegapro).
[9] Les honoraires de l’expert mandaté par le CSE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale sont pris en charge à 100% par l’employeur (art. L.2315-80 du code du travail), sauf disposition conventionnelle contraire.
[10] Les résultats obtenus pour chaque indicateur est une obligation nouvelle depuis la loi du 24 décembre 2021
[11] Article D.1142-4 du code du travail
[12] Index de l’égalité professionnelle : calcul et questions/réponses du ministère du travail de l’emploi et de l’insertion professionnelle, mis à jour le 31 janvier 2022
[13] Index de l’égalité professionnelle : calcul et questions/réponses du ministère du travail de l’emploi et de l’insertion professionnelle, mis à jour le 31 janvier 2022
[14] Ces mesures doivent également être publiée sur le site internet de l’entreprise
[15] Article L.1142-9 du Code du travail
[16] Un ou plusieurs référents désignés par la Direccte peuvent accompagner les entreprises pour les aider à calculer les indicateurs ou pour définir les mesures correctrices à adopter
[17] Arrêté du 31 janvier 2019 (JO n°0044 du 21 février 2019) :
[18] Article L.1142-10 du Code du travail
[19] Article L.2242-8 du Code du travail
Aurélien LADUREE, Juriste responsable IDF
DS, RS, RSS, il n’est pas évident pour le néophyte de s’y retrouver parmi ces abréviations désignant différentes fonctions syndicales en entreprise.
Parmi ces dernières le Représentant syndical au CSE (RS au CSE) occupe une place particulière.
En effet, ce dernier n’est pas un membre élu du CSE mais est désigné par son syndicat pour porter au sein du CSE la position de son syndicat sur les sujets débattus.
Tout d’abord, il convient de distinguer selon les effectifs de l’entreprise ou de l’établissement. Dans le cas d’un effectif de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE (C. trav., art. L. 2143-22).
Dans les entreprises ou établissements de 300 salariés et plus, il sera possible pour chaque organisation syndicale représentatives de désigner un représentant syndical qui devra impérativement :
Concernant les modalités de désignations, elles sont identiques à celles des DS à savoir que l’organisations syndicale doit informer l’employeur de la désignation, soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que l’inspecteur du travail doit être informé simultanément de la désignation du RS.
Enfin, attention, il existe un principe strict d’interdiction de cumul des fonctions de RS avec celle de membre élu titulaire ou suppléant du CSE. Autrement dit un RS ne pourra pas être titulaire ou suppléant du CSE.
Le RS est membre du CSE et à ce titre il doit être convoqué à toutes les réunions, et recevoir les ordres du jour et les documents afférents. Il peut participer aux débats, s’exprimer librement et bénéficie de la liberté de déplacement à l’instar des membres élus du CSE.
Il est donc le porte voix de son organisation syndicale et peut à ce titre donner la position de cette dernière sur les projets de l’employeur en complément de l’avis motivé de cette instance.
Lorsque l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement est d’au moins 501 salariés le RS bénéficie d’un crédit d’heures de délégation de 20 heures mensuelles (C. trav., art. L. 2315-7). Il en va de même pour les RS au comité social et économique central d’entreprise dans les entreprises d’au moins 501 salariés si aucun des établissements distincts n’atteint ce seuil.
En matière de formation, le RS n’étant pas un élu du CSE, il ne bénéficie pas du congé de formation économique ouvert aux titulaires.
Concernant la formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (financé par l’employeur) la question est juridiquement plus délicate.
En effet, le Questions-réponses sur le CSE, du ministère du Travail précise dans sa question 83 que
« L’ensemble des membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficie de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ».
La question de la volonté du législateur d’inclure ou non les RS comme bénéficiaires de la formation en santé au travail est posée. Même s’il serait opportun que les RS bénéficient de cette formation, dans l’attente de précisions notamment jurisprudentielles, il conviendra d’être prudent sur cette question et de privilégier la voie de la négociation avec les employeurs.
Par ailleurs, comme tous les salariés il peut bénéficier du congé de formation économique, sociale et syndicale de 12 jours ouvert à tous les salariés.
Enfin, il est bien évidement possible de négocier avec l’employeur pour obtenir des moyens supplémentaires.
En revanche, le rôle du RS dans le fonctionnement interne du CSE est très limité :
Pour conclure, le RS est donc un poste atypique au sein du CSE notamment par sa qualité de « non élu » qui, permet d’une part de renforcer la délégation du personnel mais également de faire entendre spécifiquement la voix du syndicat.
Justin SAILLARD-TREPPOZ, Juriste responsable régional AURA
Le Covid-19 a été reconnu comme une maladie professionnelle. En effet, les tableaux 60 du Code rural et de la pêche maritime et 100 du Code de la Sécurité sociale ont intégré les pathologies liées aux infections au SARS-CoV-2 au titre des maladies professionnelles.[1]
Les personnes infectées par le Covid-19 dans le cadre de leur activité professionnelle peuvent donc bénéficier d’une prise en charge spécifique en maladie professionnelle. Mais en fonction du secteur d’activité et des symptômes développés, la tâche ne s’avère pas aussi aisée qu’elle n’y paraît.
Il faut distinguer deux catégories :
Ces critères sont particulièrement restrictifs et peu pertinents dans la mesure où, comme on l’a vu, les séquelles cardiaques, neurologiques ou cérébrales de la covid-19 touchent de nombreux patients atteints, au départ, de formes peu graves de la maladie.*[2]
Dans le cas où ces professionnels de santé ont été atteints d’une affection grave autre que respiratoire, leur demande de reconnaissance devra être préalablement examinée par un comité d’experts médicaux. Cela induit des délais d’instructions plus longs pour la victime et une plus grande incertitude sur l’issu de la procédure.
Ce comité d’experts médicaux chargé d’étudier les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableaux est un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) unique, celui d’Ile de France, dont la composition est allégée afin de permettre une instruction rapide des dossiers, c’était la volonté du gouvernement de mettre en place une procédure dite « simplifiée » d’instruction[3].
Des recommandations à l’intention de ce CRRMP ont été rédigées par un groupe d’experts afin, notamment, de définir les critères à retenir pour établir le lien direct entre l’affection et le travail.[4] Il en ressort trois :
Suite à la parution du décret en septembre 2020 reconnaissant le Covid-19 comme maladie professionnelle, les organisations syndicales s’inquiétaient des critères trop limitatifs prévus et craignaient des lenteurs administratives.
Alors qu’en février 2021[5], l’Assurance maladie déclarait que sur 3 500 dossiers complets de demandes, 408 avaient abouties par le biais du tableau et 29 par le biais du comité d’experts.
À la fin septembre 2021[6], l’Assurance maladie déclarait que sur 5 018 dossiers complets de demandes, 1 690 avaient abouties à une reconnaissance de maladie professionnelle.
1690 travailleurs qui se sont vu reconnaître le caractère professionnel de leurs éventuelles séquelles, un an après l’ouverture du dispositif, ce chiffre paraît dérisoire, il semblerait que les réserves émises par les syndicats se confirment, la lourdeur administrative du système en place décourage.
[1] Décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020
[2] Extrait des débats parlementaires, M. Régis Juanico, rapporteur de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes de la covid-19, le 10 février 2021.
[3] Décret n°2021-554, 5 mai 2021, JO 6 mai
[4] Travaux du groupe d’experts présidé par le Pr.Paul Frimat sur saisine de la Direction de la Sécurité sociale et de la Direction générale du travail
[5] Déclaration de la direction des risques professionnels de l’Assurance-maladie
Alison VILLIERS - Juriste - Région Ouest
Plusieurs salariés élus de différents ESAT nous ont sollicité à l’assistance juridique sur la question du droit de grève des travailleurs en ESAT. C’est en cherchant à répondre à leur question que nous nous sommes aperçus du vide juridique à ce sujet et que nous avons pris conscience de l’importance d’en parler pour saisir ses enjeux car quelle différence y a-t-il entre un travailleur en ESAT et un salarié en entreprise ?
Dans les deux cas, ce sont des personnes qui travaillent, qui doivent respecter des contraintes qui leurs sont imposées (horaires, lieu de travail) et qui sont confrontés quotidiennement à un environnement de travail. A ceci près que les travailleurs en ESAT sont privés du droit constitutionnel le plus élémentaire s’agissant de la sphère professionnelle, celui de faire grève. Là où un salarié d’une entreprise aura le droit de s’absenter de son poste de travail pour faire entendre sa voix, manifester avec ses collègues son insatisfaction et ses attentes, là où la loi lui offre un moyen de faire entendre ses revendications et de contester ses conditions de travail, le travailleur en ESAT, lui, en est privé.
Et pour quelle raison un travailleur en ESAT est-il privé de ce droit constitutionnel qui devrait être octroyé à tout citoyen participant à la vie économique d’un pays ? Pour une raison de terminologie ?
Le droit de grève est un droit constitutionnel qui, selon le Préambule de la Constitution auquel renvoie la Constitution du 4 octobre 1958, s’exerce « dans le cadre des lois qui le réglementent ».
Cependant il n’existe pas de réglementation d’ensemble sur le droit de grève dans le secteur privé mais seulement quelques textes épars que l’on retrouve dans le Code du travail.[1]
Pour rappel, un ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail) est une structure qui offre des activités professionnelles et un soutien médico-social et éducatif. Il accueille les travailleurs handicapés dont le handicap est un obstacle à l’obtention d’un emploi dans une entreprise ordinaire ou une entreprise adaptée. Les ESAT font partie du secteur médico-social. De ce fait, ils dépendent du Code de l’action sociale et de la famille et pas du Code du travail. Le travailleur handicapé en ESAT n’a pas le statut de salarié, il est considéré comme un « usager du secteur médico-social ».
Pour autant, certaines règles du droit du travail concernant les congés, la santé, l’hygiène et la sécurité s’appliquent aux travailleurs des ESAT. Sur certains pans, le législateur a donc jugé bon de leur faire bénéficier des mêmes règles. Mais concernant le droit de grève au profit des travailleurs d’ESAT, aucun texte législatif ou réglementaire ne le prévoit (le Code de l’action sociale et de la famille est muet sur le sujet). Ils ne disposent pas plus de droits syndicaux, ainsi, les travailleurs en ESAT ne peuvent pas créer de section syndicale ni avoir une représentation du personnel. Leur seul moyen de s’exprimer est de faire connaître leurs problématiques auprès de leur unique représentant du Conseil de la Vie Sociale (CVS). A noter que ce représentant du personnel est seul à siéger au sein de cette instance. Cette instance n’est toutefois en rien comparable au Comité Social et Economique (CSE) que l’on connaît dans les entreprises privées françaises.
Pour justifier cette différence de droits, certains arguent du fait que les travailleurs en ESAT bénéficient d’une protection de l’emploi, propre au secteur médico-social. En effet, un travailleur d’ESAT ne peut pas être licencié. Mais cela ne veut pas dire pour autant que le travail exercé quotidiennement ne peut pas devenir pénible, qu’ils ne subissent aucune pression, que des conflits ne peuvent pas naître des situations de travail, que l’environnement de travail ne peut pas se dégrader, qu’ils ne peuvent pas subir des injustices et/ou une inégalité de traitement. Ils sont privés de s’exprimer sur ces éventuels problèmes en exerçant solidairement leur droit de grève au motif qu’ils ne peuvent perdre leur emploi, cette logique n’est ni justifiée ni proportionnée et cette approche est déshumanisante.
Les travailleurs en ESAT, sont rappelons-le, des personnes handicapées, déjà stigmatisées par une société insuffisamment tolérante et bienveillante à leurs égards. Ils subissent ici une véritable discrimination, ils sont privés d’un véritable moyen d’expression, découlant directement de notre texte le plus précieux organisant notre vie en société : notre Constitution.
Sans compter que le personnel encadrant dans les ESAT a fait connaître ses dernières années son manque de moyens. Ces dysfonctionnements sont eux-mêmes régulièrement à l’origine de mouvements de grève pour dénoncer leurs conditions de travail difficiles et un accompagnement des travailleurs en ESAT devenu parfois impossible. Si les travailleurs en ESAT avaient le droit de grève, ils pourraient être solidaire d’une mobilisation au sein de leur structure, ils pourraient être actifs dans un mouvement qui les concerne directement. Quelle grande satisfaction pour tout individu d’avoir le choix, d’être acteur, de se sentir utile, de faire partie d’un collectif, d’avoir du poids, d’avoir les mêmes droits que les autres, d’être comme les autres, de se sentir intégrer puisque c’est bien de ça dont il s’agit en définitif.
Le législateur pourrait reconnaître le droit de grève dans les ESAT, tout en maintenant la protection apportée par le statut médico-social, l’un n’empêche pas l’autre. Cela permettrait de mettre fin au sentiment d’exclusion souvent ressenti par les travailleurs en ESAT.
Certes, en tant que citoyen, un travailleur en ESAT peut librement se syndiquer auprès de la confédération syndicale de son choix, il peut également adhérer à des associations de défense de ses droits, et y militer. Une saisine du Défenseur des Droits sur cette question semble également possible dans la mesure où un travailleur en ESAT est aujourd’hui discriminé.
Mais n’est-ce pas le rôle de la loi de créer les conditions permettant l’équité entre les individus, de leur assurer des droits et d’en permettre l’exercice ?
En ce sens, le cadre législatif actuel ne permet pas de remplir cette mission, celle de nous faire sentir tous égaux et une évolution sur le sujet serait la bienvenue et en cohérence avec la volonté affichée des différentes forces politiques de reconnaître la personne handicapée comme un citoyen à part entière.
[1] Articles L. 1132-2, L. 1242-6, L. 1251-10 et L. 2511-1 du Code du travail
Alison VILLIERS - Juriste région OUEST
L’année 2021 a été source de nombreux changements notamment en droit du travail. Le 1er janvier 2022 est, lui aussi, moteur de nouveautés importantes.
Le décret n°2021-1741 du 22 décembre 2021 a prévu une augmentation de 0.9%.
Les pensions de retraite de base sont revalorisées de 1,1 %. Elle s’applique aux pensions des retraités du secteur privé, de la Fonction publique, des régimes spéciaux et des indépendants.
Les mairies doivent appliquer à leurs agents les 35 heures de travail hebdomadaires, soit 1 607 heures par an. Les départements et régions devront également le réaliser d’ici 1 an.
L’indice minimum de traitement des trois fonctions publiques est relevé au niveau du SMIC.
Dans le cadre de la réforme du financement de la complémentaire santé dans la fonction publique portée par le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques, une partie de la mutuelle est désormais prise en charge à hauteur de 15€/mois et remboursée directement sur la fiche de paie.
Dans la loi de finances pour 2022, il est prévu que les salariés en contact avec la clientèle qui perçoivent des sommes remises volontairement voient ces montants défiscalisés et désocialisés, dès lors que leur rémunération est en deçà de 1.6 SMIC.
Le congé proche aidant est élargi à de nouveaux bénéficiaires et les allocations journalières sont revalorisées.
Les salariés en forfait jour dont les mandataires sociaux peuvent désormais profiter de la retraite progressive.
Le montant du plafond de la Sécurité sociale n’est pas modifié pour l’année 2022.
Le plafond annuel de la Sécurité sociale pour 2022 est donc équivalent à celui de 2021, soit 41 136 € (3 428 € mensuel).
Initialement applicable au 1er janvier 2022, la majoration forfaitaire du taux de cotisation AT/MP des entreprises soumises à la tarification collective est repoussée.
La ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin, dans un courrier transmis aux organisations syndicales de la fonction publique et aux représentants des employeurs publics a annoncé le 9 décembre qu’il n’y aura pas de dégel du point d’indice dans la fonction publique.
La loi de finance pour 2022 autorise le gouvernement, jusqu’au 31 juillet 2022, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant l’adaptation des dispositions relatives à l’activité partielle réduite de longue durée (APLD).
La loi de finances pour 2022 permet la pérennisation de certaines dispositions liées à l’activité partielle nées à la suite de la crise sanitaire notamment concernant les salariés au forfait jour/heure ainsi que les cadres dirigeants.
La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 prévoit le maintien du régime social de l’indemnité complémentaire (soit les indemnités complémentaires versées par l’employeur en complément des indemnités légales seront soumises au même régime social que les indemnités légales, dans la limite de 3,15 Smic).
Audrey LIOTÉ, Juriste AURA
Le congé sabbatique est un congé pour convenances personnelles qui permet au salarié de s’absenter pour réaliser un projet[1]. C’est un congé non rémunéré, le contrat de travail est suspendu pendant cette période. Le salarié n’a pas à aviser son employeur de la raison de son congé sabbatique. Il dispose de ce temps comme il le souhaite, le salarié peut exercer une activité professionnelle rémunérée, sous réserve de respecter ses obligations de loyauté et de non-concurrence vis-à-vis de son employeur.
Toutes les règles encadrant le congé sabbatique peuvent être fixées par voie d’accord collectif d’entreprise ou déjà prévues par un accord collectif de branche. Ce n’est qu’à défaut d’accord, que les règles présentées ci-dessus ont vocation à s’appliquer.
La loi prévoit une durée minimale de 6 mois et une durée maximale de 11 mois[2] pour ce type de congé.
Pour pouvoir bénéficier du congé sabbatique, le salarié doit avoir 36 mois d’ancienneté[3] ; totaliser 6 ans d’activité professionnelle[4] ; ne pas avoir déjà bénéficié dans la même entreprise, au cours des 6 dernières années, d’un congé sabbatique, d’un congé pour création d’entreprise ou d’un projet de transition professionnelle[5].
Le salarié doit informer l’employeur de la date de départ et la durée envisagée du congé au moins trois mois à l’avance[6].
L’employeur peut accepter, reporter ou refuser (seulement dans les entreprises de moins de 300 salariés) sa demande. À défaut de réponse dans un délai de 30 jours à compter de la présentation de la demande du salarié, l’accord de l’employeur est réputé acquis[7].
Pendant la suspension de son contrat, son ancienneté n’est pas comptabilisée, il n’acquiert ni congés payés, ni de droit à la retraite. En revanche, le salarié conserve son droit aux prestations en nature et pendant 12 mois aux indemnités journalières de l’assurance maladie et maternité.[8]
Le salarié en congé sabbatique ne bénéficie d’aucune protection particulière contre le licenciement.
Une fois la demande acceptée, le salarié ne peut ni prolonger le congé sabbatique au-delà de la date fixée, ni reprendre le travail avant le terme du congé, sauf accord de l’employeur[9]. De la même manière, l’employeur ne peut pas imposer au salarié de revenir avant le terme du congé sabbatique.
Au terme du congé, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente. De plus, le salarié doit bénéficier d’un entretien professionnel.[10]
Le CSE doit être consulté en cas de refus du congé sabbatique[11]. L’employeur peut refuser s’il estime que l’absence du salarié entraînera des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise. L’avis rendu par le CSE a son importance puisque le salarié peut contester la décision de refus de l’employeur devant le CPH en la forme des référés et donc utiliser cet avis pour plaider sa cause[12].
Par ailleurs, le CSE et les délégués syndicaux peuvent négocier sur ce sujet, la quasi-intégralité des règles fixées par la loi sont des dispositions supplétives, ce qui laisse une marge de manœuvre intéressante. Pour déterminer l’intérêt et l’ampleur du sujet dans vos entreprises, sachez que la BDESE doit contenir des données chiffrées par sexe et réparties par catégories professionnelles sur le congé sabbatique dont la durée est supérieure à 6 mois[13](dans les entreprises de plus de 300 salariés).
[1] art. L. 3142-28 du Code du travail
[2] art. L. 3142-34 du Code du travail
[3] art. L. 3142-34 du Code du travail
[4] art. L. 3142-28 du Code du travail
[5] art. L. 3142-34 du Code du travail
[6] art. D. 3142-19 du Code du travail
[7] art. L. 3142-30 et art. D. 3142-18
[8] art. L. 161-8 et art. R. 161-3 du Code de sécurité sociale
[9] art. L. 3142-31 du Code du travail
[10] art. L. 3142-31 du Code du travail
[11] art. L.3142-29 du Code du travail
[12] art. D. 3142-16 et art. R. 3142-17 du Code du travail
[13] art. R.2312-9 du Code du travail
La journée internationale des stagiaires de ce 10 novembre nous donne l’occasion de mettre en lumière les droits des stagiaires, qui demeurent encore aujourd’hui fragiles. Rappelons que le Code du travail et le Code de l’éducation protègent les stagiaires en encadrant au recours au stage.
Les représentants du personnel sont les garants de l’application du droit des stagiaires. A défaut, il relève de leurs missions d’alerter l’employeur, notamment par le biais des réclamations individuelles et/ou collectives.
Enfin, il convient de rappeler que la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte notamment sur les conditions d’accueil en stage (c. trav. art. L. 2312-26).
Tour d’horizon :
Selon l’article L. 124-1 du Code de l’éducation, le stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l’étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en œuvre les acquis de sa formation en vue notamment de l’obtention d’un diplôme ou d’une certification.
Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil.
Oui. Un stagiaire ne peut pas effectuer, par année d’enseignement, plus de 6 mois de stage dans une même entreprise, peu importe que ce soit au titre d’un ou de plusieurs stages (c. éduc. art. L. 124-5).
Cela dépend des situations.
- Une gratification minimale est versée si la durée du stage est supérieure à 2 mois consécutifs (soit l’équivalent de 44 jours à 7 heures par jour) au cours de la même année scolaire ou universitaire.
- En dessous de ces seuils de durée, l’organisme d’accueil n’a pas l’obligation de verser une gratification.
Remarque : Le montant minimum versé pour chaque heure de présence effective est de 3,9 €. Dans certaines branches professionnelles, ce montant peut être supérieur, ce qu’il convient de vérifier.
Les stagiaires bénéficient des règles applicables aux salariés de l’entreprise d’accueil en matière de (c. éduc. art. L. 124-14) :
-présence de nuit ;
-durées maximales de présences quotidienne et hebdomadaire ;
-repos quotidien, repos hebdomadaire et jours fériés.
Remarque : l’entreprise d’accueil a l’obligation d’établir, « selon tous moyens », un décompte des durées de présence du stagiaire (c. éduc. art. L. 124-14).
Oui.
Oui, ils doivent bénéficier de ces avantages (c. éduc. art. L. 124-13). Il peut s’agir ainsi :
- du restaurant d’entreprise
- des titres-restaurant ;
- de la prise en charge des abonnements aux transports publics pour le trajet « domicile-lieu de stage ».
Remarque : tous les stagiaires bénéficient de ces droits, y inclus ceux ayant des stages inférieurs à 2 mois.
Oui, il s’agit d’une obligation selon l’article L. 124-16 du Code de l’éducation. Ils doivent pouvoir y avoir accès dans les mêmes conditions.
Ainsi, si par exemple, un critère d’ancienneté existe pour l’ouverture des droits, il doit être le même pour les stagiaires (et non pas supérieur, par exemple).
Anissa CHAGHAL / Juriste IDF

ATLANTES AVOCATS reconnu comme incontournable pour son conseil auprès des salariés et des syndicats par Décideurs Magazine - Groupe Leaders League pour cette année 2021.
Nous tenons à remercier l’ensemble de nos clients pour leur confiance au quotidien.
Cette réussite c’est le fruit d’un travail d’équipe qui s’organise autours de nos avocats associés Laurence Chaze, Diego Parvex et Evelyn Bledniak et de toute notre équipe Maxence Defrance, Franck Carpentier, Audrey Lioté, Justin Saillard-Treppoz, Frédéric PAPOT, Julien Peltais, Camille Piat, Samuel Bencheikh, Alison Villiers, Kama Macalou, Anne lise Massard, Sabine de CLINCHAMPS, Marion Stofati, Aurélien LADUREE, Julien Peltais,Marion STOFATI, Alexandra Pantalacci-Hoerler, Floriane BURETTE, Olivier CADIC, Carine DUPONCHEL ; Leslie GOSSART, Benita KAPINGA, Emmanuelle THIERMANT, Lullaby ZAVARONI, Chantal ANIFRANI, Mélanie RUTY, Ulric SOPHIE, Valérie PINEL, Sylvie ROGER, Laura MOREL.
Le décret n° 2021-1250 du 29 septembre 2021, modifiant le décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l’urgence sanitaire, est pris pour l’application de l’ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 modifiée adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire, notamment ses articles 3 et 4 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044125984).
Entré en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la République française (OJRF) le 30 septembre 2021, ledit décret concerne travailleurs et employeurs relevant du Code du travail et des dispositions spécifiques du Code rural et de la pêche maritime ainsi que les services de santé au travail et a pour objet de préciser les modalités relatives au suivi individuel de l’état de santé des travailleurs et fonctionnement des services de santé au travail.
Le texte prévoit les types de visites qui peuvent être reportées (https://code.travail.gouv.fr/information/report-ou-annulation-de-visites-medicales-nouveautes-covid-19).
Ce report, lorsqu’il est prévu par le texte, trouve à s’appliquer ou non aux visites échues ou reportés comme suit :
Si le texte prévoit une possibilité de report de la visite, le médecin du travail peut maintenir la tenue de la visite s’il estime indispensable de maintenir la visite, compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.
Si le texte ne l’a pas prévu, en revanche, le médecin du travail ne pourra pas décider du report d’une visite.
Lorsque le médecin du travail décide du report d’une visite, telle que prévue par les textes, il doit en informer le salarié et l’employeur et leur communiquer la date à laquelle cette visite est reprogrammée.
L’employeur devra prévenir le salarié, si le médecin du travail n’a pas ses coordonnées.
Le report des visites ne fait pas obstacle à l’embauche ou la reprise de travail.
Le décret a, en revanche, mis fin à la faculté pour le médecin du travail de confier, sous sa responsabilité, à un infirmier en santé au travail, la visite de préreprise et la visite de reprise, au 29 septembre 2021 (au lieu du 1er août 2021).
Depuis le 30 septembre 2021, un infirmier en santé au travail ne peut donc plus réaliser de visite de préreprise et la visite de reprise par délégation du médecin du travail.
Alexandra PANTALACCI – juriste IDF
« Votre solde pour la formation arrive à échéance. Consultez votre solde et réclamez votre formation 100% financée par l’Etat en cliquant sur tel lien ». Par ce simple clic, vous risquez de vous voir délester des sommes de votre compte CPF en quelques minutes seulement. Les auteurs de ce type d’arnaque diffusent largement cette information par SMS, sites Internet, réseaux sociaux, e-mails publicitaires,…
Ces arnaqueurs utilisent la méthode dit du « phishing » (ou hameçonnage). Ceux-ci récupèrent vos coordonnées personnelles (nom, prénom, mail, numéro de téléphone,…) et vous recontactent par téléphone en se faisant passer pour des organismes officiels (tel que Mon Compte Formation, Caisse des Dépôts, Pôle Emploi,…).
Ces voleurs prétendent ensuite vous aider à créer votre compte en ligne, réinitialiser votre mot de passe ou à vous inscrire à des formations. Ils peuvent récupérer à ce moment-là votre numéro de Sécurité Sociale par exemple.
Ces derniers peuvent vous inscrire également à de fausses formations créées par des sociétés fictives.
Plusieurs milliers d’utilisateurs ont vu leur solde disparaître alors qu’ils n’ont jamais demandées ou suivies de formation ! Plus de 10 millions d’euros ont déjà été détournés via ce procédé.
L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
Le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 € d’amende.
Lorsqu’il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.
Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’Etat, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende.
Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
La fédération "les acteurs de la compétence" a lancé une charte déontologique pour la vente de prestations au titre du CPF. Elle contient 10 engagements qui devront être respectés par les organismes qui adhéreront au document.
L’apposition d’un tel macaron sera donc un indice supplémentaire.
La charte à retrouver ici : https://bit.ly/3nw0QFG
Audrey LIOTÉ, Juriste AURA
Cette question d’apparence simple est plus délicate qu’il n’y paraît et nécessite de se pencher avec attention sur les éléments juridiques.
A première vue non !
En effet, si le Code du travail ne le précise pas expressément, la demande d’heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur. Ce dernier peut donc les imposer et un refus pourra être considéré comme une faute pouvant entrainer des sanctions disciplinaires (pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave en fonction des faits).
La Cour de cassation a ainsi posé le principe selon lequel les heures supplémentaires imposées ne sont pas une modification du contrat de travail et donc s’imposent au salarié (Cass. soc., 9 mars 1999, n° 96-43.718).
Mais attention, la haute juridiction a également posé une limitation au pouvoir de l’employeur. Les salariés sont ainsi tenus de réaliser les heures supplémentaires sauf abus de droit de l’employeur.
Ainsi, au gré des circonstances, un refus de réaliser des heures supplémentaires pourra être considéré comme fautif ou non.
Quelles sont les situations caractérisées comme un abus de droit de la part de l’employeur ?
Il existe un certain nombre de jurisprudences sur cette question. Sans donner une liste exhaustive, voici les principales situations pour lesquelles la Cour de cassation a considéré qu’un refus n’était pas fautif :
La Cour de cassation pose également un principe de délai de prévenance. Sans que ce dernier ne soit précisé, la cour considère que le refus d’effectuer des heures supplémentaires ne peut être considéré comme fautif si le salarié n’a pas été averti suffisamment tôt (Cass. soc., 20 mai 1997, n° 94-43.653).
Enfin, la Cour de cassation prévoit (heureusement) que l’employeur se doit de respecter les règles légales relatives notamment au paiement, récupérations ou majoration d’heures supplémentaires. Un salarié serait ainsi fondé à refuser leur réalisation :
Pour conclure, le refus d’effectuer des heures supplémentaires est possible mais il sera nécessaire de bien étudier la situation en amont au risque que ce refus soit considéré comme fautif et que le salarié soit sanctionné.
Justin Saillard TREPPOZ / responsable régional AURA
La crise sanitaire sans précédent que nous connaissons depuis plusieurs mois s’est traduite par différents phénomènes au sein des entreprises : difficultés économiques et plans de suppressions de postes pour les secteurs les plus durement touchés par la crise, ralentissement de l’activité et mise en place de mesures d’activité partielle pour d’autres, évolution des organisations de travail avec la démocratisation du télétravail pour la plupart.
Des mesures de soutien financier exceptionnelles ont été mises en place par l’Etat. Pour autant l’actualité sociale pourrait rester chargée dans les mois à venir.
En tant que représentant du personnel, la gestion de ces situations de crise est souvent nouvelle pour vous : votre entreprise n’y a jamais été confrontée ou vous êtes nouvellement élus et, par ailleurs, ces restructurations peuvent désormais prendre des formes juridiques très variées, de l’activité partielle de longue durée (APLD) jusqu’au plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) plus classique en passant par des plans d’adaptations négociés.
Pour vous permettre d’anticiper ces situations, en intégrant notamment les déterminants et les enjeux des différentes formes de restructuration, le cabinet SECAFI et le cabinet d’avocats Atlantes ont construit une formation qui vous permettra de :
Ce webinaire de présentation vous permettra de poser toutes vos questions et de découvrir notre manière innovante, par la formation, d’y répondre.
Pour vous y inscrire 👉 https://lnkd.in/eTpCnr8m
Souvent désigné en pratique par les termes de « mi-temps thérapeutique », le temps partiel pour raison thérapeutique permet à un fonctionnaire de bénéficier d’une réduction d’activité en raison de son état de santé tout en percevant l’intégralité de son traitement.
Désormais, cette situation se trouve régie par les règles issues du décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique de l’Etat, dont nous vous présentons la substance (texte publié au Journal Officiel du 30 juillet 2021).
Des mesures similaires sont prévues pour les agents contractuels.
Le fonctionnaire adresse à l’administration qui l’emploie une demande d’autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accompagnée d’un certificat médical qui mentionne la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d’exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites.
L’autorisation prend effet à la date de la réception de la demande par l’administration.
La quotité de temps de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.
A noter que lorsque le fonctionnaire travaille déjà à temps partiel, une décision autorisant un fonctionnaire à servir à temps partiel pour raison thérapeutique met fin à tout régime de travail à temps partiel antérieurement accordé.
L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de 1 à 3 mois dans la limite d’une année.
Le fonctionnaire dont les fonctions comportent l’exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées peut être autorisé à les exercer à temps partiel pour raison thérapeutique sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service.
Dans le cas où les nécessités de la continuité et du fonctionnement du service y font obstacle, ce fonctionnaire peut toutefois être autorisé à exercer des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique en recevant une affectation temporaire dans d’autres fonctions conformes au statut du corps auquel il appartient.
Sur demande du fonctionnaire intéressé, l’administration peut, avant l’expiration de la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique dont celui-ci bénéficie :
De manière générale, l’administration peut faire procéder à tout moment par un médecin agréé à l’examen du fonctionnaire intéressé, qui est tenu de s’y soumettre sous peine d’interruption de l’autorisation dont il bénéficie.
En outre, lorsque le fonctionnaire demande la prolongation de l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d’une période totale de trois mois, l’administration fait procéder sans délai par un médecin agréé à l’examen
Le médecin agréé rend un avis sur la demande de prolongation au regard de sa justification médicale, de la quotité de travail sollicitée et la durée de travail à temps partiel pour raison thérapeutique demandée.
Le Comité médical compétent peut-être saisi pour avis, soit par l’administration, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé.
Dans les situations où le Comité médical a émis un avis défavorable, l’administration peut rejeter la demande du fonctionnaire intéressé ou mettre un terme à la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique dont il bénéficie.
Frédéric PAPOT
Dans le cadre de ses attributions, le Comité Social et Economique a pour mission d’assurer l’expression collective des salariés et de permettre ainsi la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions de l’entreprise.
Cette prise en compte s’arrête-t-elle aux seuls salariés de l’entreprise ? Il n’en est rien.
En effet, le CSE a également pour mission de porter les intérêts des salariés d’entreprises extérieures et des salariés temporaires qui, dans l’exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l’entreprise utilisatrice.
Le CSE de l’entreprise utilisatrice peut ainsi porter à la connaissance de la Direction les réclamations individuelles et collectives des travailleurs intérimaires portant sur leurs rémunérations, leurs conditions de travail ainsi que l’accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives (art. L. 2312-6 du Code du travail).
En outre en matière de sécurité, lorsque le poste occupé par des salariés intérimaires présente des risques particuliers pour leur santé et/ou leur sécurité, le CSE de l’entreprise utilisatrice doit être consulté sur les programmes et les modalités pratiques de la formation renforcée à la sécurité et sur les conditions d’accueil dont bénéficieront les salariés temporaires affectés à ces postes (art. L. 4143-1 du Code du travail).
Le recours à une entreprise extérieure peut induire de nouveaux risques professionnels pour le personnel mis à disposition au sein de l’entreprise utilisatrice (nouveaux locaux, nouveaux procédés, nouvelle organisation, etc.) ou bien en raison de l’interaction des différentes activités des sociétés en présence.
Ainsi, selon le rapport annuel « L’essentiel 2019, Santé et sécurité au travail » de l’Assurance Maladie, le nombre d’accidents du travail en 2019 se maintient ou diminue légèrement dans la plupart des secteurs professionnels mais le secteur du travail temporaire et de l’action sociale connait une hausse de 1.3%. De manière globale, le taux de fréquence des accidents du travail et le taux de gravité sont deux fois plus élevés au sein de l’intérim que ceux observés dans les autres secteurs salariés. Ces chiffres peuvent notamment s’expliquer par la nature même de l’intérim : la nature temporaire des missions, le changement régulier de postes de travail et de missions, des postes proposés principalement dans des secteurs accidentogènes.
Aussi, le Code du travail impose-t-il aux dirigeants de l’entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures de coordonner leurs politiques de prévention des risques professionnels (Art. L. 4121-5 du Code du travail).
La réalisation de travaux par une ou plusieurs entreprises extérieures peut ainsi impliquer l’organisation d’une inspection commune des locaux, du matériel et des installations, à laquelle peuvent participer, s’ils l’estiment nécessaire, les CSE des entreprises utilisatrice et extérieures, l’élaboration d’un plan de coordination et en cas de risques spécifiques, l’établissement d’un plan de prévention, tenu à la disposition des CSE (Art. R. 4511-1 et suivants du Code du travail - Pour plus de précisions sur les modalités d’organisation de la coordination des chefs d’entreprise, nous vous invitons à consulter le site de l’Institut National de Recherches et de Sécurité (INRS)).
Si en cas d’accident du travail d’un travailleur intérimaire, la co-responsabilité de l’entreprise utilisatrice et de l’entreprise de travail temporaire peut être recherchée, la Cour de cassation considère qu’il appartient au CSE de l’entreprise utilisatrice d’exercer, à l’égard des salariés intérimaires, une mission de vigilance en matière de santé/sécurité. Toutefois, la Cour reconnait une exception à ce principe : en présence d’un risque grave et actuel pour les salariés temporaires au sein de l’entreprise utilisatrice et lorsqu’il est constaté une inaction de l’entreprise utilisatrice et de son CSE pour y remédier, le CSE de l’entreprise de travail temporaire est habilité à recourir à l’assistance d’un expert pour risque grave. En permettant au CSE de l’entreprise de travail temporaire de désigner un expert pour risque grave, bien que ce risque soit inhérent à l’entreprise utilisatrice, la Cour de cassation offre une solution permettant de veiller à la protection de la santé et de la sécurité des intérimaires (Cass. Soc., 26 février 2020, n°18-22.556).
Floriane Burette, Juriste Atlantes Référente Ile-de-France
Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, le CSE de l’entreprise utilisatrice est informé chaque trimestre du nombre de salariés temporaires, du nombre de journées de travail accomplies, au cours de chacun des 3 derniers mois, par les salariés titulaires temporaires, ainsi que du motif ayant conduit l’employeur à recourir à ce type de contrat (Art. L. 2312-69 et R. 2312-21 du Code du travail).
En outre, dès lors que l’entreprise compte au moins 50 salariés, le CSE dispose chaque année, à l’occasion de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, d’informations sur le nombre des intérimaires, le volume de journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par ces derniers, ainsi que les motifs ayant conduit l’employeur à recourir à ce type de contrat (Art. L.2312-26 et suivants et R.2312-8 et suivants du Code du travail).
Le représentant syndical au CSE a pour mission principale de faire connaître aux autres membres du comité la position de son syndicat sur les différents sujets évoqués lors des réunions.
Selon l’article L. 2143-22 du Code du travail, dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE.
Concernant le délégué syndical, en principe, il ne peut être désigné que dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Néanmoins, le Code du travail apporte deux exceptions :
Se pose donc la question de l’articulation entre ces exceptions et l’article qui prévoit que le DS est de droit RS au CSE dans les entreprises de moins de 300 salariés.
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 8 septembre 2021 (Arrêt n° 968 du 8 septembre 2021 (20-13.694) - Cour de cassation - Chambre sociale), est venue nous préciser qu’il n’est pas possible de désigner un représentant syndical au CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Audrey Lioté
Juriste région AURA
Lorsque le licenciement d’un salarié est envisagé, celui-ci est convoqué à un entretien lors duquel il peut se faire assister.
S’il n’existe pas de représentant du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller du salarié.
Le Code du travail prévoit que ce conseiller dispose d’autorisation d’absence et de crédit d’heures pour exercer sa mission durant ses heures de travail (dans la limite de 15h par mois, article L. 1232-8 du Code du travail).
En outre, selon l’article L. 1232-9 du Code du travail, « le temps passé par le conseiller du salarié hors de l’entreprise pendant les heures de travail pour l’exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise.
Ces absences sont rémunérées par l’employeur et n’entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants ».
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 23 juin 2021 (n°19-23.847), est venue nous apporter une précision concernant le mode de preuve : elle juge "qu’il appartient au salarié, investi de la mission de conseiller du salarié, qui réclame, à ce titre, la rémunération de temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail, de remettre à son employeur les attestations correspondantes des salariés bénéficiaires de l’assistance".
Ainsi, le conseiller du salarié ne bénéficie pas de la présomption de la bonne utilisation de ses heures, contrairement aux membres du CSE.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/814_23_47382.html
Audrey LIOTÉ, Juriste AURA
En raison de la circulation inquiétante du variant Delta sur tout le territoire, de nouvelles mesures sanitaires ont été mises en place depuis le 9 août 2021 pour freiner une reprise forte de l’épidémie de Covid-19.
Ces nouvelles mesures sont issues de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, promulguée le 6 août 2021 au Journal officiel. Trois décrets et un arrêté d’application de cette loi, datés du 7 août, sont parus le 8 août (L. n°2021-1040 du 5 août 2021 ; D. n°2021-1056 du 7 août 2021 ; D. n°2021-1059 du 7 août 2021 ; D. n°2021-1060 du 7 août 2021 ; A. du 7 août 2021).
À distinguer de l’obligation vaccinale dans le milieu professionnel, l’obligation de présenter un pass sanitaire en milieu professionnel consiste en la présentation numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :
Le document attestant d’une contre-indication médicale à la vaccination peut être présenté à la place des documents précités.
Du 9 août au 14 septembre 2021 inclus, les personnels des établissements de soins, médicaux sociaux et sociaux listés à l’article 12 de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire du 9 août 2021 devront obligatoirement être vaccinés ou, à défaut, devront présenter un pass sanitaire.
À compter du 30 août 2021, les salariés, bénévoles, prestataires, intérimaires, sous-traitants qui interviennent dans les lieux où il est demandé aux usagers ou au public de présenter un pass sanitaire (lieux d’activités et de loisirs, lieux de convivialité, lieux de santé, transports publics et grands centres commerciaux supérieurs à 20 000 m²), seront concernés par la même obligation de présentation.
Il existe deux exceptions à l’obligation de présenter un pass sanitaire, lorsque l’activité se déroule :
Ne sont pas soumis à l’obligation du pass sanitaire :
À compter du 30 septembre 2021, les salariés mineurs (de plus de 12 ans et de moins de 18 ans) devront présenter un pass sanitaire dans les mêmes conditions que les salariés majeurs.
Oui. Le CSE doit être informé et consulté, au titre de ses attributions générales, sur les modalités pratiques de contrôle du pass sanitaire, celles-ci ayant un impact sur « l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise » (C. trav., art. L. 2312-8).
En raison de l’obligation qui incombe à l’employeur de contrôler le respect des obligations sanitaires portées par cette loi à compter du lendemain de sa publication, les modalités d’information et de consultation du CSE ont toutefois été aménagées comme suit.
Dès la mise en œuvre des mesures, l’employeur en informe le CSE. Cette information déclenche le délai de consultation du CSE d’un mois. Cela signifie que l’employeur a un mois pour réunir le CSE afin qu’il puisse rendre un avis sur les mesures mises en œuvre. Le CSE se réunit pour rendre son avis trois jours après la transmission de l’ordre du jour sur le sujet.
Oui. Sachant que l’autorisation d’absence pour la vaccination concerne tous les salariés ainsi que les stagiaires, et non pas seulement ceux des secteurs soumis à l’obligation de détenir un pass sanitaire.
Ces heures d’absence sont payées et considérées comme du temps de travail effectif.
Les employeurs peuvent accorder une autorisation d’absence aux salariés parents d’enfants pouvant se faire vacciner ou aux salariés en charge de majeurs protégés souhaitant se faire vacciner.
À noter que l’employeur peut demander au salarié pour justifier de son absence, la confirmation du rendez-vous de vaccination en amont ou a posteriori le justificatif de la réalisation de l’injection.
En cas de refus de présenter ses justificatifs relatifs à l’obligation de détenir un pass sanitaire, le salarié ne peut plus exercer son activité.
Le salarié peut, en accord avec l’employeur, poser des jours de repos conventionnels ou de congés payés. Autrement, l’employeur sera tenu de suspendre le contrat de travail du salarié jusqu’à régularisation de la situation.
En ce qui concerne le pass sanitaire, la loi prévoit, à l’issue du troisième jour suivant le début de la suspension du contrat, que l’employeur organise un entretien avec le salarié au cours duquel seront examinés les moyens de régulariser sa situation.
Parmi les moyens de régularisation figurent :
- l’affectation temporaire à un poste non-soumis à l’obligation susmentionnée si les besoins et l’organisation de l’entreprise le permettent ;
- ou le télétravail, lorsque les missions sont éligibles à ce mode d’organisation de travail.
À l’issue et dans le cas d’une situation de blocage persistante, les procédures de droit commun concernant les contrats de travail peuvent s’appliquer.
Bien que le Parlement ait retoqué les dispositions de la loi du 5 août 2021 permettant le licenciement des personnes qui ne respecteraient pas l’obligation vaccinale ou le pass sanitaire, la ministre du Travail, Élisabeth Borne, a indiqué le 27 juillet sur BFMTV/RMC, qu’un salarié pourrait bien être licencié s’il ne produisait pas de pass sanitaire.
À cet égard, la Cour de cassation a déjà jugé, dans une espèce similaire, que dès lors que la réglementation applicable à l’entreprise impose la vaccination des salariés exerçant des fonctions les exposant au risque d’une certaine maladie, l’intéressé ne peut s’opposer à la prescription de cette vaccination par le médecin du travail en l’absence de contre-indication médicale de nature à justifier son refus. Dans ces conditions, un tel refus constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. (Cass soc, 11 juillet 2012 n° 10-27.888).
Ministère du travail, questions-réponses « Obligation de vaccination ou de détenir un pass sanitaire pour certaines professions » : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/obligation-de-vaccination-ou-de-detenir-un-pass-sanitaire-pour-certaines
Alexandra PANTALACCI, juriste IDF
Par une ordonnance de référé rendue le 1er juin 2021, le Tribunal Judiciaire de Paris est venu préciser l’étendue de l’application de l’obligation légale de discrétion et de confidentialité qui pèse sur les membres élus du CSE.
Dans cette affaire, à l’issue de la négociation annuelle obligatoire (NAO) sur les salaires, un délégué syndical a diffusé aux salariés de la société un tract intitulé « Rémunération 2021 - Chacun pour soi et la CFDT pour tous ». À ce tract était annexé un tableau sur lequel figuraient les rémunérations minimales, moyennes, médianes, et maximales par coefficient.
La Société a assigné en référé d’heure à heure le syndicat en demandant notamment au tribunal de juger que l’organisation syndicale, par l’intermédiaire de son délégué, avait violé son obligation de discrétion et de confidentialité, dès lors que le tract comportait des informations confidentielles dont la divulgation portait atteinte à l’intérêt de la société.
Le tribunal a débouté la Société de l’ensemble de ses demandes jugeant que, contrairement à ce que prétendait l’employeur, l’obligation légale de discrétion et de confidentialité qui pèse sur les membres élus du CSE ne s’étendait pas aux délégués syndicaux, excepté lorsque les documents d’information leur étaient communiqués via la base de données économiques et sociales (BDES).
Le tribunal adopte ainsi une lecture restrictive de l’obligation légale de discrétion et de confidentialité qui pèse sur les membre élus du CSE, en refusant d’étendre celle-ci aux délégués syndicaux, lesquels sont également amenée à prendre connaissance d’informations qui seraient dépourvues de tout lien avec le CSE, comme c’était le cas, en l’espèce, dans le cadre de la NAO sur les salaires.
Le refus d’appliquer aux délégués syndicaux un raisonnement par analogie avec l’obligation légale de discrétion et de confidentialité qui pèse sur les membres élus du CSE s’avère être une décision protectrice du droit syndical et plus largement du droit à l’information des salariés sur les données économiques et sociales de l’entreprise.
Par le passé, la jurisprudence avait déjà indiqué que ne pouvaient être considérées comme confidentielles les informations allaient être révélées aux salariés, dans le cadre d’une affaire défendue par le cabinet Atlantes, litige qui opposait la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études de conseil et de prévention CGT à la SAS Nielsen Services France (CA Versailles, 27 févr. 2019, no 16/04274).
Décision :
Tribunal Judiciaire de Paris, 1er juin 2021, n°21/54080
Alexandra PANTALACCI - Juriste IDF
En principe, dans les entreprises de plus de 50 salariés, un syndicat représentatif ne peut désigner en qualité de délégué syndical, qu’un candidat aux élections CSE ayant recueilli à titre personnel et, dans son collège, au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections CSE.
Autrement dit, pour pouvoir être désigné comme délégué syndical :
Cette règle est d’ordre public. Cela signifie, qu’il n’est pas possible d’y déroger même par accord d’entreprise.
Il peut, néanmoins, arriver qu’il n’y ait pas de candidat ayant obtenu une audience personnelle de 10%, ou que les candidats ayant obtenu 10% ne souhaitent pas endosser la casquette de délégué syndical.
De telles situations privent-t-elles alors le syndicat représentatif de désigner un délégué syndical dans l’entreprise ou l’établissement ? La réponse est non.
Par exception, le législateur a, en effet, prévu que le syndicat représentatif puisse recourir à des solutions alternatives en désignant un délégué syndical parmi :
S’il n’y a plus de candidats ayant obtenu 10% des suffrages, le syndicat doit, ainsi d’abord désigner un autre candidat n’ayant pas obtenu 10% des voix, et ce n’est qu’à défaut qu’il peut désigner un simple adhérent ou un ancien élu ayant atteint la limite de 3 mandats successifs au CSE (Cass soc, 12 avril 2018, n°17-60197).
Attention, cela ne sera toutefois légalement possible que si le syndicat représentatif se retrouve confronter à l’une des 3 situations suivantes (article L 2143-3 du Code du travail) :
- aucun des candidats qu’il a présentés n’a atteint les 10 %,
- ou il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles ayant obtenu au moins 10% des voix.
- ou l’ensemble des élus ayant obtenu les 10% des voix renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical (alinéa ajouté par la loi du 29 mars 2018 ratifiant l’ordonnance du 22 septembre 2017)
Est-ce alors à dire que le syndicat doit proposer à l’ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10%, toutes listes syndicales confondues, d’être désigné délégué syndical, avant de pouvoir désigner un candidat n’ayant pas obtenu 10% des voix ?
Non, la chambre sociale de la Cour de Cassation est venue rappeler que l’article L 2143-3 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, ne l’exige pas (Cass soc, 8 juillet 2020, n°19-14605)
Il en découle en conséquence qu’il n’est pas nécessaire non plus que tous les élus ayant obtenu 10% des voix aient renoncé à leur droit d’être désigné délégué syndical pour qu’un syndicat puisse désigner un candidat ayant obtenu moins de 10% des voix. La chambre sociale de la Cour de Cassation a, en effet, jugé qu’il suffit de s’assurer que l’ensemble des élus du syndicat concerné ont renoncé au mandat de délégué syndical ( Cass soc, 8 juillet 2020, n° 19-14077).
De la même façon, il n’est pas nécessaire que tous les candidats aient renoncé à leur droit d’être désigné délégué syndical. Il suffit que tous les candidats aient renoncé à être désigné délégué syndical pour que le syndicat puisse désigner comme délégué syndical l’un de ses adhérents ou l’un de ses anciens élus ayant atteint la limite de 3 mandats successifs ( Cass soc, 18 novembre 2020, n° 19-18341).
A la lecture stricto sensu de l’article L 2143-3 du Code du travail, il semble que si l’ensemble des « élus » ayant obtenu les 10% des voix renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un candidat n’ayant pas obtenu 10%.
L’utilisation du terme « élus » laisse, ainsi, à penser, que s’il reste des candidats non élus ayant obtenu 10% sur la liste du syndicat, ces derniers ne pourront pas renoncer à être délégué syndical. Or, si tel est le cas, cela signifie que dès lors qu’il reste des candidats ayant obtenu 10%, le syndicat ne peut pas désigner un délégué syndical parmi d’autres candidats…
Mettant fin à cette problématique, la chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé que l’article L 2143-3 du Code du travail devait être lu à la lumière des travaux préparatoires de la loi du 29 mars 2018, et être interprété ainsi : Tous les candidats élus ou non élus, ayant obtenu 10%, ont bien la possibilité de renoncer par écrit à leur désignation comme délégué syndical afin que le syndicat puisse choisir un candidat ayant obtenu moins de 10% ou à défaut un adhérent ou ancien élu ( Cass soc, 8 juillet 2020, n° 19-14605 ; Cass soc, 16 septembre 2020, n°19-15359)
Il a en outre été jugé dernièrement que pour qu’un syndicat puise désigner un candidat en application des règles supplétives, la renonciation devait nécessairement intervenir antérieurement à la désignation du candidat (Cass soc, 9 juin 2021, n°19-24678)
Anne-Lise MASSARD, Juriste IDF
En principe, dans les entreprises de plus de 50 salariés, un syndicat représentatif ne peut désigner en qualité de délégué syndical, qu’un candidat aux élections CSE ayant recueilli à titre personnel et, dans son collège, au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections CSE.
Autrement dit, pour pouvoir être désigné comme délégué syndical :
Cette règle est d’ordre public. Cela signifie, qu’il n’est pas possible d’y déroger même par accord d’entreprise.
Il peut, néanmoins, arriver qu’il n’y ait pas de candidat ayant obtenu une audience personnelle de 10%, ou que les candidats ayant obtenu 10% ne souhaitent pas endosser la casquette de délégué syndical.
De telles situations privent-t-elles alors le syndicat représentatif de désigner un délégué syndical dans l’entreprise ou l’établissement ? La réponse est non.
Par exception, le législateur a, en effet, prévu que le syndicat représentatif puisse recourir à des solutions alternatives en désignant un délégué syndical parmi :
S’il n’y a plus de candidats ayant obtenu 10% des suffrages, le syndicat doit, ainsi d’abord désigner un autre candidat n’ayant pas obtenu 10% des voix, et ce n’est qu’à défaut qu’il peut désigner un simple adhérent ou un ancien élu ayant atteint la limite de 3 mandats successifs au CSE (Cass soc, 12 avril 2018, n°17-60197).
Attention, cela ne sera toutefois légalement possible que si le syndicat représentatif se retrouve confronter à l’une des 3 situations suivantes (article L 2143-3 du Code du travail) :
- aucun des candidats qu’il a présentés n’a atteint les 10 %,
-ou il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles ayant obtenu au moins 10% des voix.
-ou l’ensemble des élus ayant obtenu les 10% des voix renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical (alinéa ajouté par la loi du 29 mars 2018 ratifiant l’ordonnance du 22 septembre 2017)
Est-ce alors à dire que le syndicat doit proposer à l’ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10%, toutes listes syndicales confondues, d’être désigné délégué syndical, avant de pouvoir désigner un candidat n’ayant pas obtenu 10% des voix ?
Non, la chambre sociale de la Cour de Cassation est venue rappeler que l’article L 2143-3 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, ne l’exige pas (Cass soc, 8 juillet 2020, n°19-14605)
Il en découle en conséquence qu’il n’est pas nécessaire non plus que tous les élus ayant obtenu 10% des voix aient renoncé à leur droit d’être désigné délégué syndical pour qu’un syndicat puisse désigner un candidat ayant obtenu moins de 10% des voix. La chambre sociale de la Cour de Cassation a, en effet, jugé qu’il suffit de s’assurer que l’ensemble des élus du syndicat concerné ont renoncé au mandat de délégué syndical ( Cass soc, 8 juillet 2020, n° 19-14077).
De la même façon, il n’est pas nécessaire que tous les candidats aient renoncé à leur droit d’être désigné délégué syndical. Il suffit que tous les candidats aient renoncé à être désigné délégué syndical pour que le syndicat puisse désigner comme délégué syndical l’un de ses adhérents ou l’un de ses anciens élus ayant atteint la limite de 3 mandats successifs ( Cass soc, 18 novembre 2020, n° 19-18341).
A la lecture stricto sensu de l’article L 2143-3 du Code du travail, il semble que si l’ensemble des « élus » ayant obtenu les 10% des voix renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un candidat n’ayant pas obtenu 10%.
L’utilisation du terme « élus » laisse, ainsi, à penser, que s’il reste des candidats non élus ayant obtenu 10% sur la liste du syndicat, ces derniers ne pourront pas renoncer à être délégué syndical. Or, si tel est le cas, cela signifie que dès lors qu’il reste des candidats ayant obtenu 10%, le syndicat ne peut pas désigner un délégué syndical parmi d’autres candidats…
Mettant fin à cette problématique, la chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé que l’article L 2143-3 du Code du travail devait être lu à la lumière des travaux préparatoires de la loi du 29 mars 2018, et être interprété ainsi : Tous les candidats élus ou non élus, ayant obtenu 10%, ont bien la possibilité de renoncer par écrit à leur désignation comme délégué syndical afin que le syndicat puisse choisir un candidat ayant obtenu moins de 10% ou à défaut un adhérent ou ancien élu ( Cass soc, 8 juillet 2020, n° 19-14605 ; Cass soc, 16 septembre 2020, n°19-15359)
Il a en outre été jugé dernièrement que pour qu’un syndicat puise désigner un candidat en application des règles supplétives, la renonciation devait nécessairement intervenir antérieurement à la désignation du candidat (Cass soc, 9 juin 2021, n°19-24678)
Anne-Lise MASSARD, Juriste IDF
Après avoir été présentée en Conseil des ministres le 02/06/2021, la loi de finances rectificatives pour 2021 a été adoptée par le Sénat le 12/07/2021. Celle-ci prévoit notamment la reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA ou prime Macron) pour 2021 (article 4). Cette loi est actuellement en attente de publication au JO.
Parmi les éléments à retenir :
- Elle doit être versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022.
- Elle est mise en place par accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités de l’article L. 3312-5 (accord d’intéressement) ou décision unilatérale de l’employeur (il n’y a pas de priorité entre les modes de conclusion) et peut être modulée selon la rémunération, le niveau de classification, la durée de présence effective ou la durée du travail. A noter la disparition des conditions de travail covid-19 (prévue pour la prime PEPA précédente).
- Elle sera exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour les salariés percevant moins de 3 fois le SMIC au cours des douze mois précédant son versement. Ce seuil peut être modifié dans l’accord ou la DUE mais les 3 SMIC constituent un maximum d’exonération.
- Le montant est librement fixé dans l’accord ou la DUE et est exonéré de cotisations dans la limite de :
- 1000€ en principe
- 2000€ si :
- conclusion d’un accord d’intéressement à la date du versement de la PEPA ou conclusion avant le versement de la prime et prenant effet avant le 31 mars 2022.
- conclusion d’un accord de branche ou d’entreprise qui identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou en 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire (salariés de la 2è ligne). Cet accord vise à valoriser les métiers des salariés identifiés précédemment. Il faut que cet accord porte sur au moins 2 des 5 thèmes suivants : rémunération, nature du contrat de travail, santé et sécurité au travail, durée du travail et articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, formation et évolution professionnelle.
- conclusion d’un accord de branche ou d’entreprise qui identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou en 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire (salariés de la 2è ligne). Cet accord prévoit l’engagement des parties à ouvrir des négociations sur la valorisation des métiers des salariés identifiés précédemment. Là encore, il faut que cet accord porte sur au moins 2 des 5 thèmes suivants : rémunération, nature du contrat de travail, santé et sécurité au travail, durée du travail et articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, formation et évolution professionnelle. Cet accord doit également fixer le calendrier et les modalités de suivis des négociations qui doivent s’engager dans un délai maximal de 2 mois après la signature de l’accord
- négociation en vue de conclure un accord d’entreprise pour valoriser les métiers des salariés de la 2è ligne ou si l’activité principale relève d’une branche ayant engagé de telles négociations
- effectif de l’entreprise inférieur à 50 salariés. La loi ne prévoit pas les conditions d’appréciation de cet effectif.
- dans les associations et fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général
Audrey LIOTE, Juriste AURA
Depuis le 2 juin 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021 l’état d’urgence sanitaire a cédé sa place à une période transitoire dans laquelle certaines mesures transitoires sont maintenues.
Les réunions des instances représentatives du personnel pourront toujours se tenir en visioconférence, conférence téléphonique voire messagerie instantanée en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit.
Si la réunion doit se tenir par téléphone un décret du 3 décembre 2020 fixe les modalités de réunion.
Pour la réunion des IRP organisée par messagerie, le décret détaille expressément la procédure à suivre :
— l’engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l’ensemble des membres a accès à des moyens techniques mis en place et qui doivent satisfaire aux conditions précédemment exposées (un dispositif technique qui garantisse l’identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations) ;
— les débats sont clos par un message du président de l’instance, qui ne peut intervenir avant l’heure limite fixée pour la clôture de la délibération ;
— le vote a lieu de manière simultanée : à cette fin, les participants disposent d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote indiquée par le président de l’instance ;
— au terme du délai fixé pour l’expression des votes, le président de l’instance en adresse les résultats à l’ensemble de ses membres.
Pour rappel, Un accord d’entreprise (ou à défaut, un accord de branche) peut autoriser l’employeur à imposer la prise de 8 jours de congés payés. L’accord permet également :
- d’imposer la prise de congés payés acquis de manière unilatérale, à hauteur de 8 jours, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, sous réserve de respecter un délai minimum d’un jour franc
- de modifier unilatéralement les dates d’un congé déjà posé, sous réserve de respecter un délai minimum d’un jour franc
- de fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
- de refuser un congé simultané à des conjoints ou des partenaires pacsés travaillant dans l’entreprise
L’employeur pourra également imposer la prise de 10 jours de repas et peut également, de façon unilatérale :
Les visites médicales à réaliser avant le 2 août 2021 peuvent être à nouveau reportées. La médecine du travail pourra également continuer de prescrire des certificats d’isolement ou des tests de dépistages.
Entretien professionnel et abondement du CPF
Les dispositions qui prévoient un abondement correctif au compte personnel de formation (CPF) du salarié, si celui-ci n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins une formation sont également suspendues jusqu’au 30 septembre 2021.
Pour rappel, L’entretien professionnel avec l’employeur consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi organisé tous les deux ans et l’entretien professionnel consacré à un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié qui doit avoir lieu tous les 6 ans.
Jusqu’au 30 septembre 2021, un accord collectif d’entreprise peut :
- fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD et un contrat de mission ;
- fixer les modalités de calcul des délais de carence entre deux contrats et prévoir les cas dans lesquels ce délai n’est pas applicable.
En outre, pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, peuvent être conclus ou renouvelés exceptionnellement pour une durée totale de 36 mois :
- les contrats à durée déterminée conclus par les entreprises d’insertion et les associations intermédiaires contractant avec des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
- les contrats de mission des entreprises de travail temporaire d’insertion ;
- les contrats uniques d’insertion et le versement des aides à l’insertion professionnelle qui y sont associées ;
- les contrats conclus avec les entreprises adaptées sans que la durée du renouvellement n’excède le terme de l’expérimentation « CDD tremplin » prévue, soit le 31 décembre 2022.
Maxence DEFRANCE, Juriste IDF
Depuis le 1er juillet 2021, la durée du congé de paternité est portée de 11 à 25 jours.
Premièrement, il convient de s’interroger sur la structure de ce nouveau congé paternité. En effet, le congé comporte 2 périodes distinctes : une période obligatoire de 4 jours calendaires prise immédiatement après la naissance de l’enfant (suite au congé de naissance de 3 jours) et une période facultative de 21 jours calendaires. Le congé peut être fractionné, le congé doit alors être pris en 2 périodes d’une durée minimale de 5 jours pour chaque période.
Vous remarquerez deux choses, la première étant qu’il s’agit d’un décompte en jours calendaires donc cela comprend tous les jours de la semaine, ce qui fait une période inférieure à 4 semaines.
La deuxième étant que la plus longue période composant ce nouveau congé (21 jours) est facultative, ce qui, d’une part n’est pas très incitatif et d’autre part, ouvre la porte à des pressions exercées par l’employeur pour éviter que les pères l’utilisent. A partir du moment où il s’agit d’une option, c’est conceptuellement envisagé comme discutable.
Deuxièmement, une mise en perspective s’impose, à l’heure où le gouvernement se glorifie d’une « avancée sociale majeure », les comparaisons internationales montrent que la durée du congé paternité français est courte. La Norvège a été le premier pays à introduire 15 ou 19 semaines (sous forme de quota paternel dans le cadre du congé parental : la mère dispose de 15/19 semaines de congé, puis le couple peut décider comment partager les 16/18 semaines restantes). En Finlande, le gouvernement a annoncé le 5 février 2020 l’intention d’allonger le congé de paternité, qui atteint la durée de 7 mois.
Troisièmement, il convient de comparer ce nouveau dispositif avec les propositions qui ont été faites par la commission des 1000 premiers jours rendu en septembre 2020, juste avant l’annonce de ce nouveau congé et la différence entre les propositions faites par ces experts et l’article 73 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale est édifiant.
En effet, dans son rapport, les experts préconisaient :
De ce rapport et de l’engagement du Ministère des Solidarités et de la Santé de « Veiller à ce que chaque enfant puisse s’éveiller et s’épanouir dans les meilleures conditions […] », le gouvernement n’a acté d’utile que de proposer un congé paternité de 4 semaines et de ne rien modifier à la durée du congé maternité et du congé parental d’éducation.
Alors même qu’ « il est bien établi que la durée du temps partagé par les parents et l’enfant fait partie des éléments déterminants de la qualité de l’attachement qui, à son tour, assure la base pour un développement harmonieux. »
La durée de ces congés n’est pas seulement la question de la place de la parentalité dans notre société mais aussi une question de santé publique (sécurité affective ayant un impact majeur sur le développement de l’enfant et son bien être futur ; dépressions post-partum des mères qui nécessitent parfois suivi psychologique, arrêt de travail et traitement médicamenteux) et d’égalité hommes-femmes.
Comment peut-on se prévaloir d’une « nouvelle avancée en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes »[2] tant qu’on ne donnera pas aux hommes la même possibilité de s’occuper de leur foyer ?
Les pouvoirs politiques pourront prétendre changer les choses et viser l’égalité hommes/femmes lorsqu’ils créeront un congé deuxième parent obligatoire, égal au congé maternité et qu’ils prendront conscience de l’importance de laisser le temps aux familles de trouver leur nouvel équilibre avant de reprendre le chemin du travail.
Alison VILLIERS - Juriste/ Atlantes région-ouest
[1] Rapport de la commission des 1000 premiers jours par le Ministère des solidarités et de la santé, septembre 2020
La situation dans laquelle se trouvent certaines entreprises conduit les directions à prendre des décisions lourdes de conséquences. Entre licenciements économiques, Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE), Rupture Conventionnelle Collective (RCC), Accord de Performance Collective (APC) ou Activité Partielle de Longue Durée (APLD), les outils pour y répondre ne manquent pas.
Plus que jamais CSE et Organisations Syndicales doivent s’imposer comme des acteurs incontournables pour éviter certaines dérives et devenir de véritables forces de proposition.
Atlantes se propose de mettre son expérience à votre service afin de faire le point sur ces sujets techniques et complexes dans le cadre de deux Webinaires.
Inscrivez vous à l’un de nos Webinaires du 24 ou du 29 juin 2021 à 11h pour échanger avec nos intervenants juristes et avocats du cabinet.
S’inscrire gratuitement en cliquant ICI
Faute d’accord prévoyant une périodicité différente (au maximum 4 ans) doit avoir lieu chaque année une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail (articles L.2242-1 et L.2242-13 du Code du travail).
Conformément à l’article L.2315-94 du Code du travail, il est prévu que le CSE puisse, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, faire appel à un expert en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.
A la lecture des textes, nombre de questions demeuraient en suspens. Dans cette première jurisprudence rendue en matière d’expertise sous l’égide du CSE, la Cour de cassation vient ici préciser un certain nombre de points.
1/ Co-financement de l’expertise ? ça dépend !
Il conviendra de distinguer deux cas de figures :
2/ Autres précisions de la Cour de cassation
La Cour de cassation apporte également d’autres précisions dans cet arrêt :
Cass.soc., 14 avril 2021, n°19-23589
Maxence DEFRANCE, Juriste – Atlantes Paris/Île-de-France
Pour tout savoir sur le fonctionnement du CSE, notre catalogue de formation ici
Il ne fait nul doute que pour certaines entreprises la crise sanitaire aura des conséquences sur les comptes et plus généralement la situation économique de l’entreprise.
Pour les partenaires sociaux de l’entreprise, la négociation constitue un rendez-vous périodique permettant notamment de revaloriser les salaires. Ce rendez-vous est tout particulièrement suivi par les salariés.
Une question nous a été régulièrement posée : doit-on mener cette négociation malgré la crise sanitaire ?
1/ Une obligation légale de négocier
Pour rappel, dans toutes les entreprises dans lesquelles sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, les dispositions légales d’ordre public prévoient une négociation a minima tous les quatre ans sur certains sujets (article L.2242-1 du Code du travail). Si la périodicité de 4 ans est un minimum d’ordre public, un accord collectif d’entreprise peut définir la périodicité et les modalités de ces négociations obligatoires sous réserve que chaque thème soit discuté au moins une fois tous les 4 ans. Faute d’accord d’entreprise sur ces sujets il conviendra de négocier (article L.2242-13 du Code du travail) :
Tous les ans sur :
Tous les trois ans sur :
L’employeur qui n’engage pas les négociations obligatoires s’expose à une peine d’emprisonnement de 1 an et à une amende de 3 750 € (article L. 2243-1 du Code du travail). En sus l’entreprise qui ne négocie pas sur les salaires s’expose à des pénalités financières (article L.2242-7 du Code du travail).
Ces dispositions comme les sanctions applicables n’ont pas été suspendues durant la crise sanitaire.
2/ Obtenir un état général de la situation économique de l’entreprise
Le Code du travail invite à définir la méthode de négociation permettant à la négociation d’être menée « dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. »
Un tel accord cadre aura vocation à préciser (article L.2222-3-1) :
En tout état de cause, lors de la première réunion sont précisés :
- Le lieu et le calendrier de la ou des réunions ;
- Les informations que l’employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise.
Conseil Atlantes - Il sera dès lors nécessaire afin de pouvoir se mobiliser dans le cadre de la négociation d’être proactif dans le cadre de cette première étape de recueil des éléments d’informations. Une première analyse de la BDES et des documents remis par la direction sera pertinente afin d’identifier les éléments pour cette négociation qui pourraient être demandés en sus à la direction. Ce n’est qu’en disposant d’une information complète et à jour que les délégués syndicaux pourront appréhender la situation de l’entreprise et formuler des demandes pertinentes dans le cadre de la négociation : Documents prévisionnels, évolution des rémunérations des dirigeants, aides de l’Etat, etc
3/ Pensez aux impacts de la crise sanitaire sur les budgets du CSE
Le Code du travail indique que cette négociation sur la rémunération porte sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée mais ne se limite pas à ces sujets. Dès lors il peut être pertinent de porter la négociation sur de nouveaux thèmes.
Il peut par exemple s’agit de négocier sur les impacts de l’activité partielle sur les budgets du CSE.
En effet, comme nous l’avions déjà indiqué dans notre article sur le sujet (à relire ici : https://atlantes.fr/Impact-de-l-activite-partielle-sur-les-budgets-du-CSE) l’activité partielle aura nécessairement des effets sur les budgets du CSE qu’il peut être pertinent de pallier afin de permettre au CSE de maintenir son offre en matière d’ASC.
Maxence DEFRANCE, Juriste – Atlantes Paris/Île-de-France
Vous voulez vous former sur ce sujet ? Vous pouvez retrouver notre catalogue de formation en cliquant ici
En 2014, la branche énergie du groupe Alstom est rachetée par Général Electric (GE) donnant lieu à un premier accord au sein duquel GE s’engage à maintenir BELFORT comme centre de décision et à embaucher.
En 2019 GE lance une restructuration avec un PSE. Après des semaines de mobilisation, plusieurs accords permettent de réduire le nombre de licenciements envisagés en contrepartie de mesures d’économies pour les salariés, mais également engagent GE, sous l’égide de l’Etat, à la mise en œuvre d’un projet industriel prévoyant notamment la diversification de certaines activités et la réaffirmation de centres décisionnels sur le site de Belfort. Pour l’intersyndicale SUD CFE CGC, les engagements des accords de 2014 et 2019 n’ont pas été tenus, avec comme raison avancée : de nouveaux arbitrages budgétaires liés aux conséquences du Covid.
Accompagnés par Me Evelyn BLEDNIAK et Me Diego PARVEX, les syndicats ont assigné GE afin de contraindre l’entreprise au respect de ses engagements. Par ailleurs, la procédure devant le tribunal Judiciaire n’interdit pas la saisine de la juridiction administrative afin de faire respecter les engagements pris par l’Etat.
Le combat des salariés de GE a donné lieu à plusieurs publications de presse faisant intervenir Me Diego PARVEX.
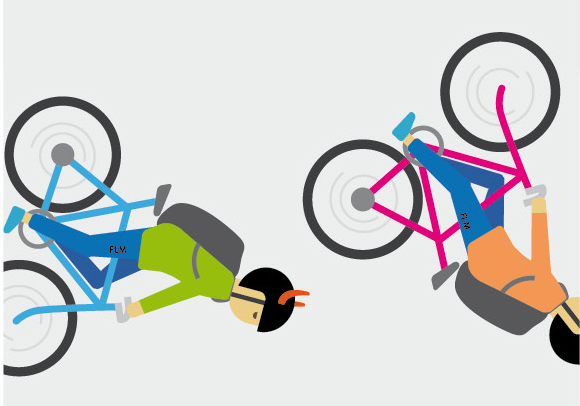
Le statut des travailleurs de plateformes ne cesse, depuis ces dernières années, d’alimenter le débat politique, social et juridique. En témoigne notre dernière actualité sur le sujet dans notre Plume du mois de septembre 2020 , faisant suite à de nombreuses actualités sur notre site
Pour rappel, la saga jurisprudentielle avait débuté par un arrêt de la Cour de Cassation qui avait caractérisé l’existence d’un lien de subordination, et par-là même d’un contrat de travail, entre la plateforme et le travailleur dit « indépendant ». La France se prononçait ainsi en faveur d’une assimilation des travailleurs de plateformes à des salariés afin de les faire bénéficier du même statut protecteur (Cass. soc., 28 nov. 2018, n° 17-20.079, FP-PBRI ; Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316, FP-PBRI ; Cass. soc., 24 juin 2020, nº 18-26.088 F-D).
Cette jurisprudence audacieuse n’a malheureusement donné naissance qu’à de timides interventions de la part du législateur. Tout d’abord en 2016, avec la loi « Travail », puis en 2019, avec la loi « LOM », lesquelles se sont contentées de créer dans le Code du travail un statut spécifique pour ces « travailleurs indépendants », les écartant ainsi astucieusement du bénéfice de celui applicable aux salariés.
Dans le prolongement de ces interventions législatives, une ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021, relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation, a été publiée le 22 avril 2021 au Journal officiel.
Cette ordonnance est venue créer, pour les secteurs d’activité de conduite et de livraison de marchandises, la possibilité pour les travailleurs de plateformes de se doter de représentants du personnel, d’une part, et d’autre part, un statut protecteur du travailleur représentant.
À la lecture de l’ordonnance et du rapport afférent, le contenu de ses dispositions ne sont pas sans nous rappeler les règles applicables aux salariés, tant sur le plan de la mise en place des représentants des travailleurs de plateformes, que sur celui du statut protecteur applicable aux travailleurs élus représentants :
- organisation d’élections professionnelles par l’employeur ;
- critères de représentativité des organisations habilitées à présenter des candidats aux élections ;
- organisation d’un scrutin par vote électronique tous les quatre ans, sauf pour les deux premières mesures d’audience ;
- demande d’autorisation préalable en cas de rupture du contrat commerciale du travailleur représentant auprès d’une nouvelle autorité administrative ad hoc (l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi ou Arpe) ;
- formation et heures de délégation au profit du travailleur représentant ;
- création d’un chapitre relatif au « dialogue de plateforme », qui reste vide à l’heure actuelle, mais est destiné à accueillir le cadre et les modalités de négociation collective entre les plateforme et les représentants des travailleurs.
- obligation pour les plateformes de publier sur leur site internet, à compter de 2022, des indicateurs relatifs à la durée d’activité et au revenu d’activité des travailleurs sur l’année précédente (D. n°2021-501, 22 avr. 2021 : JO, 25 avr. :)
L’intention du législateur est donc claire : éviter toute assimilation des travailleurs de plateforme à des salariés, qui « [menacerait] la sécurité juridique et la liberté des relations qui peuvent exister entre les travailleurs et les entreprises », comme le souligne un syndicat des avocats d’entreprise en droit social.
Toutefois, force est de constater que la création d’un statut spécifique aux travailleurs de plateformes par le législateur, qui s’avère en réalité plus proche de celui applicable aux salariés qu’à celui applicable aux travailleurs indépendants, révèle l’artificialité des règles qu’il édicte.
Face à la volonté persistante des pouvoirs législatif et politique de distinguer deux situations de travail qui, dans leur exécution concrète, sont semblables, et ce au mépris des évolutions législatives européennes, où des pays comme l’Espagne, l’Italie, la Suisse ou encore la Grande-Bretagne ont reconnu la qualité de salariés des travailleurs de plateformes, la lutte contre la précarisation des emplois doit continuer à être menée !
Alexandra Pantalacci, Juriste – Atlantes Paris/Île-de-France
Dans les esprits collectifs, le 1er mai semble s’être érigé comme la fête du travail, une journée non travaillée, faisant la joie des vendeurs de muguets. Mais que fêtons-nous réellement le 1er mai ? La question mérite en effet d’être posée, puisqu’avant d’être un jour férié, et bien loin de célébrer les dynamismes de production et les avancées technologiques, cette journée trouve ses origines dans les luttes ouvrières.
Le premier constat que l’on peut faire avec certitude est que le 1er mai, n’était pas la fête du travail. La genèse de cette journée prend racine aux Etats-Unis, dans les années 1880, et s’organise autour d’une idée à l’époque révolutionnaire : conquérir la journée de huit heures. En 1884, lors d’un congrès de l’American Federation of Labor, les syndicats décident d’organiser une grève générale et se donnent deux ans pour imposer une limitation de la journée de travail à huit heures.
C’est ainsi que le 1er mai 1886, pas moins de 340 000 ouvriers entreront en grève, portés par une même revendication. Mais rapidement, plusieurs événements sanglants viendront ternir cette journée. Le 3 mai, à Chicago, une fusillade de policiers fera plusieurs morts. Le lendemain, une bombe explosera devant les forces de l’ordre, provoquant la mort de plusieurs d’entre eux. Cinq syndicalistes seront désignés responsables de ces violences et seront condamnés à mort : quatre seront pendus le 11 novembre 1887.
Trois ans plus tard, en mémoire de cette grève et de ces manifestants tués pour avoir réclamé la journée de huit heures, la IIe Internationale socialiste (qui se réunit à Paris pour le centenaire de la Révolution française) décide de faire de chaque 1er mai une journée dédiée aux revendications des travailleurs, avec pour objectif la réduction de la journée de travail à huit heures. Ce mouvement fondateur prendra à son tour une tournure dramatique : le 1er mai 1891, à Fourmies, les troupes de police ouvriront le feu sur les manifestants, causant la mort de neuf d’entre eux. Avec ce nouveau drame, la journée du 1er mai s’enracine dans une tradition des luttes ouvrières, teintées de rouge et de noir.
Mais qu’en est-il aujourd’hui ? Un siècle et demi plus tard, et un nouveau paradigme semble s’être installé. Au-delà d’une volonté étatique au fil des années de s’emparer de ce symbole des luttes ouvrières (on pense notamment au Régime de Vichy qui transforma par la loi cette journée en « fête nationale du travail »), les évolutions et les transformations de nos sociétés ont indéniablement impacté la nature même de cette journée du 1er mai.
En effet, ces dernières décennies ont fait la part belle à la mondialisation, au développement des nouvelles technologies et à la montée des activités de services, accentuant une profonde mutation du monde du travail et une grande disparité dans les situations d’emploi : modernisation des procédés de production, restructurations industrielles, fermeture de sites de production, suppression d’emplois, essor de l’auto-entreprenariat à travers notamment « l’ubérisation » de la société. Les objectifs sociaux menés par les mouvements ouvriers lors des années 1880 sont aujourd’hui mis à rude épreuve face aux transformations auxquelles nos sociétés sont confrontées, donnant au 1er mai une dimension moins revendicatrice que symbolique. Mais les organisations syndicales ont su au fil des années conquérir les espaces dédiés au 1er mai, agissant de manière collective et portant chaque année lors des manifestations les revendications des travailleurs.
La situation actuelle peut nous permettre de nous repenser en tant que communauté, puisque depuis maintenant plus d’un an, nous sommes toutes et tous confrontés aux dégâts causés par la crise sanitaire, qui a impacté de manière considérable nos droits, nos libertés, et nos emplois. La nécessité d’un collectif nous apparait aujourd’hui plus que nécessaire, afin de réaffirmer l’importance des combats menés par le passé et des luttes sociales à venir, indispensables à une meilleure protection des travailleurs et de leurs droits durement acquis au fil des temps.
Samuel BENCHEIKH - Juriste/ IDF
Tel est le débat sociétal qui fait suite au premier congé menstruel accordé aux femmes dans une entreprise française.
Un dispositif qui a été créé par une société commerciale inscrite dans le mouvement de l’économie sociale et solidaire. Tous les salariés de la SCOP « La Collective » ont donc la particularité d’être également associé (chacun détient une part sociale de l’entreprise) et l’organisation est régit par une gouvernance démocratique (1 associé(e) = 1 voix).
C’est dans ce contexte que les salariés/associés de cette structure ont pu décider de mettre en place, pour une durée expérimentale fixée à an, un jour de congé mensuel, supplémentaire et facultatif pour les femmes qui auraient des règles douloureuses.
Certaines associations féministes ont pu dénoncer l’effet stigmatisant de cette nouvelle mesure.
D’un point de vue juridique, c’est une mesure qui permet la prise en compte de la santé du salarié, qui participe au bien-être au travail puisqu’elle permet au salarié de se reposer sans avoir de perte de salaire. Car, rappelons-le, tous les salariés de droit privé ne bénéficient pas d’un maintien de leur salaire en cas d’arrêt maladie en vertu d’accords collectifs (de branche ou d’entreprise). Une salariée souffrant de dysménorrhée ou d’endométriose se verra appliquer un délai de carence de 3 jours conformément aux règles fixées par la sécurité sociale et subira donc une perte de salaire.
Il s’agit donc d’un avantage accordé aux salariées dans l’entreprise. Un avantage qui évidemment tient compte de leur condition féminine mais au même titre que le bénéfice du congé maternité prévu par la loi.
Il convient de rappeler que cette initiative a été prise dans une entreprise au fonctionnement bien spécifique et le dispositif profite à un nombre restreint de salariées (la structure comptant 16 salariés de sexe féminin). Est-ce que les directions des entreprises de plus de 50 et/ou 300 salariés seront enclins à accorder ce congé ? Est-ce que les délégués syndicaux seraient prêts à en faire une revendication lors de leurs prochaines négociations annuelles obligatoires (NAO) ? L’avenir nous le dira.
Alison VILLIERS, Juriste/ IDF
Depuis le 22 février 2021, l’Assurance maladie a ouvert un nouveau téléservice « Déplacement pour motif impérieux » sur declare.ameli.fr pour les assurés de retour d’un déplacement pour motif impérieux (professionnel ou personnel) qui se trouvent dans l’impossibilité de télétravailler pendant la période d’isolement d’une durée de 7 jours à compter du jour de leur retour.
Pour rappel, cette obligation d’isolement concerne les déplacements :
À l’issue de ces 7 jours, l’assuré doit réaliser un test de dépistage pour pouvoir lever son isolement.
Cet arrêt de travail dérogatoire peut donc couvrir une période allant jusqu’à 9 jours maximum. Les 9 jours maximum de l’arrêt de travail comprennent les 7 jours d’isolement et 2 jours au maximum pour le rendu du résultat du test de dépistage de la Covid-19.
Pour les salariés de droit privé, la demande est effectuée par l’employeur qui déclare l’arrêt de travail dérogatoire via le téléservice sur declare.ameli.fr.
Avant de réaliser cette demande en ligne, il appartiendra à l’employeur de s’assurer que le salarié remplit les conditions d’indemnisation. L’Assurance Maladie pourra effectuer des contrôles et, dans ce cas, des pièces justificatives pourront être demandées.
Au moment d’effectuer la demande, l’employeur devra impérativement :
L’attestation de salaire nécessaire au règlement des indemnités journalières par l’Assurance Maladie sera transmise dans les conditions habituelles via la DSN ou sur net-entreprises.fr.
Comme pour les autres arrêts de travail dérogatoires, les indemnités journalières seront versées sans conditions d’ouverture de droits, sans délai de carence et sans qu’elles soient comptabilisées dans les durées maximales de versement de ces indemnités.
Le complément employeur « légal » sera versé sans conditions d’ancienneté et sans délai de carence, au bénéfice des salariés qui en sont en principe exclus (travailleurs à domicile, salariés saisonniers, salariés intermittents et salariés temporaires) et sans prendre en compte les arrêts indemnisés au cours des 12 mois précédant la date de début de l’arrêt, ni l’arrêt lui-même, pour le calcul de la durée totale d’indemnisation sur 12 mois
<img953|center>
Alexandra PANTALACCI – Juriste / IDF

Pour faire face à l’urgence sanitaire, l’ordonnance n°2021-135 du 10 février 2021 prolonge la possibilité de reporter certaines visites médicales, initialement encadrée par l’ordonnance n°2020-1502 du 2 décembre 2020 et le décret n°2021-56 du 22 janvier 2021. Faisons le point ensemble.
Désormais, ce sont les visites médicales devant avoir lieu avant le 2 août 2021 qui peuvent être reportées par le médecin du travail dans la limite d’un an, excepté lorsqu’il estime indispensable le maintien de la visite au regard de l’état de santé du salarié ou des caractéristiques de son poste de travail.
A ce jour et sous réserve de dispositions ultérieures, les visites programmées, après le 1er août 2021, ne peuvent donc faire l’objet d’un report.
Initialement, l’ordonnance du 2 décembre 2020 limitait le report aux visites médicales devant intervenir avant le 17 avril 2021.
Reste à savoir quelles seront les visites médicales pouvant faire l’objet de ce report. En effet, le décret n°2021-56 du 22 janvier 2021, listant les visites susceptibles de faire l’objet du report, concernait les visites devant être organisées avant le 17 avril 2021. Dès lors, un nouveau décret devrait paraître dans les semaines à venir.
A titre d’information, aux termes du décret du 22 janvier 2021, étaient concernées par ce report :
- La visite d’information et de prévention initiale, sauf exceptions détaillées ci-après ;
La visite d’information et de prévention périodique ;
L’examen d’aptitude périodique et la visite intermédiaire pour les salariés bénéficiant d’un suivi médical renforcé, sauf exception.
En cas de report, le médecin du travail devait en informer l’employeur et le cas échéant s’il disposait des coordonnées, le salarié, en leur communiquant la date retenue.
A l’inverse, certaines visites médicales, en raison de la vulnérabilité des salariés concernés ou de leur affectation sur certains postes, ne pouvaient être reportées. Il s’agissait de :
NB : Pour aller plus loin sur les agents biologiques de groupe 2, nous vous invitons à consulter le site de l’INRS : https://www.inrs.fr/risques/biologiques/reglementation.html
A noter, le décret n°2021-56 du 22 janvier 2021 autorisait le médecin du travail, jusqu’au 16 avril 2021, a confié la réalisation de ces visites à un infirmier en santé au travail, excepté pour les visites de reprise en cas de suivi médical renforcé. Ces visites restaient sous la responsabilité du médecin du travail. En outre, seul le médecin du travail était habilité à émettre des recommandations dans le cadre d’un reclassement ou d’un aménagement du poste de travail et à rendre un avis d’inaptitude.
Nous vous informerons de la parution du nouveau décret.
Floriane Burette, Juriste – Référente Ile de France

L’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles a publié une nouvelle version en ligne de son outil de diagnostic, appelé « grille de positionnement en santé et sécurité au travail » (GPSST), qui offre aux acteurs de la prévention (IRP, HSE etc.) une démarche personnalisable pour définir leurs propres priorités d’actions, accessible via le lien suivant : https://www.inrs.fr/publications/outils/GPSST/outil.html
Cet outil d’auto-évaluation collective permet aux acteurs de la prévention des risques professionnels :
- d’établir une description précise et documentée de l’organisation de la prévention ;
- de soutenir la mise en œuvre d’une démarche de prévention en sélectionnant les actions prioritaires les plus pertinentes à mettre en place ;
- de favoriser la discussion et le débat en confrontant les différents points de vue.
La GPSST permet de comparer la situation de l’entreprise à des situations types de prévention dans sept domaines d’évaluation :
- Analyse et suivi des accidents du travail et maladies professionnelles,
- Evaluation des risques et plan d’action,
- Conception du travail et de ses transformations,
- Conduite et maîtrise des activités,
- Formation et compétences pour la santé et sécurité au travail,
- Communication et implication des salariés,
- Politique de prévention et leadership en santé et sécurité au travail.
Avec cette nouvelle version plus ergonomique, l’utilisateur peut personnaliser l’outil pour l’adapter au mieux aux pratiques de son entreprise : il peut notamment créer ses propres thèmes à partir de situations typiques dans son entreprise et ajouter des descriptions de situations.
Les résultats sont synthétisés sous forme graphique et donnent accès à un bilan et des priorités d’action.
En utilisant cette grille de positionnement à intervalles réguliers, l’entreprise peut suivre l’évolution de ses pratiques et l’état d’avancement de ses plans d’actions.
La GPSST est un outil de diagnostic partagé des pratiques de prévention adapté à la plupart des entreprises. Il permet d’évaluer l’organisation de la prévention des risques de l’entreprise de manière détaillée et collective. En comparant la situation de l’entreprise à des situations types de prévention dans sept domaines d’évaluation, l’utilisateur bénéficie d’un état des lieux précis de ses pratiques et de son engagement en matière de prévention.
Comme le rappelle l’INRS une pareille démarche est pertinente dans le cadre d’un dialogue associant les salariés et leurs représentants ce qu’il conviendra de mettre en avant en veillant à consacrer le temps et les moyens nécessaires.
Alexandra Pantalacci – Juriste, Atlantes IDF
Au journal officiel du 10 mars 2021 est publié le décret n° 2021-259 du 9 mars 2021 élargissant au bénéfice des parents d’enfants décédés le dispositif de don de jours de repos non pris
Le texte vient ainsi modifier le décret du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil de donner anonymement des jours de repos à un autre agent public, en y ajoutant un nouveau cas de don de jours au profit du parent d’un enfant qui décède avant l’âge de 25 ans ou assume la charge effective et permanente d’une personne qui décède avant cet âge.
Le don est fait sous forme de jour entier.
Le service gestionnaire ou l’autorité territoriale ou, dans les organismes régis par le code de la santé, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose de 15 jours ouvrables pour informer l’agent bénéficiaire du don de jours de repos.
La durée du congé dont l’agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée à 90 jours par enfant ou par personne concernée.
Le congé peut être pris pendant un an à compter de la date du décès, en une ou plusieurs fois à la demande de l’agent.
L’agent civil qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos formulera sa demande par écrit auprès de son service gestionnaire ou de l’autorité territoriale ou, dans les établissements publics de santé et les établissements publics (I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles), de l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève.
Cette demande est accompagnée du certificat de décès. Dans le cas du décès d’une personne de moins de vingt-cinq ans dont l’agent a la charge effective et permanente, la demande est également accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant cette prise en charge.
Frédéric PAPOT, Atlantes, Juriste IDF.
En débutant les premières pages de A la Ligne (Feuillets d’usine), le lecteur est immédiatement placé face à une montagne de crevettes, de poissons, de crabes et de bulots. Et puis c’est la bascule vers l’abattoir, les carcasses, les tripes, le sang.
C’est partager au fil des pages l’épuisement de cette « armée de réserve » qui monte au front en pleine nuit, dans le froid, sous la pression des chefs qui rôdent.
C’est passer son temps … à compter les bêtes … à compter les heures … à compter les jours. Les crevettes reviennent sans cesse au rythme de 3 tonnes par heures. Tout ça parce qu’il faut produire, produire et produire encore. Pour qui ? Pour quoi ? Pourquoi ?

confronté aux incertitudes du lendemain, balloté de ci de là au gré de la demande. Toujours disponible.
« L’intérim m’a appelé à seize heure trente le lundi pour une embauche le soir même à vingt heure » (page 122)
C’est côtoyer un monde qui courbe l’échine, y laisse un morceau de doigt, un dos en vrac, pour quelques sous. Un monde de débrouille et de réelle solidarité.
On y croise Trenet, Johnny, Beckett, Kopa, Apollinaire, Barbara ou Franju. La musique et la poésie ne sont jamais très loin.
L’océan comme une bouée. Houat comme un oasis.
Un texte bouleversant. Ecrit au scalpel. Tellement juste.
Date de publication : 2019-01-03 Editeur : éditions de La Table Ronde EAN / ISBN-13 : 9782710389668
Olivier Cadic
Et pour aller plus loin, l’Usine Nouvelle rediffuse l’entretien réalisé il y a un an avec celui-ci.
Depuis octobre 2020, le recours au télétravail est généralisé pour les activités qui s’y prêtent. Ce recours était porté, dans un premier temps, à 100% pour les salariés qui pouvaient effectuer l’ensemble de ses tâches à distance. Puis, le protocole a été assoupli par la suite. Ainsi, l’employeur pourra justifier la présence de salariés dans les locaux de l’entreprise lorsque son activité se prête au télétravail, notamment lorsque :
- Les fonctions managériales nécessitent une présence minimale pour encadrer les équipes qui ne peuvent pas télétravailler ;
- Certains outils nécessaires à l’activité ne sont pas accessibles à distance ;
- Des salariés rencontrent des difficultés ou des contraintes particulières dûment justifiées.
Pour autant, le ministère du travail a constaté une érosion de ce mode d’organisation du travail depuis novembre parmi les salariés pouvant télétravailler. Par conséquent, la direction générale du travail a adressé, le 3 février, une nouvelle instruction aux services de l’inspection du travail afin de renforcer l’accompagnement et le contrôle sur la mise en œuvre du télétravail. Il leur ait demandé, notamment :
- De vérifier systématiquement les mesures prises pour lutter contre le risque de contamination et la mise en œuvre du télétravail lors de tout contrôle dans une entreprise. Cela portera notamment sur les conditions d’information et de consultation du CSE, sur la définition des tâches « télétravaillables » et les modalités pratiques de mise en œuvre du télétravail ;
- De contacter les entreprises des secteurs où le télétravail est facilement applicable mais moins pratiqué, pour s’assurer du respect des recommandations ;
- De mobiliser les partenaires sociaux, afin d’insister sur l’enjeu que constitue le recours au télétravail et sur l’importance d’associer les représentants du personnel dans sa mise en œuvre ;
- De rappeler aux PME l’appui que peut leur fournir l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail et son réseau régional (Anact-Aract) pour faciliter le déploiement du télétravail ;
- De rappeler aux entreprises l’aide que peut leur apporter leur service de santé au travail pour la mise en place du télétravail et la prévention des risques professionnels qui y sont liés (isolement, lombalgies, RPS, etc.) ;
- De faire connaître le numéro vert mise en place pour répondre aux difficultés rencontrées par les télétravailleurs.
Il semble opportun de rappeler, toutefois, que le juge des référés du Conseil d’Etat, dans une ordonnance du 19 octobre 2020, qualifie la valeur du protocole sanitaire de non-contraignante pour l’employeur, en rappelant toutefois que ce dernier a une obligation en matière de santé des salariés. Ainsi, l’inspection du travail, en la matière, ne se voit pas attribuer de pouvoir coercitif.
Marine AZAIS, juriste IDF
Les directions régionales de entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) sont désormais intégrées dans les directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Nb : En Ile de France il s’agira de la DRIEETS (direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités en ile de France) et des DRETS (directions de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités en outre-mer) dans l’outre-mer.
Ce nouveau service déconcentré de l’Etat regroupe désormais les prérogatives des anciennes DIRECCTE et des services déconcentrés chargés de la cohésion sociale.
Pour toutes les missions relatives à l’inspection du travail, elles demeurent placées sous l’autorité de la Direction générale du travail.
Au niveau départemental, les Direccte seront intégrées aux directions départementales de la cohésion sociale pour former de nouvelles directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités : les DDETS.
Maxence DEFRANCE, Juriste île de France
Les congés payés sont un droit pour les salariés, dont l’employeur est tenu d’assurer l’effectivité en prenant les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’exercer son droit à congé.
Néanmoins, cela ne signifie pas que les dates des congés payés soient déterminées avec l’accord des salariés...
Le 1er réflexe : vérifier les dispositions de la convention collective ou d’un accord collectif applicable dans l’entreprise
La période de prise des congés dans l’année, l’ordre des départs en congé des salariés pendant cette période, ainsi que les délais à respecter par l’employeur pour modifier l’ordre ou la date des départs en congé sont en principe fixés par accord d’entreprise ou d’établissement (art. L. 3141-15 du Code du travail).
Afin de connaître les règles régissant la prise des congés payés dans l’entreprise, il convient donc en priorité de consulter les dispositions d’un tel accord, et/ou de la convention collective.
A défaut d’accord, l’employeur définit, après avis du Comité social et économique (CSE) (art.L.3142-16 du Code du travail) :
L’employeur devra obligatoirement accorder un congé simultané aux salariés de l’entreprise vivant en couple (art. L.3141-14 du Code du travail).
A noter : L’employeur reste toutefois tenu d’exécuter le contrat de travail de bonne foi, et devra donc s’efforcer de prendre en compte les souhaits exprimés par les salariés.
A défaut d’accord collectif, l’employeur peut, après consultation du CSE, imposer la prise de congés payés aux salariés pendant une période de fermeture de l’entreprise, dans la limite du congé principal (soit 24 jours ouvrables), ou de la 5ème semaine de congés payés uniquement.
A condition qu’une telle possibilité ait été accordée à l’employeur par accord d’entreprise ou, à défaut, de branche, l’employeur peut imposer ou modifier la date de prise de 6 jours de congés payés, et déroger aux dispositions d’ordre public régissant les congés payés.
A noter : Si l’intérêt économique de l’entreprise le justifie, l’employeur peut également imposer unilatéralement la prise de 10 jours de repos (RTT, repos compensateur, au titre d’un forfait jours, ou placés sur le CET).
Marion STOFATI, Avocat au Barreau de Marseille
Les titres restaurants sont normalement utilisables pendant l’année civile de leur émission et les mois de janvier et de février de l’année suivante.
A titre exceptionnel, la période d’utilisation des titres restaurants de l’année 2020 est prorogée jusqu’au 31 août 2021. Les titres non utilisés au cours de cette période sont rendus par les salariés bénéficiaires à leur employeur afin d’être échangés gratuitement.
A préciser également que lorsque ces titres sont utilisés dans des restaurants et hôtels-restaurants ou des débits de boissons assimilés, ceux-ci sont utilisables les dimanches et jours fériés jusqu’au 31 août 2021 également. Leur utilisation est limitée à un montant maximum de 38 euros.
Maxence DEFRANCE, Juriste île de France
Le principe est le suivant : il est interdit à l’employeur de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail (R.4228-19 du Code du travail).
Afin d’adapter le dispositif légal aux conditions sanitaires actuelles et notamment aux nouvelles règles applicables aux restaurants d’entreprise (à retrouver ici ) le décret n°2021-156 du 13 février 2021 autorise exceptionnellement la prise de repas dans les locaux de travail.
Deux cas vont être à distinguer, selon l’effectif de l’établissement.
Dans les établissements de plus de 50 salariés
Lorsque le local de restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements à l’intérieur des locaux de travail.
Ces locaux ne sont pas contraints de comporter les équipements exigés par le Code du travail.
NB : Le Code du travail exige habituellement un local de restauration pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporte un robinet d’eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers. Il est doté d’un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d’une installation permettant de réchauffer les plats (article R.4228-22).
Dans les établissements de moins de 50 salariés
Une exception existe déjà dans les entreprises de moins de 50 salariés qui peuvent après déclaration adressée à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail et seulement si l’activité de ces locaux ne comporte pas l’emploi et le stockage de substances ou de mélanges dangereux. Durant l’application du présent dispositif, l’employeur est exonéré de déclaration.
Impératifs de sécurité
Les emplacements choisis par la direction doivent permettre aux travailleurs de se restaurer dans des conditions, s’agissant en particulier de l’aménagement des lieux et de l’hygiène, préservant leur santé et leur sécurité. Ils ne peuvent être situés dans des locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.
Consultation du CSE
A notre sens, une pareille mesure impliquant une modification des conditions de travail doit donner lieu à consultation préalable du CSE
Dérogation applicable jusqu’au 1er décembre 2021
Cette dérogation doit prendre fin à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire. L’état d’urgence sanitaire étant prorogé pour l’heure au 1er juin 2021, le dispositif est donc applicable jusqu’au 1er décembre 2021 sauf modification ultérieure.
Maxence DEFRANCE, Juriste IDF
Depuis le 10 janvier 2021 et jusqu’au 31 mars 2021, les personnes présentant des symptômes de la Covid-19, peuvent solliciter un arrêt de travail immédiat sur le site declare.ameli.fr.
La durée de cet arrêt de travail dérogatoire est de 4 jours maximum.
A l’occasion de cet arrêt, la personne bénéficiera des indemnités journalières de la sécurité sociale et du complément employeur sans conditions d’ouverture de droits, et ce, dès le 1er jour d’arrêt.
Bon à savoir : Si vous passez par votre médecin traitant et non la procédure de déclaration en ligne pour obtenir cet arrêt de travail, ce dernier sera indemnisé au titre du droit commun, avec application du délai de carence de 3 jours.
Au moment de sa déclaration en ligne, la personne devra confirmer ne pas pouvoir télétravailler et s’engager à réaliser un test (RT-PCR ou test antigénique) dans les 2 jours suivant sa déclaration.
L’arrêt de travail ne sera définitivement validé qu’une fois la date de résultat du test de dépistage enregistrée sur declare.ameli.fr, mais le salarié pourra dès cette première étape télécharger un récépissé de sa demande d’isolement et l’adresser à son employeur pour justifier de son absence.
Une fois le résultat du test obtenu, la personne devra se reconnecter sur le site d’Améli avec le n° de dossier obtenu lors de sa déclaration, afin d’indiquer la date de réception du résultat du test et le lieu de dépistage.
Que le test soit positif ou négatif, la période allant de la première déclaration à la date de résultat du test sera indemnisée. Cette durée ne peut dans tous les cas excéder 4 jours.
▪ Si le résultat du test est négatif : l’Assurance Maladie met fin à l’arrêt de travail et l’indemnisation prend fin à partir du soir de la date déclarée comme étant celle de l’obtention du résultat du test sur le téléservice. La personne devra ainsi, reprendre son travail dès le lendemain.
▪ Si le résultat est positif : la personne sera contactée par l’Assurance maladie et se verra prescrire une prorogation d’arrêt de travail afin de garantir un isolement de 10 jours depuis les 1ers symptômes. La prolongation de l’arrêt de travail devra être adressée à l’employeur.
Qu’en est-il des personnes identifiées comme « cas contact » ? Ces dernières peuvent continuer à bénéficier du téléservice déjà en place pour cette situation sur le site d’Ameli.
Anne-Lise Massard

Le protocole national sanitaire en entreprise ne cesse de connaître de nouvelles actualisations. Les dernières en date sont celles du 29 janvier puis une nouvelle modification est intervenue le 16 février concernant les cas contacts en entreprise.
Les principales évolutions sont les suivantes :
Enfin, à la suite de la dernière mise à jour, il est indiqué que les contacts évalués « à risque » selon la définition de Santé publique France seront pris en charge et placés en quarantaine. A noter qu’il est prévu qu’à partir du 22 février 2021, la durée d’isolement des personnes positives au Covid-19 passe de 7 à 10 jours pour l’ensemble des formes du virus. La durée d’isolement pour les cas contacts reste fixée à 7 jours.
Il faut rappeler que ce protocole sanitaire n’a qu’une simple valeur indicative (Conseil d’Etat, 17 décembre 2020, décision n°446797).
Audrey Lioté, Juriste AURA
Le principe est le suivant : Les délégués syndicaux (art. L. 2143-20 c. trav.), de même que les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité (art. L.2315-14 c. trav.) peuvent circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.
Cette liberté n’est toutefois pas sans limite puisque dans une décision en date du 10 février 2021, La Cour de cassation rappelle que « La liberté de circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux au sein de l’entreprise est un principe d’ordre public, qui ne peut donner lieu à restrictions qu’au regard d’impératifs de santé, d’hygiène ou de sécurité ou en cas d’abus (…) » (Cass. soc. 10 février 2021, n° 19-14.021). La Cour de cassation rappelle par ailleurs que cette liberté s’exerce de la même façon dans le cadre d’un mouvement de grève.
Dans cette affaire, était en question l’exercice de la liberté de circulation au cours d’une mobilisation qui avait touché un établissement hôtelier. L’employeur avait pris des mesures restrictives à la liberté de circulation des représentants du personnel grévistes dans l’hôtel. Dans un premier temps il avait interdit l’accès à l’hôtel, puis, après quelques jours, avait posé des conditions à cet accès et limité la liberté de circuler dans l’hôtel (entrée sans sifflet, ni mégaphone, ni chasuble ; contact à distance par un membre de la direction ou de la sécurité, interdiction d’entrée dans les chambres d’hôtel sans autorisation).
La Cour de cassation approuve la décision de la cour d’appel d’avoir jugé que ces mesures portant atteinte à la liberté de circulation étaient proportionnées. Pour justifier cette décision, les juges d’appel ont relevé certains agissements considérés comme abusifs : les représentants du personnel avait fait usage de mégaphone, étaient montés dans les étages de l’hôtel pour interpeller et intimider les salariés non-grévistes, avaient fait une distribution de tracts aux clients, poussé des cris et fait usage de sifflets ; et étaient entrés de force dans une chambre de l’hôtel.
Frederic PAPOT, Juriste IDF

Pour la gestion des activités sociales et culturelles le CSE bénéficie de tolérance. S’agissant des cadeaux et bons d’achat, le CSE doit respecter un plafond déterminé en fonction du plafond de la sécurité sociale.
Il résulte de l’arrêté du 22 décembre 2020 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2021 (publié au JO du 29 décembre 2020) que le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est en 2021 de : 3 428 euros.
Il en découle que le CSE bénéficie d’une tolérance pour les cadeaux et bons cadeaux distribués aux salariés et dont le montant par salarié ne dépasse pas 5% du PMSS soit 171 € par année ou par évènement.
Frédéric PAPOT - Juriste
Le code du travail énonce que le comité « est présidé par l’employeur ou son représentant » (art. L. 2316-13).
Jusqu’à présent, par « représentant » on comprenait « un salarié de l’entreprise ». Or, des décisions récentes ouvrent la possibilité de choisir de déléguer la présidence du comité à une ou plusieurs personnes extérieures à l’entreprise (c’est-à-dire sans contrat de travail avec l’entreprise).
Une première décision avait été relevée en ce sens s’agissant de la Présidence de la CSSCT. En effet, la Cour d’appel de Versailles a admis que la présidence de la CSSCT peut être assurée par un salarié du groupe (CA Versailles, 14ème ch., 12 mars 2020 n° 19/02628).
Une décision de la Cour de la Cassation en date du 25 novembre 2020 est dans le même sens et va plus loin.
Il était question de la présidence du comité d’entreprise. Sous le visa de l’ancien article L. 2325-1, alinéa 2, du code du travail (applicable à l’époque des faits) ; les Hauts magistrats énoncent que : « L’employeur peut déléguer cette attribution [la présidence des réunions du comité] qui lui incombe légalement, à la condition que la personne assurant la présidence par délégation de l’employeur ait la qualité et le pouvoir nécessaires à l’information et à la consultation de l’institution représentative du personnel, de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives de celle-ci, peu importe que le délégataire soit mis à disposition de l’employeur par une autre entreprise. »
En l’espèce c’est à deux personnes extérieures à l’entreprise que la délégation de pouvoir avait été donnée. Ces deux personnes appartenant en outre à deux sociétés distinctes ; lesquelles sont des sociétés de prestation de service dans les domaines de la gestion d’entreprise et des ressources humaines ; et ces deux personnes ont été mises à la disposition de l’employeur qui est quant à lui une association dans le domaines médicale.
Cette décision est transposable au CSE dont l’article L. 2316-13 énonce explicitement que l’employeur peut désigner un représentant.
Mais, s’il est exact que le code du travail a toujours prévu la possibilité de désigner un représentant de l’employeur pour présider des réunions du comité ; il est également vrai que cette possibilité a toujours soulevé des difficultés pour le respect de l’objet du comité qui est de faire en sorte que l’employeur (pas son représentant) tienne compte en permanence de l’intérêt des travailleurs exprimé par leurs représentants.
Autoriser que la présidence soit confiée à des personnes extérieures à l’entreprise, et même du groupe, ne va pas dans le sens d’un vrai dialogue social, direct entre l’employeur et les représentants des salariés.
Pour mémoire, l’ancien article L. 2325-1 ne comportait pas la mention de la possibilité pour l’employeur de se faire représenter. Toutefois, ce texte était la reprise lors de la recodification de 2008 de l’article L. 434-2 selon lequel « Le comité d’entreprise est présidé par le chef d’entreprise ou son représentant », et la recodification ayant été opérée à droit constant, il y avait lieu de considérer que la possibilité de se faire représenter n’avait pas été supprimée.
Les élus devront à notre sens être très exigeants quant à la capacité réelle de la personne extérieure de présider les réunions, d’apporter des informations fiables et de prendre dans l’immédiateté de la réunion des décisions qui engagent l’employeur sans avoir besoin de son aval et sans que l’employeur ne revienne sur les dires de son représentant.
En outre, en début de mandature voire en début de réunion si la personne qui préside change, les CSE est légitime à demander à ce que lui soit fourni la délégation de pouvoir afférente à la présidence de l’instance. Ce qui doit pouvoir permettre de vérifier la durée, la portée/étendue, les moyens (…) de la délégation de pouvoir et donc sa validité.
Le secrétaire aura tout intérêt à relever dans le procès-verbal avec exactitude la réalité des débats.
Pour finir, on relèvera que la délégation de pouvoir donnée à une tierce personne de présider les réunions n’est pas de nature à exonérer l’employeur – et son représentant légal – de sa propre responsabilité notamment au regard du délit d’entrave.
Frédéric PAPOT
Lors de la première période d’état d’urgence sanitaire, une ordonnance avait libéralisé le recours à la visioconférence, à la conférence téléphonique et à la messagerie instantanée pour la tenue des réunions des instances représentatives du personnel.
Une nouvelle ordonnance du 25 novembre n° 2020-1441 publiée le 26 novembre au Journal Officiel, autorise de nouveau l’employeur, jusqu’à l’expiration de la période de l’état d’urgence sanitaire, à imposer pour l’ensemble des réunions du comité social et économique et du comité social et économique central et des autres instances représentatives du personnel, le recours à la visioconférence, à la conférence téléphonique, et à la messagerie instantanée en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit.
L’employeur doit informer les membres de l’instance avant la réunion sauf pour le recours à la messagerie instantanée prévu par un accord d’entreprise (à moins que l’accord lui-même impose cette formalité).
S’agissant du recours à la conférence téléphonique et à la messagerie instantanée, un décret (non publié à ce jour) fixera les conditions dans lesquelles les réunions se tiennent.
Le recours à la visioconférence peut intervenir sans attendre un décret.
Dans 4 domaines, les membres élus des instances représentatives du personnel peuvent, à la majorité de ceux appelés à y siéger, s’opposer, au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la réunion, au recours à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée ou au recours à la visioconférence lorsque le nombre de 3 réunions par visioconférences prévu par le code du travail est dépassé.
Les 4 domaines dont il s’agit sont les informations et consultations menées dans le cadre de :
• La procédure de licenciement collectif prévue au chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail ;
• La mise en oeuvre des accords de performance collective mentionnés à l’article L. 2254-2 du même code ;
• La mise en oeuvre des accords portant rupture conventionnelle collective mentionnés à l’article L. 1237-19 du même code ;
• La mise en oeuvre du dispositif spécifique d’activité partielle prévu à l’article 53 de la loi du 17 juin 2020.
Frédéric PAPOT
Il ressort clairement du code du travail que le temps de trajet professionnel n’est pas un temps de travail : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. » (article L. 3121-4 c. trav.).
Mais, cette affirmation qui parait absolue admet-elle des exceptions ?
Il résulte des décisions de la Cour de cassation que lorsque pendant un temps de trajet les conditions de la définition du temps de travail sont remplies, alors le temps de trajet doit être qualifié de temps de travail.
Ainsi le temps de trajet est un temps de travail lorsque le salarié « est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (article L. 3121-1 c. trav.).
Peu importe donc que le salarié effectue un déplacement entre le domicile et le lieu de travail ; dès lors qu’il est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, il doit être considéré en temps de travail.
Ces principes, simples à énoncer, sont d’application délicate et force est de constater que l’appréciation du salarié et de l’employeur divergent souvent.
Une décision de la Cour de cassation (non publiée) en date du 3 juin 2020 (n° 18-16.920) est l’occasion de faire un point.
Dans cette affaire, une Cour d’appel avait refusé de qualifier de temps de travail le temps consacré par un salarié au trajet pour se rendre de son domicile au lieu d’établissement de clients. Selon la Cour d’appel, la seule contrainte consistant en ce que le salarié transporte des colis lors du trajet entre son domicile et ses locaux de travail, ne pouvait permettre de déduire qu’il était à la disposition de l’employeur et qu’il ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles. En conséquence, la période prévue pour ce trajet n’était pas – selon la Cour d’appel - un temps de travail effectif.
Cette décision est cassée par la Cour de cassation au visa de l’article L. 3121-1 du code du travail : « En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le salarié devait utiliser, pour faire le trajet entre les locaux du client de son employeur et son domicile, un véhicule de l’entreprise, contenant parfois des colis appartenant à ce client, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ».
Il en ressort que lorsque le salarié doit utiliser un véhicule de l’entreprise et transporte des colis pour un client ; il doit être considéré comme étant en temps de travail.
En revanche, la Cour de cassation a jugé en 2019 que la circonstance que le salarié soit astreint de se déplacer vers son lieu de travail, à l’intérieur de l’enceinte sécurisée d’une infrastructure aéroportuaire, au moyen d’une navette, ne permet pas de considérer que ce temps de déplacement constitue un temps de travail effectif (Cass. soc. 09 mai 2019, n° 17-20.740). Dans de telles circonstances les hauts magistrats ont donc estimé que le salarié n’était pas à la disposition de l’employeur, n’avait pas à se conforme à ses directives et pouvait vaquer librement à des occupations personnelles.
Frédéric PAPOT
Le code du travail – et la directive européenne 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 – organise un mécanisme de protection de l’emploi des salariés en cas de transfert total ou partiel d’activité. Les contrats de travail des salariés affectés à l’exploitation de l’activité transférée sont transférés, entraînant alors un changement d’employeur.
Cette règle est d’une particulière importance tant au regard de sa fréquence de mise en œuvre, que de son caractère impératif, lorsque les conditions légales d’application sont présentes. Ni le salarié, ni les entités cédante et cessionnaire, ne peuvent écarter son application (il existe toutefois des exceptions, telle la reprise d’activité dans le cadre d’un PSE : l’article L.1224-1 du code du travail ne s’applique alors que dans la limite du nombre des emplois qui n’ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d’effet de ce transfert).
Bien qu’ancienne, l’application de l’article L. 1224-1 dont il s’agit (ancien L. 122-12) génère toujours du contentieux et la Cour de cassation apporte ses éclairages au gré des questions posées.
Une décision du 30 septembre 2020 (n° 19-24.881 PBRI) est l’occasion de revenir sur la situation des salariés dont les fonctions ne sont exercées que partiellement dans le cadre de l’activité cédée. Ce sera le cas, par exemple, d’une fonction administrative, support ou commerciale qui s’exerce tant sur l’activité cédée que sur une ou plusieurs autres activités qui ne sont pas cédées.
Le contrat de travail doit- il dès lors être transféré chez le repreneur de l’activité ? Ce transfert peut-il n’être que partiel, entraînant la transformation d’un contrat de travail unique en deux contrats à temps partiels auprès de deux employeurs distincts ?
On voit qu’il s’agit là d’enjeux majeurs se rapportant à une situation qui est loin d’être anecdotique.
Mais, le salarié ne devrait-il pas pouvoir s’opposer au transfert partiel de son contrat et plus particulièrement sa transformation en deux contrats à temps partiel (puisque par hypothèse le changement d’employeur est imposé par l’article L. 1224-1) ?
Sur la question de la modification du contrat induite par le transfert, la Cour de cassation a aussi apporté des réponses. Dans un arrêt du 1er juin 2016 (n° 14-21.143) il est jugé que le salarié peut s’opposer aux modifications du contrat – autres que le changement d’employeur – entraînées par le transfert et qu’il appartient alors au nouvel employeur soit de poursuivre le contrat en l’état, soit d’engager une procédure de licenciement (on constatera néanmoins que la capacité réelle de refuser du salarié est limitée car un refus l’expose à la perte de son emploi).
La décision du 30 septembre 2020 apporte un tempérament à la rigueur de ces règles : « lorsque le salarié est affecté tant dans le secteur repris, (…) que dans un secteur d’activité non repris, le contrat de travail de ce salarié est transféré pour la partie de l’activité qu’il consacre au secteur cédé, sauf si la scission du contrat de travail, au prorata des fonctions exercées par le salarié, est impossible, entraîne une détérioration des conditions de travail de ce dernier ou porte atteinte au maintien de ses droits garantis par la directive. »
Trois situations sont donc de nature à s’opposer au transfert partiel du contrat :
Dans cette affaire, une salariée, dont le contrat avait été transféré à hauteur de 50 %, avait pris acte de la rupture du contrat la liant à son employeur originaire et avait saisi le Conseil de prud’homme.
Ayant été condamné en première instance et en appel, l’employeur originaire s’est pourvu en cassation en soulevant le moyen suivant :
« il résulte de l’arrêt que la cession par l’employeur à la société DPR méditerranée du droit de présentation de la clientèle portant sur l’ensemble des dossiers du cabinet de Menton, sur les biens mobiliers corporels relatifs à l’exercice de l’activité d’avocat et sur le salarié à hauteur de 50 % de son temps de travail, avait entraîné le transfert d’une entité économique autonome ayant conservé son identité ; qu’en jugeant cependant que le contrat de travail de la salariée, affectée pour 50 % de son temps de travail à l’entité transférée et pour 50 % à l’activité conservée, devait se poursuivre avec la cédante au prétexte que la salariée n’exerçait pas l’essentiel de ses fonctions au sein de l’entité transférée, la cour d’appel a violé le texte susvisé, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001. »
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel : « Pour juger que la prise d’acte par la salariée était justifiée par un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, l’arrêt, après avoir jugé caractérisé le transfert d’une entité économique autonome, retient que, si la partie de l’activité de la société X...- Y...- Z...-W... cédée à la société D… représentait 50 % de l’activité de la salariée, le contrat de travail devait se poursuivre auprès de la société X...- Y...- Z... - W... dès lors que la salariée n’exerçait pas l’essentiel de ses fonctions au sein de l’entité transférée. »
Ainsi, lorsqu’un salarié a une durée du travail répartie à part égale entre une activité cédée et une activité conservée, le contrat doit être partiellement transféré ; sauf à justifier de l’une des causes qui permettra au salarié de refuser la modification du contrat induite par le transfert partiel.
Frédéric PAPOT
A partir du 5 novembre, comparativement aux hommes, les femmes travailleront gratuitement en France. Comment un tel écart salarial est-il possible en 2020 ? Analysons cette iniquité en nous basant sur 3 données présentées par l’Observatoire des inégalités.
Tous temps de travail confondus (temps partiels et temps complets réunis), les femmes touchent 25,7 % de moins que les hommes. Cet écart est révoltant mais reflète une triste réalité : les femmes sont quatre fois plus souvent à temps partiel que les hommes.
Les salaires en « équivalent temps plein » permettent de prendre en compte tous les emplois (temps partiels et temps complets) en imaginant ce que pourraient être les rémunérations à temps partiel si les emplois correspondants étaient à temps plein. Pour cela, l’Observatoire des inégalités transforme un salaire à temps partiel en déterminant à quel niveau il aurait été si l’emploi avait été à temps plein. Le salaire mensuel net moyen des hommes, en équivalent temps plein, est de 2 438 euros. Celui des femmes est de 1 986 euros, soit un écart de 452 euros. Les femmes perçoivent donc un salaire inférieur de 18,5 %.
Si l’on prend en compte les différences de tranches d’âge, de type de contrat, de temps de travail, de secteur d’activité et de taille d’entreprise, il reste un écart moyen de salaire entre les femmes et les hommes de 10,5 %. Il s’agit là purement et simplement d’une discrimination sexiste. Une femme est payée 10,5% de moins car elle est une femme.
Selon une étude de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, si les femmes étaient payées comme les hommes, la hausse des cotisations qui en découlerait permettrait de récupérer 5,5 milliards d’euros. Payer davantage les femmes pour partir à la retraite plus tôt, voilà un horizon enthousiasmant !
Malek SMIDA
Rendues publiques le 17 septembre, plusieurs mesures prévues dans le schéma national de maintien de l’ordre (SNMO) ont suscité de vives réactions du côté des journalistes et de certaines associations. Pour couvrir une manifestation, un journaliste devra désormais être accrédité et posséder une carte de presse. La possibilité pour les journalistes de porter du matériel de protection ne sera autorisée que lorsque « leur identification est confirmée ».
Dans une lettre publiée le 22 septembre, une quarantaine de sociétés de journalistes, rédacteurs et personnels de médias affichent leur inquiétude : « Dans un contexte déjà très dégradé pour les journalistes lors de leur couverture des manifestations, ce texte porte atteinte à la liberté d’informer », écrivent les salariés de différents organes de presse. Ils demandent au ministère de l’intérieur de « corriger » ce nouveau cadre du maintien de l’ordre pour « le mettre en conformité avec les principes français et européens de la liberté d’informer ».
Le Syndicat national des journalistes et la Ligue des droits de l’homme ont annoncé avoir déposé un référé devant le Conseil d’Etat dans le but d’annuler ces dispositions contestées. Pour mémoire, la France se situe à la 34e place du classement mondial de la liberté de la presse.
Fondée cet été par des jeunes passionnés de représentation salariée, Représente.org est une SCOP cherchant à inclure les CSE dans la révolution écologique que nos sociétés doivent enclencher.
80% des élu(e)s CSE estiment que le comité a un rôle à jouer dans cette transition. Pourtant, plus de la moitié des CSE n’ont encore rien mis en place. Quant aux précurseurs, ils n’ont souvent lancé que quelques offres. Sur le volet économique, les CSE peuvent peser sur les décisions des directions, comme par exemple sur la gestion écologique des locaux ou le fléchage de l’épargne salariale. Aussi, de plus en plus de CSE choisissent de mettre en place une commission environnementale.
Dans le livre blanc publié par Représente.org, plusieurs idées sont proposées aux CSE :
- Aide à l’investissement éco-responsable des salariés (solutions d’épargne verte, investissements dans des forêts gérées durablement…) ;
- Sensibilisation et information aux enjeux écologiques (ateliers zéro-déchets, formations…) ;
- Soutien au pouvoir d’achat éco-responsable des salariés (chèques cadeaux pour des produits durables ou des boutiques éco-responsables) ;
- Solution d’économie circulaire et collaborative dans l’entreprise (services de location de vêtements pour enfants, partage de matériel de bricolage ou de loisirs) ;
- Subventions de dépenses visant à réduire l’impact personnel (diagnostics thermiques du logement, soutien administratif pour changer de chaudière) ;
- Transformation des activités CSE existantes vers des activités éco-responsables (soirée de Noël bio et zéro-déchet, options de voyage sans transport aérien…).
Alors que les experts du GIEC affirment qu’il ne nous reste qu’une dizaine d’années pour contenir le réchauffement climatique dans des limites supportables pour l’humanité, la mobilisation des élus CSE peut contribuer à la bifurcation écologique et sociale que notre pays doit immédiatement emprunter.
Malek SMIDA
Ce samedi a marqué le retour des Gilets jaunes dans les rues parisiennes. Après la double-censure du Conseil d’Etat ayant jugé les interdictions de rassemblement contraires à la liberté de manifester, l’exécutif a autorisé deux défilés au nord de la capitale. Toutefois, la préfecture a interdit les manifestations dans l’ouest de Paris, notamment dans les secteurs avoisinants les institutions de la République.
La première personne verbalisée est une femme qui possédait un simple tract dans la poche de son pantalon, à proximité des Champs-Elysées.
La seconde est une jeune femme qui marchait avec deux amis en direction de la station de métro de l’Assemblée Nationale et qui avait collé sous sa veste un autocollant de la France Insoumise. Cette militante assure qu’elle n’avait pour objectif que de rejoindre en transport en commun l’une des manifestations déclarées.
Les policiers pouvaient-ils les verbaliser ?
« La simple possession d’un tract ne prouve pas la participation à une manifestation interdite et donc l’infraction. Ça prouve juste que vous avez un tract ou qu’on vous l’a remis », estime Olivier Cahn, chercheur au CNRS.
Selon le professeur de droit public Serge Slama, ce type de verbalisation est « contestable au regard de la base légale. Ces personnes ne participent pas à une manifestation, elles sont aux abords d’une manifestation. Tant que vous n’avez pas participé à la manifestation, la verbalisation n’est pas possible ». L’universitaire affirme que dans une démocratie rien n’interdit de porter un autocollant de nature politique tant qu’il n’y a pas de trouble manifeste à l’ordre public.
Une contestation de ces procès-verbaux et contraventions devant le tribunal de police pourrait encourir une annulation.
Pour mémoire, l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 dispose que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi ».
Diego PARVEX & Malek SMIDA
Depuis le 1er juin et jusqu’au 30 septembre par dérogation à l’article D. 5122-13 du code du travail, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est fixé à 60 % de la rémunération horaire brute (telle que calculée à l’article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance).
Toutefois, dans ces mêmes secteurs d’activité, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est de 70 % pour :
Les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l’annexe 1 du Décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 ;
Les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l’annexe 2 du même décret lorsqu’ils ont subi une diminution de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. Cette diminution est appréciée :
- soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au cours de la même période de l’année précédente ;
- soit, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois.
Pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, la perte de chiffre d’affaires est appréciée par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ;
Le Décret n° 2020-1123 du 10 septembre 2020 publié au JO du 11 septembre, modifie la liste des activités pour lesquelles le taux de 70 % s’applique.
Frédéric PAPOT
Là où une plus grande implication et solidarité du gouvernement était à notre sens souhaitable, il est demandé à la solidarité nationale de prendre le relais.
Ainsi tout salarié pourra renoncer à :
Un accord collectif pourra prévoir un abondement. C’est l’agence nationale pour les chèques vacances (ANCV) qui gère les sommes recueillies et en assurera la répartition sous formes de chèques vacances entre les établissements et services sanitaires, médico-sociaux et l’aide ou d’accompagnement à domicile. Un décret est attendu sur le sujet.
Maxence DEFRANCE
Initialement baptisé « activité réduite pour le maintien en emploi », ce dispositif créé par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 aujourd’hui baptisé activité partielle de longue durée (APLD) a été précisé par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.
Ce dispositif est mis en place par accord collectif d’établissement, d’entreprise du groupe ou de la branche ou dans le cadre d’un engagement unilatéral si l’accord de branche le prévoit. Il doit faire l’objet d’une validation par la Direccte. Sa durée de vie est limitée. En effet, le dispositif s’appliquera aux accords collectifs et aux documents élaborés par l’employeur transmis à l’administration pour extension, validation ou homologation, au plus tard le 30 juin 2022.
Le salarié placé en APLD reçoit de son employeur une indemnité horaire correspondant au moins à environ 70% de sa rémunération brute servant d’assiette pour le calcul de l’indemnité de congés payés, L’employeur reçoit quant à lui 60% (56% pour les accords transmis à l’autorité administrative à compter du 1er octobre).
L’APLD s’inscrit aujourd’hui aux côtés des autres dispositifs de restructuration de l’entreprise déjà existants tels que le Plan de Départ Volontaire (PDV), la Rupture Conventionnelle Collective (RCC) ou encore l’APC (accord de performance collective).
Nous faisons le point sur tous ces dispositifs existants dans notre numéro de septembre à retrouver également sur notre site : https://www.atlantes.fr/DANS-L-ACTU-1792
Pour vous abonner à la plume : https://www.atlantes.fr/-Newsletter-
Maxence DEFRANCE
« Cherche analyste en renseignement pour surveiller organisations syndicales ». Voilà le type d’offres d’emploi disponibles sur le site d’Amazon, jusqu’à ce qu’elles soient retirées début septembre devant le tollé provoqué aux Etats-Unis.
« La fiche ne décrivait pas correctement le poste. Elle a été faite par erreur et a depuis été corrigée » a répondu Leah Seay, porte-parole de la multinationale, sans prendre la peine de préciser la nature de cette « erreur ».
Selon Dania Rajendra, directrice d’un collectif d’organisations anti-Amazon, les travailleurs de l’entreprise qui ont osé s’exprimer ces derniers mois contre Amazon sont tous désormais ciblés. Elle affirme que « cette description de poste est la preuve qu’Amazon a l’intention de continuer ».
Après les déboires judiciaires qu’a connus Amazon au printemps, cette nouvelle affaire ne va pas améliorer l’image bien entachée du géant du commerce en ligne.
Malek SMIDA
Mis en place par la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 et complété par le décret du 10 mai dernier, le forfait « mobilités durables » encourage les modes alternatifs de déplacements plus sains et notamment le covoiturage.
Deux décrets du 5 juin 2020 viennent compléter le dispositif. Ainsi, les frais de covoiture sont les frais suivants :
Le décret précise que le partage des frais est effectué entre le conducteur et les passagers, dans des proportions qu’ils fixent. Il est précisé que l’allocation qui sera versée au conducteur ne peut excéder les frais de déplacement engagés par celui-ci, déduction faite des sommes éventuellement versées par les passagers à ce même conducteur. A noter que ces dispositions sont applicables au conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage et l’a réalisé en l’absence de passager.
D. n° 2020-678, 5 juin 2020 : JO, 6 juin
D. n° 2020-679, 5 juin 2020 : JO, 6 juin
Maxence DEFRANCE
Pour ces populations de travailleurs particulièrement exposés et mobilisés durant la crise sanitaire, la loi n°2020-935 du 30 juillet dernier de finances rectificatives pour 2020 permet l’extension des exonérations de cette prime exceptionnelle. Pour les salariés des établissements privés de santé et les établissements médico-sociaux la prime est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales et l’impôt sur le revenu sous conditions.
Afin de permettre le bénéfice de l’exonération, la prime devra respecter :
Il est à rappeler que la prime Macron ne peut se substituer à aucun élément de rémunération, aux augmentations ou aux autres éléments de rémunération conventionnelle, contractuelle ou résultant d’un usage.
Maxence DEFRANCE
Uber et son concurrent Lyft ont refusé de respecter cette loi et ont continué à faire travailler des chauffeurs auto-entrepreneurs. La justice californienne a tranché.
Le 12 août 2020, elle a condamné Uber et Lyft à requalifier sous 10 jours le statut de leurs chauffeurs. Uber a décidé de faire appel de cette décision pour y échapper, au moins temporairement, et fait aujourd’hui du chantage : l’entreprise menace d’interrompre son activité en Californie jusqu’en novembre si elle est contrainte de respecter la loi. Pourquoi novembre ? Uber pense-t-elle que l’élection présidentielle pourrait rebattre les cartes ?
En effet, lors du scrutin, les électeurs de chaque Etat américain sont invités à voter pour leurs représentants locaux mais peuvent également donner leur avis sur de nombreuses propositions de loi. Les Californiens devront se prononcer sur la proposition 22, largement soutenue par Uber et Lyft, qui, si elle est votée, qualifiera automatiquement les chauffeurs VTC en travailleurs indépendants.
Et en France, à quand une loi requalifiant les chauffeurs VTC en salariés ?
En mai 2020, une proposition de loi relative au statut des travailleurs des plateformes numériques visait à créer une nouvelle forme de contrat de travail applicable aux travailleurs des plateformes numériques pour lesquelles la mise en relation n’est pas l’objet de l’activité mais la modalité d’accès et de réalisation du service. Cette proposition de loi a été rejetée. Nous consacrerons un dossier sur l’Uberisation dans notre prochaine Plume.
Malek SMIDA
Passé inaperçu, un décret du 20 mai 2020 pourrait bien avoir ouvert la boite de Pandore. Ce décret autorise le prioritaire d’une entreprise en faillite à racheter lui-même son entreprise en dépôt de bilan. Auparavant, cette opération était rare et très encadrée (elle devait être approuvée par le procureur, et donc par le Ministère de la Justice). Le gouvernement souhaite dorénavant encourager cette pratique afin, selon lui, de limiter la casse sociale et de sauver des entreprises en difficulté. Mais les effets pervers de ce système de dépôt de bilan-rachat n’ont pas tardé à apparaître…
Au lendemain du déconfinement, l’enseigne de meubles Alinea, 26 magasins et 2000 salariés, dépose le bilan. La famille Mulliez, propriétaire d’Alinea, pointe du doigt la crise sanitaire pour justifier la faillite de son entreprise.
Le 6 août dernier, l’entreprise enregistre sa seule et unique offre de reprise. Qui est donc ce repreneur potentiel ? La famille Mulliez, qui souhaite racheter son entreprise mais de manière partielle : leur offre ne prévoit la reprise que de neuf magasins, la fermeture de dix-sept autres et le licenciement de 1000 salariés. Le coût du plan de licenciements de ces salariés est estimé à 22 millions d’euros. Cette somme pourrait être payée par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, qui intervient dès qu’une entreprise, en cessation de paiement, ne peut honorer ses obligations à l’égard des salariés. En déposant le bilan, Alinea ferait donc payer ces départs par la collectivité.
D’autres groupes vont rapidement profiter de cette aubaine que leur offre l’exécutif. En effet, le fonds d’investissement propriétaire de Camaïeu est candidat au rachat de sa propre entreprise.
Malek SMIDA
La troisième loi de finances rectificative pour 2020 a été publiée le 31 juillet au Journal officiel. Initialement fixée au 31 août, la date limite de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA ou prime « Macron ») a été repoussée au 31 décembre 2020.
Annoncée en plein mouvement des Gilets jaunes, la PEPA a rencontré un rapide succès auprès des entreprises : au premier trimestre 2019, cinq millions de salariés en ont bénéficié et ont obtenu en moyenne 400 euros. Le versement de cette prime a donc été renouvelé pour faire face à la crise économique.
Le montant de la prime exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dépend désormais de l’existence ou non d’un accord d’intéressement. Le montant est de :
• 1 000 euros maximum pour les entreprises dépourvues d’accord d’intéressement ;
• 2 000 euros maximum s’agissant des entreprises qui ont mis en œuvre un accord d’intéressement à la date de versement de cette prime.
Bien que cette prime améliore le pouvoir d’achat des salariés, elle n’est pas exempte de toute critique. En effet, dans une étude publiée le 2 juillet 2020, l’INSEE affirme que les salaires ont moins progressé dans les établissements qui ont versé une prime Macron à leurs salariés. L’INSEE y voit un effet d’aubaine et considère que des entreprises ont utilisé cette prime défiscalisée pour ne pas augmenter les salaires : « des établissements auraient sans doute versé, sous une forme différente, au moins une partie du montant de cette prime en l’absence de cette mesure. »
Malek SMIDA
En 1998, après avoir traversé 56 pays, les militants de la Marche mondiale contre le travail des enfants achèvent leur aventure à Genève, à l’ouverture de la Conférence de l’Organisation internationale du travail (OIT) qui examinait pour la première fois le projet de nouvelles normes internationales sur les pires formes de travail des enfants. Un an plus tard, la Convention n°182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants est adoptée.
Cette convention interdit :
A l’heure où 152 millions d’enfants sont toujours soumis au travail, les Nations-Unis ont fait le choix de consacrer l’année 2021 à l’élimination du travail des enfants, sous toutes ses formes.
Malek SMIDA
Le 28 juillet dernier, France Stratégie a publié un rapport d’évaluation des ordonnances du 22 septembre 2017 relatives au dialogue social et aux relations de travail, dites ordonnances « Macron ».
Dans ses travaux, le comité d’évaluation a souhaité répondre à la question suivante : à quel rythme les élections ont-elles été déployées et combien d’entreprises disposent d’un CSE depuis le 31 décembre 2019 ?
Au 3 juin 2020, à partir du dénombrement des procès-verbaux des élections professionnelles, 81 000 établissements distincts ont effectivement mis en place un CSE. Parmi eux, la moitié sont des établissements de moins de 50 salariés. 40 000 établissements n’ont toujours pas de CSE en raison d’une carence totale de candidatures. Sans surprise, l’immense majorité des établissements sans CSE ont moins de 50 salariés (86%). 8,5 % des entreprises déclarent posséder un CSE depuis 2018.
Les entreprises de moins de 300 salariés n’ont pas l’obligation de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT). 11,8% de ces entreprises l’ont néanmoins fait.
Cependant, parmi les entreprises de 300 salariés ou plus, seules 59 % de celles dotées d’un CSE depuis 2018 ont remplacé leur ancien CHSCT par une CSSCT, alors qu’elles en ont l’obligation. Ce chiffre est inquiétant. En effet, les CSSCT ont une importance cruciale dans ce contexte de crise sanitaire.
Malek SMIDA
Afin de connaitre le risque, plusieurs indices doivent être analysés :
Anne-Sophie LARIVE
La Cour de cassation considère que l’employeur peut consulter les SMS que reçoit le salarié sur son téléphone portable professionnel, en dehors de sa présence, dès lors qu’ils ne sont pas identifiés comme étant personnels (Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-14.779)
La difficulté, non résolue à ce jour, est de savoir comment identifier des SMS comme étant « personnels », le dispositif ne permettant pas de préciser l’objet du message, il sera conseillé d’éviter les conversations privées dans ce cadre.
Anne-Sophie LARIVE
L’usage abusif d’internet par le salarié sur son temps de travail peut être sanctionné dès lors que l’employeur en apporte la preuve.
Par exemple, l’abus a été reconnu :
En revanche, ne constitue pas une faute le fait pour un salarié, connecté à internet en permanence du fait de ses fonctions, de consacrer environ 4 minutes par jour à l’envoi de tweets non professionnels durant ses heures de travail (CA Chambéry 25-2-2016 n° 15/01264 : RJS 5/16 n° 327).
Anne-Sophie LARIVE
La messagerie professionnelle instantanée s’est largement développée dans les entreprises et le raisonnement de la Cour de Cassation (à propos de messagerie professionnelle) est difficilement transposable. En effet, il est difficile d’indiquer la mention « personnel » pour les discussions qui ont lieu sur cette messagerie.
Seule la CEDH s’est prononcée à ce jour sur le sujet (voir encadré) dans le cadre d’une affaire l’employeur avait utilisé des propos échangés relatifs à l’entreprise sur la messagerie professionnelle instantanée « yahoo messenger » du salarié avec son frère et sa fiancée (CEDH 5-9-2017 n° 61496/08). Le règlement intérieur de l’entreprise interdisait l’usage des ressources de l’entreprise à des fins personnelles. Le salarié quant à lui se prévalait du secret des correspondances et d’une atteinte à sa vie privée.
A ce jour, les garanties posées par la CEDH n’ont pas trouvé résonnance dans les juridictions nationales. Une des principales questions que devra trancher les juges sera de savoir quels arguments avancés par l’employeur pourront justifier la surveillance des communications non identifiées comme personnelles par le salarié.
|
Le guide délivré par la CEDH (qui devrait probablement être suivi par les juridictions nationales) est le suivant :
- Le salarié a-t-il été préalablement informé de la possibilité d’une surveillance par l’employeur de ses communications et de la mise en place d’une telle surveillance ? - Quels sont l’étendue de la surveillance opérée par l’employeur et le degré d’intrusion dans la vie privée du salarié ? - L’employeur justifie-t-il de motifs légitimes autorisant la surveillance des communications du salarié et l’accès à leur contenu ? - Un système de surveillance moins intrusif peut-il être adopté ? |
Conseil Atlantes : Faute de garantie dans la jurisprudence à ce jour, nous vous recommandons de n’utiliser la messagerie professionnelle instantanée que dans le cadre strictement professionnel.
Anne-Sophie LARIVE
Il faut bien distinguer si les échanges ont eu lieu sur ma messagerie personnelle ou ma messagerie professionnelle.
Les échanges sur une messagerie personnelle, même installée sur mon ordinateur professionnel, sont couverts par le secret des correspondances (Cass. soc. 23-10-2019 n° 17-28.448).
Autrement dit, l’employeur ne peut donc ni les consulter ni s’en servir, le cas échéant, comme motif de licenciement à l’encontre du salarié.
En revanche, si les échanges ont eu lieu sur la messagerie professionnelle dans l’entreprise, la Cour s’était prononcée au sujet d’échanges n’ayant pas été identifiés comme personnels ou privés sur la messagerie professionnelle considérant qu’ils pouvaient être contrôlés librement en l’absence du salarié (Cass. soc. 16-5-2013 n° 12-11.866).
A titre indicatif, la jurisprudence a également considéré que l’employeur ayant pris connaissance d’un mail par inadvertance dans lequel le salarié insultait son employeur alors qu’il venait de faire l’objet de sanction. Oui : le message, envoyé par le salarié aux temps et lieu du travail, qui était en rapport avec son activité professionnelle, ne revêt pas un caractère privé et peut être retenu au soutien d’une procédure disciplinaire à l’encontre du salarié (Cass. soc. 2 février 2011 n° 09-72.313).
Anne-Sophie LARIVE
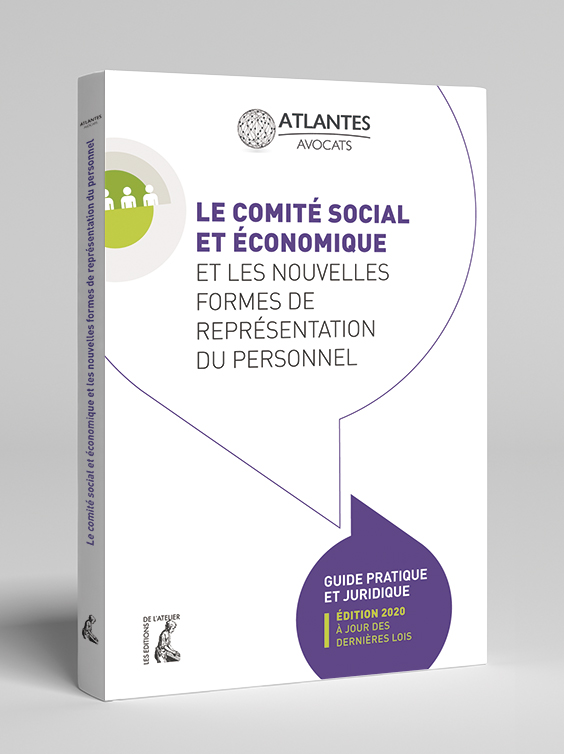
La nouvelle édition de notre guide comprend les dispositions issues des ordonnances de 2017 et intègre les évolutions normatives subséquentes, ainsi que les retours d’expériences et les premières jurisprudences concernant la mise en place des CSE et leur fonctionnement.
.jpg)
Nos équipes de formateurs (juristes, avocats, experts) accompagnent les représentants du personnel en leur fournissant les éléments clés pour exercer leur mandat dans le contexte social et sanitaire actuel.
Rôle du CSE dans la santé, la sécurité et les conditions de travail, audit et diagnostic de votre CSE, élaboration d’avis, réagir en situation de crise, les négociations, les restructurations, faire face aux licenciements économiques… C’est plus de 40 sujets, en inter ou en intra, que nous animons dans toute la France.
Nous vous proposons également des formations sur-mesure pour répondre au mieux à vos besoins !
Nouveauté : 5 formations disponibles à distance !
Annoncée en plein mouvement des Gilets jaunes, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), ou prime « Macron », a rencontré un franc succès auprès des entreprises : au premier trimestre 2019, cinq millions de salariés en ont bénéficié et ont obtenu en moyenne 400 euros. Dans une étude publiée le 2 juillet 2020, l’INSEE dresse le bilan de cette prime défiscalisée.
On apprend tout d’abord que la prime a davantage été accordée dans les grandes entreprises que dans les petites (17% des TPE l’ont distribuée contre 58% des entreprises de plus de 1000 salariés). Les salariés des services financiers et des assurances sont ceux ayant le plus profité de cette prime (35% l’ont touchée), tandis que les salariés de l’agroalimentaire en ont très peu bénéficié (10%).
Des disparités sont également visibles entre les secteurs d’activité. Les effets d’aubaine seraient encore plus importants dans la fabrication de biens d’équipement, le transport-entreposage, les activités scientifiques et techniques ou encore les services aux ménages.
Malek SMIDA
Depuis un mois, le Gouvernement et le Conseil d’Etat s’opposent sur la liberté de manifester. Dans le contexte sanitaire actuel, deux conceptions s’affrontent. Retour rapide sur les faits.
Le 31 mai 2020, un décret du Premier ministre limite sur la voie publique les rassemblements, réunions ou activités à 10 personnes.
Le 13 juin 2020, le Conseil d’Etat suspend l’exécution de la partie contestée du décret du 31 mai 2020 et rétablit le droit de manifester pour des rassemblements pouvant aller jusqu’à 5000 personnes.
Le 14 juin 2020, le Premier ministre modifie son décret en conséquence. Les manifestations de plus de 10 personnes sont admissibles mais elles sont soumises à une autorisation préfectorale préalable.
Le 6 juillet 2020, le Conseil d’Etat suspend l’obligation d’obtenir une autorisation avant d’organiser une manifestation. Le juge des référés du Conseil d’Etat rappelle qu’en temps normal, les manifestations sont soumises à une obligation de déclaration auprès des autorités. Le préfet peut alors interdire les rassemblements qui risquent de troubler l’ordre public, par exemple s’il estime que les précautions sanitaires prévues sont insuffisantes. La nouvelle version du décret conduit à inverser cette logique, puisque toute manifestation demeure interdite tant que le préfet ne l’a pas autorisée.
Malek SMIDA
Dans un arrêt du 2 juin 2020 (17/04929), la Cour d’appel de Grenoble s’est penchée sur la conventionnalité du barème Macron au regard des engagements internationaux de la France (Charte sociale européenne et Convention n°158 de l’OIT).
Tout d’abord, la Cour estime que le préjudice subi à la suite d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être apprécié de manière concrète, en tenant compte de ses conséquences morales et de son impact financier (baisse de revenus, période de chômage, allongement du temps de trajet pour se rendre à un nouveau lieu de travail, déménagement…). Mais malgré cela, dans l’affaire qui leur est soumise, les juges considèrent que les montants prévus par le barème permettent d’indemniser de manière adéquate le préjudice de la victime. Selon eux, affirmer que l’indemnité prévue par le barème serait nécessairement inadéquate pour les faibles anciennetés revient à apprécier le préjudice de manière abstraite, ce qu’ils refusent.
Aussi, la Cour ne prononce pas l’inconventionnalité du plafonnement français :
« Dès lors, il ne peut être soutenu que l’établissement d’un barème et le plafonnement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est contraire, par principe, au droit à une indemnité adéquate garantie par la Charte sociale européenne et la Convention n°158 sur le licenciement de l’OIT. Le caractère adéquat de la réparation allouée au salarié devant être apprécié de manière concrète en considération de son préjudice et pourra ainsi conduire, au cas par cas, à déroger au principe du plafonnement des indemnités de licenciement ».
Tous les regards sont maintenant braqués sur la Cour de cassation qui n’a toujours pas rendu d’arrêt sur le sujet. Si vous souhaitez aussi l’abrogation du barème, merci de signer notre pétition.
Malek SMIDA
Le temps de travail est défini en fonction de l’importance des contraintes que l’employeur impose au salarié, conduisant ce dernier à être privé de sa liberté d’action : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. » (art. L. 3121-1 c. trav. Al. 1). Cette définition relève des règles d’ordre public.
L’analyse du temps dans l’entreprise est ainsi binaire : le temps est soit du temps de travail ; soit du temps de repos.
Lorsque le salarié est placé dans une situation qui répond à la définition de l’article L. 3121-1, il est en temps de travail. Au cas contraire, il est en temps de repos.
Régulièrement, l’application de la définition du temps de travail soulève des difficultés. Une décision récente de la Cour de cassation nous conduit à vous proposer un état des lieux s’agissant de la distinction entre le temps de travail et le temps de pause.
L’article L. 3121-2 du code du travail énonce à cet égard que : « Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis. »
En outre, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives (art. L. 3121-16 c. trav.)
Mais, dans quelles conditions cette interruption doit elle être organisée pour constituer un temps de pause ? A partir de quel niveau de contraintes le salarié peut-il considérer qu’il ne bénéfice pas d’un temps de pause, mais qu’au contraire il est en temps de travail ?
Il ressort des décisions de la Cour de cassation que :
Une décision du 3 juin 2020 (n° 18-18.836), illustre de nouveau la possibilité pour l’employeur de maintenir un niveau de contraintes sur le salarié pendant la pause.
Une salariée engagée comme agent d’exploitation de sûreté aéroportuaire réclame le paiement d’heures supplémentaires (et congés payés afférents) à raison de ce qu’elle considère être du temps de travail réalisé pendant ses pauses journalières. Elle est déboutée par le conseil de prud’hommes et par la Cour d’appel.
Dans son pourvoi la salariée met en avant, notamment, que l’obligation d’avoir une tenue vestimentaire impeccable pendant les pauses, et la possibilité d’un contrôle inopiné de ladite tenue par l’employeur, l’empêchait de pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Son pourvoi est rejeté par la Cour de cassation qui énonce que : dès lors que pendant ses temps de pause la salariée était libre de rester dans le local prévu à cet effet ou d’aller où bon lui semblait et que pesait sur elle la seule obligation de présenter un comportement irréprochable et de rester en tenue de travail pour évoluer au sein de l’aéroport, la cour d’appel a pu en déduire que la salariée ne se trouvait pas, pendant son temps de pause, à la disposition de l’employeur.
Le fait que le salarié reste soumis à certaines obligations dont l’employeur peut vérifier le respect, ne suffit pas à caractériser qu’il est en temps de travail effectif, dès lors qu’il peut vaquer librement à des occupations personnelles. On relèvera que la cour de cassation met en avant que « la seule obligation » mise à la charge de la salariée était comportementale.
Cette affaire peut être mise en lien avec un arrêt de mai 2019, qui portait sur le temps de déplacement dans une enceinte aéroportuaire. La Cour de cassation avait en effet jugé que la circonstance que le salarié soit astreint de se déplacer vers son lieu de travail, à l’intérieur de l’enceinte sécurisée de l’infrastructure aéroportuaire, au moyen d’une navette, ne permet pas de considérer que ce temps de déplacement constitue un temps de travail effectif (Cass. Soc. 9 mai 2019, 17-20.740).
Frédéric PAPOT
En 2008, l’insolvabilité de débiteurs nord-américains combinée à une baisse du prix de l’immobilier entraîne la faillite d’organismes de crédit et de fonds d’investissement qui spéculaient sur les « subprimes », ces emprunts immobiliers toxiques. La crise est mondiale. En quelques mois, 34 millions de salariés perdent leur emploi.
« Ne pas donner tous les bénéfices aux dirigeants et aux actionnaires, en destiner une part plus grande à ceux qui par leur travail créent la richesse, redonner du pouvoir d’achat aux travailleurs sans alourdir les charges fixes de l’entreprise et ainsi remettre le capitalisme à l’endroit, voilà à côté du RSA l’autre révolution qu’il nous faut entreprendre. »
Quatre ans après, le candidat François Hollande dans la même veine disait : « dans cette bataille qui s’engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n’a pas de nom, pas de visage, pas de parti, il ne présentera jamais sa candidature, il ne sera donc pas élu, et pourtant il gouverne. Cet adversaire, c’est le monde de la finance ».
Aujourd’hui, où en sommes-nous ? « L’autre révolution » promise a-t-elle été entreprise ? Oxfam nous livre ses réponses dans un rapport publié le 22 juin dernier.
Selon l’ONG, les versements aux actionnaires du CAC 40 ont augmenté de 70 % depuis la crise financière de 2008. Pendant cette période, la rémunération des PDG a bondi de 60 %, trois fois plus vite que le salaire moyen au sein de ces entreprises. Le SMIC n’a quant à lui augmenté que de 12 %.
L’étude dénonce la pression des actionnaires pour réaliser des profits à court-terme, empêchant ainsi les entreprises de prendre en compte un horizon plus long et d’investir à la hauteur des besoins dans la transition écologique. En 2018, si la part des bénéfices allant aux actionnaires avait été encadrée à 30 %, l’argent généré aurait permis de couvrir 98 % des besoins en investissement dans la transition écologique des entreprises du CAC 40.
Les années passent, les études relatives aux dérives du CAC 40 pleuvent, et pourtant rien ne change…. Le Président Emmanuel Macron ne vient-t-il pas dans ses réponses à la convention citoyenne sur le climat de refuser la mesure de taxe sur les dividendes à 4% ?
Diego PARVEX et Malek SMIDA

De mars à juin, nos juristes et nos avocats vous ont régulièrement informé en vidéo de l’évolution du droit du travail en cette crise sanitaire. Chaque semaine, nous avons répondu à toutes vos questions lors de nos « Lives » sur Twitter.
Le 7 mai et le 18 juin derniers, de nombreux salariés ont participé à nos Webinaires et ont pu échanger avec nos avocats et nos juristes.
Restructurations, accords de performance collective, ruptures conventionnelles collectives, licenciements économiques, plans de sauvegarde de l’emploi, redressements et liquidations judiciaires, conséquences sur l’organisation du travail, information-consultation des CSE, santé et sécurité au travail, expertises, rôle des délégués syndicaux… De nombreux sujets ont été abordés. Nous espérons que nos conseils vous seront utiles !
Publiée ce 8 juin, une étude d’OpinionWay se penche sur le lien salarié-employeur à l’épreuve de la crise sanitaire. Pendant le confinement, on apprend qu’un tiers des salariés était en chômage partiel, 37% en télétravail et 27% ont continué à se rendre sur leur lieu de travail.
Sur l’ensemble des salariés interrogés, les deux tiers affirment que le lien avec leur employeur est resté inchangé. 14% ont quant à eux vu ce lien se renforcer et au contraire, 19% considèrent qu’il s’est affaibli (ce chiffre grimpe à 26% pour les travailleurs en chômage partiel).
Parmi les salariés dont le lien avec l’employeur s’est affaibli, la moitié s’est sentie délaissée par ce dernier. 31% pointent du doigt des problèmes organisationnels et estiment qu’ils ont travaillé beaucoup plus sans compensation.
Ces résultats laisseraient-ils penser qu’une partie des salariés serait prête à accepter un accord de performance collective dans leur entreprise et une baisse de salaire pour sauver leur emploi ? Ces accords collectifs peuvent constituer un chantage à l’emploi. Si votre employeur évoque la possibilité d’un tel accord, contactez-nous. Atlantes vous accompagnera dans ces négociations capitales.
Malek SMIDA
Le 11 juin dernier, l’INSEE a publié ses chiffres sur l’emploi salarié en France au premier trimestre 2020. Sans grande surprise, les conséquences économiques de l’épidémie sont terribles : 500 000 destructions nettes d’emplois entre la fin de l’année dernière et la fin du mois de mars 2020. Toutes les régions sont touchées dans des proportions globalement similaires.
Et il ne s’agit que des résultats du premier trimestre 2020 !
Les chiffres du deuxième – celui du confinement – s’annoncent eux aussi dramatiques. Nous verrons alors si le dispositif d’activité partielle a permis de limiter la casse. Plusieurs entreprises ont d’ores et déjà annoncé qu’elles diminueraient rapidement leurs effectifs. C’est le cas de Renault qui compte supprimer 15 000 emplois, dont 4600 en France. Et cela, malgré un prêt de 5 milliards d’euros garanti par l’Etat…
Alors que le Président de la République a affirmé dimanche que la réponse à la crise était de « travailler et de produire davantage », on ne peut que se poser, une fois encore, la question fondamentale du temps de travail. Si les salariés qui ont « la chance » de garder leur emploi travaillent plus, comment pourrons-nous remettre au travail ceux qui l’ont perdu ?
Malek SMIDA
Au Journal Officiel du 9 juin a été publiée la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant.
En substance, le texte créé au bénéfice du salarié un congé de deuil de 8 jours, pouvant être fractionné, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.
Il devra être pris, sur présentation d’un justificatif, dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant. Le salarié devra informer l’employeur au moins 24 heures avant le début de chaque période d’absence.
La durée de ce congé est assimilée à une période de présence pour le calcul des droits à intéressement et à participation.
Pendant la durée du congé le salarié perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale, complétées par l’employeur de manière que le salarié ne subisse aucune perte de rémunération. L’employeur qui a maintenu le salaire est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié à l’indemnité journalière.
Ce congé vient s’ajouter au congé pour décès d’un enfant déjà prévu à l’article L. 3142-1, et dont la durée minimale (qui peut être augmentée par accord collectif) est portée à 7 jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans, et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.
Le salarié bénéficie d’une protection contre la perte d’emploi. En effet, l’employeur ne peut en principe pas rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les treize semaines suivant le décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou de la personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le salarié a la charge effective et permanente. Toutefois, la rupture du contrat est possible en cas de faute grave ou de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger au décès de l’enfant.
Par ailleurs, le don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade est étendu au parent d’un enfant décédé.
Ces mesures s’appliqueront pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.
La mise en œuvre de ces nouveaux droits nécessite la publication d’un décret (non paru à ce jour), lequel fixera notamment les conditions du fractionnement du congé.
Frédéric PAPOT
Saisi par la Ligue des droits de l’homme, la CGT, la FSU, Solidaires, le Syndicat des avocats de France et celui de la magistrature, le juge des référés du Conseil d’Etat s’est prononcé samedi 13 juin sur l’interdiction générale et absolue de manifester. Appliquée depuis le début de la crise sanitaire, cette interdiction a été renouvelée le 31 mai dernier par un décret du Premier ministre qui, dans son article 3, limite sur la voie publique les rassemblements, réunions ou activités à dix personnes.
Par voie de conséquence, le Conseil d’Etat suspend l’exécution de l’article 3 du décret du 31 mai 2020 et rétablit ainsi un droit de manifester indispensable à la bonne santé démocratique de notre pays.
Malek SMIDA

La crise sanitaire a pour conséquence une crise économique dont les conséquences ne peuvent être encore mesurées. Pôle Emploi a déjà enregistré plus d’un million de demandeurs d’emploi supplémentaires et le chômage n’a jamais atteint un niveau aussi élevé depuis 25 ans.
Face à ce qui est à tout le moins un fort ralentissement économique, un certain nombre d’employeurs envisagent ou envisageront des mesures de réorganisation/restructuration (augmentation du temps de travail, réduction de salaires, suppression de postes, fermetures d’établissements…). Nos avocats et nos juristes vous conseillent pour réussir au mieux les négociations conséquentes !
PSE, ruptures conventionnelles collectives, plans de départ volontaire, accords de performance collective, renégociation des accords de temps de travail (RTT, CP…), redressement et liquidation judiciaire… Nous sommes prêts à vous accompagner quelle que soit la situation de votre entreprise !
Le 4 juin dernier, le Ministère du travail a mis à jour sa foire aux questions relative à l’activité partielle en tenant compte des évolutions du 2 juin 2020. Concernant la garde d’enfants, deux nouvelles situations sont détaillées :
En somme, les parents en activité partielle n’ont plus vraiment le choix : leurs enfants doivent retourner à l’école si cela est possible.
Malek SMIDA
Le salarié a le droit de s’absenter de son poste de travail pour se rendre et participer aux :
Afin de bénéficier de l’autorisation d’absence pour se rendre et participer à ces séances et réunions, le salarié élu membre d’un conseil municipal doit informer son employeur par écrit, dès qu’il a connaissance :
L’employeur n’est pas tenu de rémunérer ce temps d’absence.
Le salarié maire, adjoint ou conseiller municipal a également droit à un crédit d’heures lui permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration de la commune ou de l’organisme auprès duquel il la représente et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
Ce crédit d’heure est forfaitaire et trimestriel. Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
La durée de ce crédit d’heures varie selon la taille de la commune. La durée du crédit d’heures pour un trimestre est égale (art. L. 2123-2 du code des collectivités territoriales, modifié par la Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique) :
En cas de travail à temps partiel, le crédit d’heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié, et la durée hebdomadaire légale du travail définie comme il suit :
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat.
Par ailleurs, la durée du crédit d’heures de l’adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire est, pendant la durée de la suppléance, celle mentionnée ci-dessus pour le maire de la commune.
La durée du crédit d’heures du conseiller municipal qui bénéficie d’une délégation de fonction du maire est quant à elle celle mentionnée ci-dessus pour un adjoint au maire de la commune.
Afin de bénéficier de ce crédit d’heures, le salarié élu membre d’un conseil municipal informe son employeur :
L’employeur n’est pas tenu de rémunérer ce temps d’absence.
Frédéric PAPOT
En principe, le contrat de travail prime sur l’accord collectif lorsqu’il est plus favorable. Avec l’accord de performance collective (APC), ce n’est plus le cas. En effet, si l’APC est approuvé par des syndicats représentatifs dans l’entreprise ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives aux dernières élections du CSE, cet accord s’impose aux salariés quand bien même il diminuerait leurs salaires ou augmenterait leurs temps de travail sans aucune compensation. A défaut, il est possible de recourir à un référendum si la ou les organisations signataires représentent plus de 30% des suffrages requis. L’article L.2232-12 du Code du travail précise que l’accord peut alors être validé s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
En cas d’accord, si un salarié refuse d’accepter les mesures prévues, la direction n’a même pas besoin de justifier d’un motif économique pour le licencier : le refus d’un salarié de se soumettre à l’APC constitue en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement ! Aucune obligation de licencier les salariés non-signataires de l’accord ne pèse sur l‘employeur. Cependant, le climat social dans l’entreprise sera évidemment dégradé et des tensions apparaîtront entre les salariés ayant signé l’accord et ceux l’ayant refusé.
L’importance des enjeux dans une telle négociation justifie que les syndicats soient accompagnés par l’expert prévu à l’article L. 2315-92 du Code du travail.
Consommez plus, travaillez plus, gagnez moins… Le monde d’après commence bien !
Malek SMIDA
« Fin du monde, fin du mois : même combat ! ». Entonné par les Gilets jaunes, ce slogan permet aujourd’hui de fortifier le rapprochement entre syndicats et associations qui défendent une rupture avec le modèle économique actuel.
Dès son préambule, le collectif met les points sur les i : « Nous ne nous contenterons plus des grands mots, des déclarations d’intention, des formulations creuses. Nous voulons démontrer, à travers l’articulation de mesures de court et de long terme, le pragmatisme et l’ancrage dans le réel de notre démarche. »
S’ensuivent 34 propositions reparties en 4 thèmes :
Ces mesures apparaissent d’autant plus audibles dans un contexte de crise sanitaire et sociale où certaines certitudes sont remises en cause.
Le collectif en est sûr : « c’est précisément dans les périodes de choc d’immédiat après-crise que l’histoire s’accélère, que les bifurcations sont engagées ou pas, que les décisions prises conditionnent pour une longue période la construction du futur ». Nous verrons bientôt si effectivement l’histoire s’accélère ou si, comme le prédisait Fukuyama après la chute du mur de Berlin, l’histoire est finie.
Retrouvez ici les 24 pages de ce plan de sortie de crise.
Malek SMIDA
On a beau savoir que les femmes gagnent en moyenne 25% de moins que les hommes, qu’elles gagnent 18,5% de moins en équivalent temps plein et 10,5% de moins à poste égal, certains secteurs d’activité arrivent encore à nous surprendre et à nous révolter davantage (lire notre article sur les chiffres de l’inégalité salariale entre les hommes et les femmes).
L’émission Cash Investigation « Egalité hommes femmes : balance ton salaire » diffusée le 19 mai dernier le confirme dans le secteur bancaire et plus précisément au sein du groupe Banque Populaire Caisse d’Epargne (BPCE) et de sa filiale de gestion d’actifs Natixis.
Le reste de l’émission est notamment consacré aux discriminations indirectes et aux différences de salaires en fin de carrière entre les métiers à prédominance masculine et ceux occupés majoritairement par les femmes (en particulier ceux relevant du soin et de la santé).
A travail égal, salaire égal ! Mais aussi : à travail de valeur égale, salaire égal !
Retrouvez l’intégralité de l’émission sur le site de France Télévisions.
Malek SMIDA
Lancée le 1er mai dernier, la Fédération du Printemps écologique souhaite faire prévaloir l’urgence écologique et la justice sociale au coeur des négociations en accompagnant le rôle actif des salariés dans la conversion écologique. Doté de six groupes locaux basés à Lyon, Paris, Bordeaux, Bruxelles, Toulouse et Marseille, le nouveau syndicat espère s’élargir rapidement, aussi bien dans le secteur privé que dans la fonction publique.
Dans son manifeste, le Printemps écologique porte l’idée d’un « contrat naturel qui, par la sobriété et la modération, redistribue avec équité la puissance entre les êtres humains et la nature ». Le syndicat a également pour objectif d’intégrer l’impératif écologique dans le Code du Travail.
Si ses dirigeants encouragent pour l’instant la double adhésion afin de ne pas entrer en confrontation avec les autres centrales syndicales, un maximum de candidats du Printemps écologique seront tout de même présentés lors des prochaines élections professionnelles.
Malek SMIDA
Attouchements, baisers forcés, contacts physiques non désirés… Cela fait longtemps que des salariés de McDonald’s alertent sur l’ambiance écœurante qui règne, aux quatre coins du monde, dans les restaurants de la multinationale. En 2018, des employés des McDonald’s de dix villes nord-américaines font grève pour pousser le géant du fast-food à prendre des mesures contre le harcèlement sexuel. Sans succès.
Sue Longley, secrétaire générale de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, est en colère : « Les salariés de McDonald’s ont sonné l’alarme depuis des années sur le harcèlement sexuel et la violence basée sur le genre, mais l’entreprise ayant une culture pourrie depuis le sommet a échoué à prendre des mesures ».
C’est pourquoi une coalition internationale de syndicats a décidé de passer à l’action et a porté plainte ce lundi devant l’OCDE. Les syndicats accusent McDonald’s d’avoir échoué à lutter contre un « harcèlement sexuel systématique » dans ses restaurants situés en Australie, au Brésil, au Chili, en Colombie, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Il s’agit de la première plainte pour « harcèlement sexuel généralisé dans une société multinationale » dans le cadre des Principes directeurs de l’Organisation. Ces principes prévoient notamment que les multinationales et leurs actionnaires respectent les droits du travail tels que la protection des salariés contre les violences sexuelles.
Le groupe McDonald’s se dédouane depuis des années en estimant qu’il n’est pas responsable des conditions de travail des employés de ses franchisés. Argument peu convaincant. Affaire à suivre !
1ère phase : Évaluation initiale de la plainte, Recevabilité (3 mois)
Le PCN réalise en premier lieu une évaluation initiale afin de déterminer si la plainte est recevable au titre des Principes directeurs. Le PCN ne peut rejeter une plainte sous prétexte que des actions parallèles ont existé, sont en cours ou pourraient être menées par les parties concernées.
2ème phase : Médiation (6 mois)
Si la plainte est recevable, le PCN cherche alors une solution à l’amiable entre les parties. Si la médiation aboutit, un rapport final sera publié et le PCN n’examinera pas davantage la plainte des requérants.
3ème phase : Examen approfondi de la plainte (3 mois)
Si la médiation échoue ou est refusée par l’entreprise multinationale, le PCN procède alors à un examen sur le fond afin de déterminer si l’entreprise a enfreint les Principes directeurs de l’OCDE. Pour cela, le PCN :
- Recueille des informations, notamment auprès d’ambassades, de hauts fonctionnaires, de représentants d’entreprises, de travailleurs, d’ONG et d’organisations intergouvernementales telles que l’OIT ;
- Consulte un ou plusieurs autres PCN concernés ;
- Interroge les plaignants et les multinationales.
Enfin, un communiqué final est publié par le PCN.
Les entreprises multinationales qui refusent de participer au processus de traitement des plaintes ou qui violent les Principes directeurs ne s’exposent à aucune sanction formelle. Les PCN sont cependant encouragés à transmettre leurs rapports et leurs communiqués finaux aux organismes publics concernés (organisme de crédits à l’exportation, département chargé des marchés publics, agence d’aide au développement…) qui peuvent tenir compte des agissements de l’entreprise dans leurs décisions. Une condamnation par l’OCDE n’est donc pas uniquement symbolique !
Malek SMIDA
Les premières données policières sont achetées par un dirigeant d’Ikea France au début des années 2000, mais l’accusation ne retiendra finalement que la période 2009-2012, date à laquelle FO a porté plainte (depuis rejointe par les autres centrales syndicales). Pendant des années, avec la complicité de policiers, d’un détective privé et d’employés infiltrés, la filiale française du géant de l’ameublement a mis au point un système d’espionnage digne de la Guerre froide. Ses ennemis ? Ses clients, ses salariés et ses futurs salariés !
Le parquet de Versailles l’a confirmé jeudi dernier : la société IKEA France ainsi que quinze autres personnes seront jugées en correctionnelle pour collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite.
Malek SMIDA
Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux entrepreneurs ont fait part des difficultés financières que rencontrent leurs entreprises. La parole a moins été donnée aux salariés.
Les résultats de l’enquête Acemo de la DARES relative à l’activité et aux conditions d’emploi de la main d’œuvre pendant la crise du Covid sont instructifs. La cible de cette étude n’est cependant pas idéale. En effet, seules les entreprises privées ont été interrogées et pas les salariés ! Aussi, trop peu d’éléments sont apportés sur les conditions de travail. C’est pourquoi l’Ugict-CGT a décidé de prendre le problème à bras-le-corps et de s’intéresser à ce que vivent directement les salariés, quelle que soit leur situation (télétravail, travail en présentiel ou arrêt d’activité).
Ces recherches font ressortir :
L’Ugict-CGT ne se contente pas de dresser un tableau de la situation mais est également force de propositions ! Parmi les 60 propositions pour sortir durablement de la crise sanitaire, sociale, économique et environnementale, on peut lire :
Malek SMIDA
Après Amazon, c’est maintenant le groupe Renault qui est pointé du doigt en cette crise sanitaire.
Jeudi 7 mai, le tribunal judiciaire du Havre, saisi par la CGT, a condamné en référé Renault à suspendre la reprise de la production de son site d’assemblage de Sandouville en raison de mesures de protection face au Covid-19 jugées insuffisantes.
Après avoir arrêté son activité le jour du confinement, l’usine normande l’avait partiellement reprise le 28 avril dernier, de manière trop négligente selon la justice. En effet, le tribunal judiciaire constate dans son ordonnance des manquements de l’employeur en matière de prévention et condamne ainsi Renault à « organiser et dispenser pour chacun des salariés, avant qu’ils ne reprennent le travail, une formation pratique et appropriée ».
La production est donc suspendue le temps de la mise en oeuvre effective de ces mesures.
Malek SMIDA
Pour aider les entreprises à reprendre leur activité tout en assurant la santé de leurs salariés, le ministère du travail a récemment publié un protocole national de déconfinement qui précise la doctrine générale de protection collective que les employeurs du secteur privé doivent adopter.
Divisé en 7 parties, ce protocole apporte des précisions relatives :
Retrouvez ici l’intégralité du protocole : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf
Malek SMIDA
Fin mars 2020. Aux quatre coins de France, le malaise est immense dans les entrepôts du mastodonte du e-commerce. Le confinement est la règle mais des milliers de salariés d’Amazon sont toujours contraints de se rendre dans ces centres de distribution totalement clos. La promiscuité inquiète, les arrêts de travail et les alertes se multiplient. Sur le site de Montélimar, près de la moitié des effectifs refuse dans de telles conditions de mettre en rayon les produits et d’emballer les commandes.
Mercredi 8 avril. Sud Solidaires saisit en référé le tribunal judiciaire de Nanterre. Considérant qu’Amazon met en danger ses salariés, le syndicat demande à titre principal la fermeture de six entrepôts.
Mardi 14 avril. C’est finalement la demande subsidiaire que les juges valideront : la réduction de l’activité aux 10 % de marchandises « essentielles » (alimentaires, médicales, d’hygiène et high-tech). Amazon est également condamnée à procéder à une évaluation des risques professionnels inhérents au Covid-19, des mesures prises pour protéger la santé des salariés dans ses entrepôts et d’y associer les représentants du personnel.
Vendredi 24 avril. Nouveau revers pour Amazon : la cour d’appel de Versailles confirme l’ordonnance du tribunal de Nanterre. En se basant notamment sur l’obligation de prévention qui pèse sur l’employeur, l’arrêt met en exergue l’absence d’évaluation des risques psychosociaux.
Alors que les pratiques de ses prestataires sont également pointées du doigt (lire notre article sur les centres d’appels Teleperformance), la crise du Coronavirus interroge notre modèle économique et nos modes de consommation. « L’Amazonisation » de notre société, est-ce un horizon viable ?
Malek SMIDA

Depuis six semaines, notre pays vit au rythme du confinement et des restrictions de déplacements. Face aux évolutions législatives et au déconfinement qui approche, les salariés et leur représentation sont désorientés. Atlantes continue de se mobiliser pour vous accompagner pendant cette période exceptionnelle.
C’est pourquoi nous avons décidé d’organiser une nouvelle session de questions-réponses sur Twitter !
Posez-nous vos questions sur nos réseaux sociaux pour que nous puissions y répondre pendant cette session en direct !
Ensemble, soyons solidaires. A jeudi !
Après qu’en mars Teleperformance ait fait l’objet d’une mise en demeure de l’inspection du travail sur son site de Blagnac, c’est maintenant au niveau international que les choses se compliquent pour le leader mondial des centres d’appels.
Le 17 avril 2020, les syndicats français CGT, CFDT et FO, associés à la fédération syndicale internationale Uni Global Union, ont porté plainte devant l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans le but de faire reconnaître, dans 10 pays, des manquements de Teleperformance aux principes directeurs de l’Organisation à destination des multinationales, dont ceux qui imposent de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la santé et la sécurité des salariés.
La direction de Teleperformance dément quant à elle ces accusations et prétend « travailler avec les syndicats locaux, au plus près du terrain ». Or, selon UNI Global Union, dans beaucoup de pays où le groupe Teleperformance est implanté, il n’y a pas de syndicats, ou pire encore : Teleperformance ne les reconnaît pas.
Malek SMIDA
Depuis un mois, notre pays vit au rythme du confinement et des restrictions de déplacements. Face aux évolutions législatives, les salariés et leur représentation sont désorientés. Atlantes continue de se mobiliser pour vous accompagner pendant cette période exceptionnelle.
C’est pourquoi nous avons décidé d’organiser une nouvelle session de questions-réponses sur Twitter !
Posez-nous vos questions aujourd’hui sur nos réseaux sociaux pour que nous puissions y répondre pendant cette session en direct !
Ensemble, soyons solidaires. A demain !
En fin de semaine dernière, l’exécutif a décidé de faciliter la mise à disposition temporaire de salariés au chômage partiel. Selon Muriel Pénicaud, certaines entreprises « doivent pouvoir être maintenues sans interruption afin de permettre aux Françaises et aux Français de s’approvisionner et de protéger leur santé ».
L’Etat n’aura alors plus à verser de salaire au titre du chômage partiel puisque le salarié retrouve son contrat de travail et 100% de son salaire habituel, versé par son employeur d’origine. L’entreprise utilisatrice remboursera ensuite ce salaire à l’entreprise prêteuse.
Deux conditions à ce prêt de main-d’œuvre : le volontariat et le but non lucratif de l’opération. En effet, aucune mise à disposition n’est possible sans l’accord du salarié, et l’entreprise prêteuse ne peut en retirer aucun bénéfice.
Malek SMIDA
Face à la complexité des récentes ordonnances en droit du travail, le ministère du travail a publié un guide détaillant, sous forme de questions-réponses, les évolutions procédurales du dispositif d’activité partielle ainsi que les nouvelles modalités de calcul de l’allocation d’activité partielle issues du décret du 25 mars 2020.
Téléchargez le guide ici : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-document-precisions-activite-partielle.pdf
Depuis le début du confinement, le secteur agricole est particulièrement touché par les restrictions de déplacement. Et pour cause…
Surnommés les saisonniers « OMI », ces salariés précaires originaires du Maghreb et d’Europe de l’Est travaillent principalement dans des exploitations de fruits et légumes. « OMI » pour Office des Migrations Internationales, l’organisme qui leur permet de travailler en France, pour des CDD de 4 à 6 mois. Pour qu’ils puissent venir, l’employeur doit démontrer que le marché du travail local manque de main-d’œuvre. Les saisonniers « OMI » deviennent alors la seule force de travail capable d’accepter les conditions de rémunération et de travail proposées.
Les territoires viticoles font énormément appel à ces bras (Régions PACA, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine). Une sorte de « délocalisation sur place ». Dans certains départements, aucune production ne serait possible sans eux : asperges du Gard et des Landes, horticulture dans les Bouches-du-Rhône, fraises en Dordogne ou dans le Lot-et-Garonne…
Décidément, le Coronavirus aura au moins servi à une chose : rendre visibles les invisibles.
Malek SMIDA
Dimanche 22 mars, le Parlement a adopté une loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Coronavirus et a autorisé l’exécutif à prendre des mesures par ordonnances dans plusieurs domaines, dont le droit du travail. La semaine dernière, plusieurs ordonnances ont temporairement modifié le Code du travail.
La réponse est donc oui, l’activité partielle peut être imposée à un salarié protégé, à condition que ce régime touche l’ensemble des salariés.
Si l’activité partielle n’affecte pas tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché le salarié protégé, la règle classique redevient applicable à savoir qu’aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel, y compris l’activité partielle, sans son accord.
Les dispositions de cette ordonnance sont applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.
Diego PARVEX et Malek SMIDA
Depuis ce lundi 30 mars, l’Etat portugais a décidé de régulariser de manière temporaire tous les immigrés qui sont en attente d’un titre de séjour, y compris les demandeurs d’asile. La raison est simple : les êtres humains présents sur le territoire portugais doivent être protégés contre l’épidémie de Coronavirus.
Pour être temporairement régularisées, les personnes sans-papiers devront simplement effectuer une demande auprès du service de l’immigration et pourront ainsi bénéficier des mesures prises pour l’ensemble des citoyens portugais contre le Covid-19 : prise en charge à domicile en cas de symptômes, garde d’enfants, dispositifs de protection de l’emploi et du salaire…
Une décision humaniste de salubrité publique ! Ne l’oublions pas, le virus ne regarde pas qui a des papiers et qui n’en a pas.
Malek SMIDA
Alors que les syndicats espagnols estiment à un million le nombre de salariés mis au chômage partiel, le gouvernement de Pedro Sánchez a pris, ce vendredi 27 mars, une décision courageuse : l’interdiction de tout licenciement pour cause de force majeure pendant l’épidémie.
Les entreprises soumises au droit espagnol ne pourront pas non plus mettre un terme aux contrats temporaires, qui peuvent être suspendus mais qui devront reprendre dès le retour à la normale.
Ces prises de position dans l’intérêt des salariés sont à la hauteur de la crise que nous vivons.
Malek SMIDA
Atlantes, en soutien aux personnels soignants et à tous ceux qui risquent leur vie pour la nôtre, a choisi de partager l’appel aux dons lancé par la Fondation de France, l’Institut Pasteur et la Fondation AP-HP, réunis sous l’alliance « Tous unis contre le virus ».
A partir de ce mercredi 25 mars, toutes les entreprises françaises en difficulté financière auront la possibilité de contracter des prêts bancaires à un taux de 0,25%.
La Fédération bancaire française a précisé qu’elle accordera un délai d’un an à ses débiteurs. A l’issue de ce délai, les entreprises auront deux possibilités :
Bien que limité à un montant équivalant à trois mois de chiffre d’affaires, ce prêt permettra à de nombreuses entreprises d’amortir un déficit d’activité lié à l’épidémie.
Malek SMIDA
L’équipe juridique d’Atlantes veille chaque jour aux évolutions législatives en droit social liées à l’épidémie de Covid-19.
Dimanche 22 mars, le Parlement a définitivement adopté une loi d’urgence pour faire face à cette épidémie. Le Gouvernement est autorisé à prendre des mesures par ordonnances dans plusieurs domaines.
En attendant, vous vous rappelons que vous pouvez nous poser toutes vos questions dans le cadre de notre Assistance juridique ouverte à toutes et à tous : https://www.atlantes.fr/-Coronavirus-428-
Jeudi 26 mars, à 11h puis à 14h, nous organiserons également deux sessions de questions-réponses en vidéo sur notre compte Twitter https://twitter.com/AtlantesAvocats
Posez-nous toutes vos questions sur Twitter ou Linkedin avant jeudi pour que nous puissions y répondre en direct !
Toute l’équipe d’Atlantes est votre à disposition pour vous accompagner au mieux pendant cette période de confinement.
Depuis ce mercredi 18 mars, les salariés ne pouvant effectuer leurs missions en télétravail et « dont l’état de santé conduit à les considérer comme présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie Covid-19 » peuvent demander à être mis en arrêt de travail sans passer par un médecin traitant ni par leur employeur.
La liste des salariés concernés a été détaillée par le Haut conseil de la santé publique :
Vous en faites partie ? Pour demander votre maintien à domicile, connectez-vous sur : https://declare.ameli.fr/
Entrant initialement en vigueur le 1er avril, les nouvelles règles d’indemnisation chômage seront lourdes de conséquences pour les demandeurs d’emploi.
En effet, le montant de leur indemnisation ne sera plus calculé sur la base des salaires des jours travaillés dans le mois, mais sur celle des salaires de la période allant du début du premier contrat de travail à la fin du dernier, y compris les jours non travaillés.
Les intérimaires et autres travailleurs précaires, déjà très touchés par les fermetures d’entreprises liées au Coronavirus, seront les premières victimes de ce nouveau mode de calcul. C’est pourquoi, à la demande notamment des syndicats, Muriel Pénicaud a annoncé ce lundi 16 mars le report des nouvelles règles de l’assurance chômage au 1er septembre 2020.
De quoi offrir un peu de répit à ces travailleurs précaires qui ne méritent pas un tel durcissement des conditions d’accès à leur droit au chômage.
Malek SMIDA
Compte tenu de l’épidémie de Coronavirus, nos services risquent d’être relativement perturbés. Pour autant, nous assurons la continuité de l’essentiel de nos prestations sous des formats adaptés.
En matière de conseil et d’assistance juridique, nous privilégions le travail via mail, téléphone, voire visioconférence ; les rdv physiques seront ainsi remplacés.
En matière de contentieux, l’essentiel des audiences est reporté (sauf procédures urgentes), sachant que nous continuons à traiter les dossiers et à être en contact avec les clients via mail, téléphone, voire visioconférence.
En matière de formation, elles sont pour l’heure reportées, mais nous continuons à traiter les demandes et les dossiers via mail et téléphone.
En tout état de cause, merci de privilégier l’envoi de vos demandes par mail afin d’être recontacté dans les meilleurs délais.
La gestion du coronavirus par l’autorité publique conduit à ce qu’un salarié peut être empêché de se rendre à son travail ; qu’il soit malade, ou qu’il ne le soit pas. En effet, une personne peut faire l’objet d’une mesure d’isolement ou de confinement lorsqu’elle a été en contact avec une personne infectée par le coronavirus, ou lorsqu’elle a séjourné dans une zone concernée par le foyer infectieux. Un parent peut également être contraint de rester à son domicile afin de garantir l’isolement de son enfant, lorsque ce dernier a été en contact avec une personne dont l’infection a été confirmée.
Le salarié qui se trouve dans l’une de ces situations, et se voit prescrire un arrêt de travail par un médecin de l’ARS habilité (Agence Régionale de Santé), peut bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale, dont le montant est complété par l’employeur.
Deux décrets des 31 janvier 2020 et 4 mars 2020 sont venus adapter les règles d’indemnisation pour tenir compte du caractère exceptionnel de la situation.
En substance :
En revanche les autres conditions pour être indemnisé restent applicables, notamment la condition d’ancienneté d’une année pour bénéficier du complément d’indemnité versé par l’employeur.
Textes de référence :
Frédéric PAPOT,
Juriste Atlantes.
Selon les chiffres publiés le 28 février dernier par la DARES, environ 444 000 ruptures conventionnelles individuelles ont été homologuées en 2019, soit une hausse de 1,5% par rapport à 2018. Cette augmentation est cependant moins importante que les années précédentes. En effet, sur la période 2014-2017, le nombre de ruptures conventionnelles individuelles connaissait une hausse moyenne d’environ 7 % chaque année.
Ce sont les salariés de moins de 30 ans qui ont vu dans leur tranche d’âge le nombre de ruptures conventionnelles reculer en 2019 (-1,3 %). Géographiquement, c’est la région Grand-Est qui connait la plus forte baisse (-1,5%).
Les ruptures conventionnelles continuent cependant de grimper chez les cadres (+9,3%) et dans le secteur de l’information et de la communication (+12%).
Face au succès florissant que rencontrent les ruptures conventionnelles depuis une douzaine d’années et aux interrogations légitimes sur la réalité du caractère libre et éclairé du consentement du salarié, le cabinet Atlantes a décidé d’organiser une Matinale sur le sujet.
Comment préserver les droits du salarié ? Qu’en est-il en cas de manquements de l’employeur ? Quelle est la procédure à respecter ? C’est notamment à ces questions que nous répondrons le 5 mai à Paris.
Qu’il s’agisse d’une rupture conventionnelle individuelle ou collective, vous avez un rôle à jouer pour accompagner les salariés concernés !
Plus d’informations et inscriptions à la Matinale sur notre site : https://atlantes.fr/Paris-Les-ruptures-conventionnelles-individuelles-ou-collectives
Malek SMIDA
Après la plateforme Take it Easy le 28 novembre 2018, c’est maintenant au mastodonte Uber que s’attaque la Cour de cassation. Dans un arrêt du 4 mars 2020, la Cour de cassation a requalifié en contrat de travail le contrat de « partenariat » d’un chauffeur Uber, enregistré au répertoire Sirene en tant qu’indépendant, statut que les juges estiment fictif.
Dans cette affaire qui fera date, un chauffeur uberisé, dont le compte a été désactivé par la plateforme, avait saisi les prud’hommes d’une demande de requalification de sa relation contractuelle avec Uber en contrat de travail, tout en réclamant des rappels de salaires et des indemnités de rupture. Pour caractériser l’existence d’un lien de subordination, la Cour de cassation utilise la méthode du faisceau d’indices :
Cette autorité d’Uber sur le chauffeur, qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements, est constitutive d’un lien de subordination synonyme de contrat de travail.
Une nouvelle déconvenue pour ces plateformes numériques à qui la Cour de cassation rappelle ce qu’est un contrat de travail.
Malek SMIDA
En 2020, l’homophobie au travail continue d’empoisonner la vie de certaines entreprises françaises. Ces discriminations paralysent l’épanouissement professionnel des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) et affectent en conséquence les performances des entreprises. Le 12 février dernier, après avoir interrogé 18 182 salarié·e·s, l’association l’Autre Cercle a partagé les résultats de son baromètre sur l’inclusion professionnelle des personnes LGBT+.
Sans grande surprise, on y apprend que les agressions physiques ou verbales de la part d’un collègue ou d’un supérieur sont monnaie courante : un quart des salarié·e·s interrogé·e·s affirment en avoir déjà subies. Aussi, 13% des personnes interrogées se sentent mises à l’écart des autres salarié·e·s en raison de leur orientation sexuelle.
Ces agissements conduisent une grande majorité de salarié·e·s LGBT en couple à cacher au travail l’identité de leur partenaire (77%).
Enfin, 15% des salarié·e·s LGBT s’estiment discriminé·e·s dans le déroulement de leur carrière et 12% pensent même que leur rémunération en est impactée.
Malek SMIDA
L’ordonnance Macron du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a modifié le délai de contestation des accords collectifs. Fixé auparavant à cinq ans, ce délai est aujourd’hui de deux mois seulement.
Dans cette affaire opposant la société MEUBLES IKEA FRANCE au Comité d’établissement IKEA EVRY représenté par Me Benoit MASNOU et Me Diego PARVEX du cabinet Atlantes, un accord d’entreprise conclu le 25 mai 2017 réserve, selon la direction, la faculté de désigner un expert au niveau du seul comité central d’entreprise.
Ce n’est pas l’avis de la Cour d’appel de Paris qui affirme dans son arrêt du 23 janvier dernier « que la société Meubles Ikéa France ne pouvait pas se prévaloir des nouvelles dispositions issues de l’ordonnance n°2017-1385 instaurant le bref délai pour s’opposer au moyen soulevé par le comité d’établissement d’Evry par voie d’exception, en vue de contester la légalité de l’accord de dialogue social signé le 25 mai 2017 entre la société et les organisations syndicales représentatives. »
La voie d’exception, recours judiciaire défensif permettant de contester la légalité d’un texte, n’est donc pas soumise au délai de deux mois !
L’action en nullité des accords collectifs par voie d’exception ne souffrant d’aucune prescription, la Cour a donc pu juger sur le fond : « En outre, à la date de la signature de cet accord, l’article L.2323-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi Rebsamen n°2015- 994 du 17 août 2015, applicable aux accords collectifs définissant les modalités d’organisation des consultations récurrentes des IRP, ne prévoyait pas la possibilité de conclure un accord dérogatoire quant au niveau de la consultation. […] Les dispositions de l’accord signé le 25 mai 2017, qui avaient réservé au seul comité central d’entreprise de la société Meubles Ikéa France, les consultations périodiques, intégrant la politique sociale et la situation économique et financière de l’entreprise, n’étaient pas conformes au cadre légal alors applicable ».
La désignation d’un expert par le comité d’établissement était donc tout à fait légale. Une belle victoire pour le droit à l’expertise des représentants du personnel !
Un pourvoi en cassation a été formé par la société IKEA. Nous vous tiendrons informés du résultat.
Malek SMIDA
Après un avis décevant rendu par la Cour de cassation en juillet, voilà une précieuse victoire pour les opposants au plafonnement des indemnités prud’homales, dont le cabinet Atlantes fait activement partie. Le 11 février 2020, le Comité européen des droits sociaux (CEDS) - l’institution chargée d’interpréter la Charte sociale européenne – a communiqué sa décision relative au plafonnement des indemnités prud’homales italiennes, pays où est appliqué depuis 2015 un dispositif relativement similaire au barème « Macron ».
En effet, en cas de licenciement illégal en Italie, une indemnisation plafonnée est prédéterminée en fonction de l’ancienneté du travailleur, sans que le juge puisse apprécier le préjudice réellement enduré et octroyer, le cas échéant, une majoration.
Dans sa décision, s’agissant des licenciements sans cause réelle et sérieuse, le Comité européen des droits sociaux affirme « qu’en plus de ne pas permettre la réintégration dans son poste de travail, les dispositions contestées prévoient une indemnisation qui ne couvre pas les pertes financières effectivement subies, puisque son montant est plafonné à 6, 12, 24 ou 36 mensualités de référence selon les cas. »
C’est pourquoi les membres du Comité rappellent que « tout plafonnement qui aurait pour effet que les indemnités octroyées ne sont pas en rapport avec le préjudice subi et ne sont pas suffisamment dissuasives est en principe, contraire à la Charte ».
Par conséquent, le Comité considère, par 11 voix contre 3, qu’il y a violation de l’article 24 de la Charte sociale européenne.
Bien que les décisions du Comité n’aient pas de caractère contraignant pour les Etats, cette nouvelle prise de position du CEDS pourrait conduire le gouvernement italien à revoir sa copie.
En France, le combat n’est donc pas perdu ! Nous attendons toujours un arrêt de la Cour de cassation sur la conventionnalité du barème « Macron ».
Ce barème, qui fixe un prix à la violation de la loi, est profondément immoral et socialement injuste. Il doit être définitivement abrogé.
Si vous partagez également ce constat, merci de prendre quelques secondes pour signer notre pétition.
Malek SMIDA
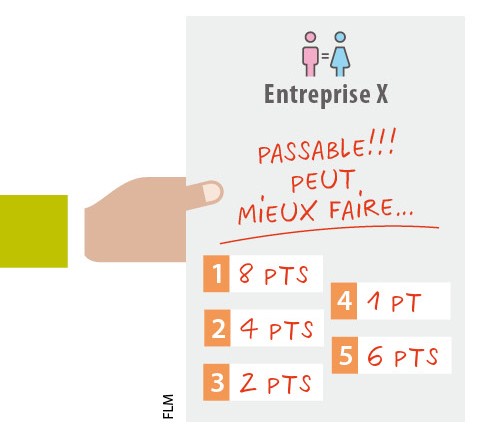
Faisant suite à une longue liste de textes internationaux, européens et nationaux, la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel (Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 ; JO du 6 septembre 2018) a ajouté à l’arsenal législatif destiné à lutter contre les discriminations et à assurer une égalité de traitement entre les femmes et les hommes, un nouvel outil : les entreprises de 50 salariés et plus doivent chaque année procéder au calcul et à la diffusion d’informations se rapportant aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 a échelonné dans le temps la date de première publication des résultats, selon la taille de l’entreprise (article 4 du décret) :
Les employeurs doivent mesurer les écarts entre les femmes et les hommes en tenant compte de 4 indicateurs dans les entreprises de 50 à 250 salariés, et 5 indicateurs dans les autres entreprises. Puis, une note globale est attribuée à l’entreprise. Si cette note est inférieure à 75 points, l’entreprise dispose alors de 3 années pour corriger la situation.
(textes de référence : articles L. 1142-7 et s. ; D. 1142-1 et s. du Code du travail).
Frédéric PAPOT, Juriste Atlantes.
Depuis une décision du 11 septembre 2019 (Cass soc. 11 septembre 2019, n° 18-23.764) nous savons que la Cour de cassation a repris dans le cadre du CSE la règle d’interdiction de cumul des fonctions de représentant syndical et d’élu au sein de l’instance. Dans la décision du mois de septembre 2019, la Cour de cassation en déduit que le Tribunal d’instance peut ainsi enjoindre à un élu suppléant au CSE de choisir entre son mandat électif et celui de représentant syndical à ce même comité. A défaut de choix, le Tribunal peut alors déclarer nulle la désignation.
Dans un arrêt du 22 janvier 2020 (Cass soc. 22 janvier 2020, n° 19-13.269, destiné à la publication au bulletin), la Cour de cassation confirme sa position : « un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu’il ne peut, au sein d’une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d’élu et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu’il est désigné par une organisation syndicale » et – c’est là la nouveauté de la décision - elle ajoute « sans qu’un accord collectif puisse y déroger ».
Le jugement a été favorable à l’employeur en imposant au salarié d’opter pour l’un de ses deux mandats dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision et en précisant qu’à défaut de choix son mandat de représentant syndical au sein du comité social et économique serait caduc.
C’est ce jugement qui a fait l’objet du pourvoi dont les auteurs invoquaient notamment que l’accord relatif au dialogue social et économique applicable dans le groupe ne comporte aucune exclusion ni distinction ; et qu’en conséquence le juge devait, comme cela lui avait été demandé, rechercher si cet accord collectif ne permet pas un cumul de mandats.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant ainsi sa jurisprudence à laquelle il n’est donc pas possible de déroger par des stipulations conventionnelles plus favorables.
Frédéric PAPOT, Juriste ATLANTES.
Mise en place en 2019, le dispositif a été maintenu en 2020. Une instruction de la direction de la sécurité sociale du 15 janvier 2020 apporte certaines précisions.
Les employeurs éligibles :
Les salariés éligibles :
L’existence d’un accord d’intéressement
La DSS rappelle que les ESAT sont dispensés. Sont également concernées les associations et fondations reconnues d’intérêt général.
En principe, l’accord d’intéressement doit être effectif au moment du versement de la prime. L’administration tempère ce critère puisqu’une entreprise qui a engagé des négociations pour le renouvellement de son accord d’intéressement expiré avant fin 2019 peut faire bénéficier des salariés de la prime Macron avant la conclusion d’un nouvel accord, sous réserve de le conclure et de le déposer dans les conditions et délais prévus par la loi.
Afin de rassurer les employeurs, l’instruction précise que le versement effectif d’une prime n’est pas une condition pour pouvoir attribuer la prime Macron. De la même façon, une remise en cause postérieure de l’accord ne remet pas en cause l’exonération.
Modulation de la prime
Des critères combinables peuvent être utilisés pour moduler la prime :
Pour ce dernier critère, il convient d’entendre par « année écoulée » précise l’administration : les 12 mois précédant le versement de la prime. La modulation pourra également se faire entre les différents établissements de l’entreprise précise l’instruction.
Non-respect des conditions d’exonération
Le bénéfice de l’exonération est conditionné pour l’employeur au respect de l’ensemble des conditions d’attribution. En cas d’absence d’accord d’intéressement l’ensemble des primes attribuées seront réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions et assujetties à l’impôt sur le revenu.
En outre, à défaut, le redressement pourra être opéré dans des conditions similaires à celles applicables pour le contrôle de l’application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire fixées à l’article L. 133-4-8 du code de la sécurité sociale autorisant à réduire le redressement à proportion des seules erreurs commises.
Ainsi, en pratique, le redressement sera réduit à hauteur des cotisations et contributions sociales dues sur les seules sommes faisant défaut ou excédant les conditions et limites prévus par la loi. En outre, pour les cas d’exonération par l’employeur des primes excédant le montant maximal de 1 000 € par salarié, seule la part excédentaire sera assujettie dans les conditions de droit commun. De la même manière, seules les primes versées aux salariés dont la rémunération excède le plafond d’exonération (3 Smic) seront réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales.
Retrouvez l’instruction ici :![]() Instr. minis. DSS/5B/2020/11, 15 janv. 2020
Instr. minis. DSS/5B/2020/11, 15 janv. 2020
Maxence DEFRANCE, Juriste ATLANTES
Pour la deuxième année consécutive, l’IFOP publie une étude pour Syndex sur la mise en place du CSE. L’enquête a été menée fin 2019 auprès d’un échantillon de 812 élus du personnel. Comparons ces résultats avec ceux de 2018.
Trois quarts des représentants du personnel étaient inquiets fin 2018 quant à leur passage en CSE.
Ils sont aujourd’hui 65%.
60% des élus interrogés en 2018 anticipaient une détérioration du dialogue social dans leur entreprise suite au passage en CSE. Un an après, 55% craignent toujours cette détérioration.
Ces deux légères améliorations doivent être relativisées. En effet, fin 2018, seul un quart des personnes interrogées étaient passées en CSE. Dans cette deuxième enquête, ils sont près de la moitié.
Enfin, deux autres informations ont attiré notre attention :
Malek SMIDA
Un ingénieur, délégué syndical depuis 2006, est victime de discrimination. En 2009, il attaque aux prud’hommes son employeur et exige son repositionnement au regard de son ancienneté et du panel de comparaison.
Après un long combat judiciaire, la Cour d’appel de Versailles, saisie sur renvoi après cassation (Cass. Soc. 9 mai 2018, n°16-22.589) a statué le 19 décembre dernier sur les conséquences de cette discrimination syndicale.
Selon les juges, « la réparation intégrale d’un dommage oblige à placer celui qui l’a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu ».
Dans cette affaire, l’entreprise a créé une classification interne parallèle à la convention collective laissant place « à une appréciation totalement subjective des compétences du salarié, de sorte que le passage d’un grade à l’autre reste à la discrétion de l’employeur » et ne repose « sur aucun élément précis ».
La Cour d’appel, « au vu de l’ancienneté acquise dans ses fonctions et au regard du panel de comparaison », a donc ordonné le repositionnement du salarié à une classification plus élevée, position où il se serait trouvé sans cette discrimination.
Se pose donc la question du calcul du préjudice subi par le salarié (économique et moral), dont le montant est apprécié souverainement par les juges du fond.
Dans son arrêt, la Cour affirme que « ce préjudice économique est composé des pertes de rémunérations, du préjudice d’intéressement et de participation et du préjudice de retraite ».
La Cour juge que ces douze années de discrimination syndicale représentent pour le salarié un préjudice économique de 179 000 euros. 5 000 euros lui sont également accordés au titre de son préjudice moral.
Parmi les salariés syndiqués, 46% estiment avoir été discriminés au cours de leur vie professionnelle, directement ou indirectement, en raison de leur appartenance syndicale. Plus de la moitié considère que leur engagement a représenté un frein dans leur évolution professionnelle (qualification, avancement, grade) et 44% de ces salariés affirment que leur activité a eu un impact négatif sur leur rémunération.
Vous estimez avoir été discriminé en raison de votre engagement syndical ? Contactez-nous. Nous sommes prêts à vous défendre pour réparer cette injustice !
Cour d’appel de Versailles 21e ch., 19 décembre 2019, n° 18/03801
Malek SMIDA
Plus les semaines passent et plus il semble difficile de trouver des points positifs dans cette réforme des retraites. Alors que la question du financement du régime par points cristallise les inquiétudes, penchons-nous sur un élément essentiel de ce système : la baisse des cotisations pour les très hauts revenus.
Le projet de réforme envisage la suppression des cotisations vieillesse pour les cadres gagnant plus de 10.000 euros par mois. Ces hauts revenus ne participeraient que symboliquement au nouveau régime via une cotisation de « solidarité » dont le taux de prélèvement ne serait que de 2,8%. C’est dix fois moins que ce qu’ils cotisent aujourd’hui.
Ces cadres supérieurs verront donc leurs pensions baisser. Pour conserver à la retraite leur niveau de revenus, la loi les incite fortement à opter pour une assurance retraite privée. En effet, la loi PACTE prévoit désormais que ceux qui cotiseront pour leur retraite dans une assurance privée pourront déduire de leurs impôts le montant de leurs cotisations. De quoi les pousser à investir dans une retraite par capitalisation.
En plus des fonds de pensions et des assurances, les grands gagnants de cette baisse de cotisations sont les grandes entreprises employant ces cadres supérieurs. En effet, 60% des cotisations actuelles de ces hauts revenus sont des cotisations patronales. Encore un beau cadeau de 2 à 3 milliards par an pour ces entreprises…
Fort de ces constats, le débat sur le financement du système de retraite constitue une vaste fumisterie.
Malek SMIDA et Olivier CADIC
Une majorité d’êtres humains ne croit plus aux vertus du système capitaliste. Voici la conclusion de l’enquête Edelman 2020 réalisée auprès de 34 000 salariés dans 28 pays du monde.
56% des personnes interrogées estiment que le capitalisme « apporte plus de mal que de bien ». Cette défiance vis-à-vis du libéralisme économique touche également les « gagnants » de la mondialisation : 57% des sondés parmi les plus hauts revenus partagent ce constat. En France, le malaise est encore plus profond (69%).
Comment expliquer cette perte de confiance aux quatre coins de la planète ?
La peur de perdre son emploi (83%) en serait la cause première. Cette crainte révèle le refus d’un système courtermiste encourageant le dumping social et les délocalisations, se rendant ainsi complice des chantages à l’emploi et des burn-out. Cette angoisse met en lumière l’exaspération de salariés ne voulant plus choisir entre chômage et emplois précaires.
Aussi, un sentiment d’injustice est largement partagé par les salariés (74%). Le capitalisme financiarisé et son ruissellement ne convainquent plus grand monde, notamment en France où les salariés travaillent en moyenne 45 jours par an pour financer les actionnaires. En 1981, c’était 9 jours. Les richesses, entièrement produites par les salariés, n’ont jamais été aussi mal réparties.
Enfin, les salariés semblent comprendre que nous arrivons à la fin d’un cycle. L’absurdité du mythe d’une croissance infinie dans un monde aux ressources finies éclate au grand jour. Cette prise de conscience est exponentielle. Les salariés ne veulent plus abimer leur santé ni détruire la planète pour un point de PIB. Pour cela, nombreux sont prêts à tourner la page.
Malek SMIDA
Le mois dernier, la DARES a communiqué une étude sur la proportion de salariés bénéficiant de la revalorisation annuelle du salaire minimum. Ces résultats nous permettent donc de connaitre la part des salariés payés au SMIC horaire en France.
Depuis 2016, le nombre de salariés rémunérés au Smic horaire ne fait que de grimper et atteint aujourd’hui 13,4% des salariés. La France n’avait pas connu une telle proportion de smicards depuis onze ans !
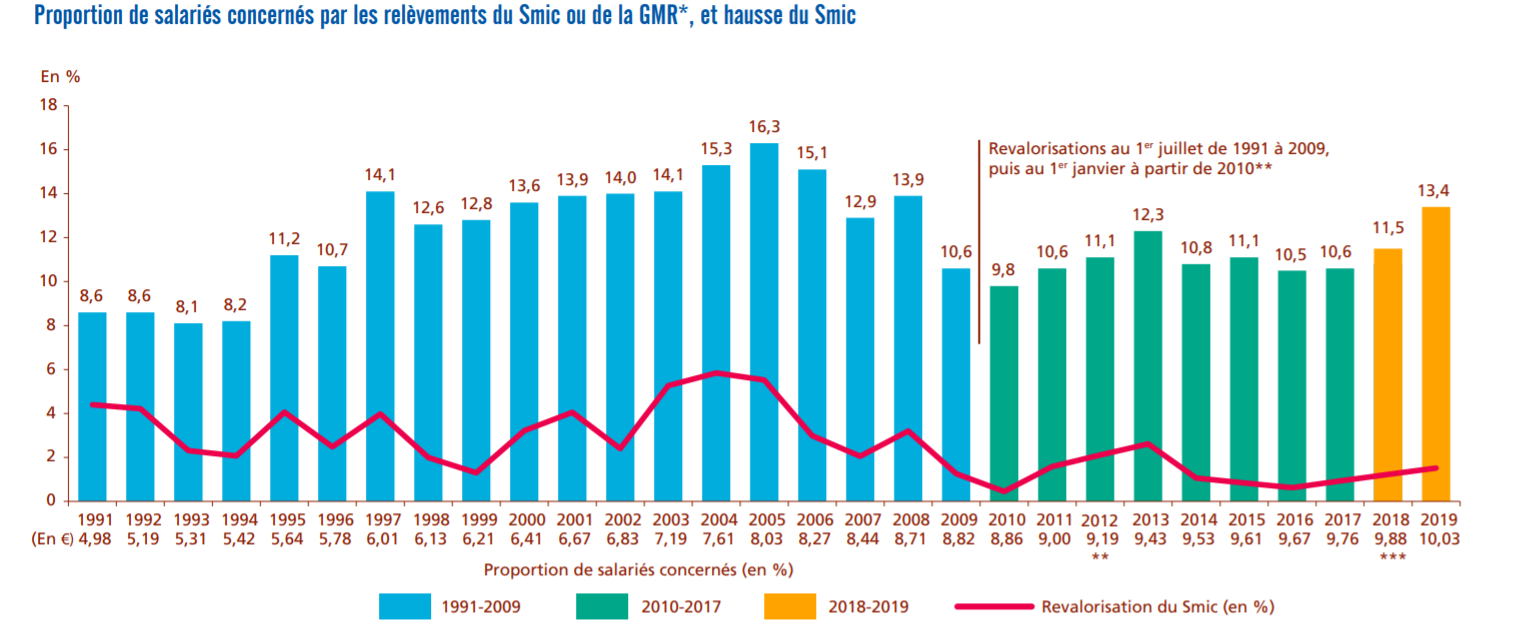 source : Dares
source : Dares
Que ce soit pour conserver notre système de retraite actuel, pour relancer la consommation populaire, ou pour combattre les inégalités salariales hommes/femmes, il est maintenant urgent d’augmenter significativement le salaire minimum. En effet, ne l’oublions pas, l’immense majorité des salariés payés au SMIC sont des salariées.
Malek SMIDA

Jeudi 16 janvier à Bruxelles, Amélie Klahr, Benoit Masnou et Diego Parvex du cabinet Atlantes ont rencontré Mme Claude Denagtergal, conseillère à la Confédération européenne des syndicats.
Cet entretien fut l’occasion d’échanger sur les questions relatives aux instances représentatives du personnel européennes (comités d’entreprise européen, comité de société européenne), sur les conseils syndicaux interrégionaux, ou encore sur les syndicats et la protection de l’environnement et le développement durable à l’échelon européen.
Merci à Sophie Mosca du cabinet Secafi pour l’organisation de cette réunion ainsi qu’à Claude Denagtergal, Jacqueline Rotty et Romuald Jagodzinski pour leur accueil.
Parce que les intérêts des salariés se défendent également au niveau européen, Atlantes entend y être présent !
Dans cette affaire, une salariée avait alerté par courrier son employeur du harcèlement moral qu’elle prétendait subir de la part de sa supérieure hiérarchique. La salariée demandait notamment la réparation du préjudice subi du fait de l’inertie de la direction qui, malgré son alerte, n’avait mené aucune enquête ni pris aucune mesure. Pour la cour d’appel, le harcèlement moral n’étant pas établi, il ne pouvait être reproché à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité.
Pour la Cour de cassation la logique est tout autre : « l’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte (des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail), est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du Code du travail et ne se confond pas avec ».
Dès lors, l’employeur alerté d’une situation de harcèlement moral dont se plaint un salarié doit diligenter des mesures d’investigation en interne pour évaluer la situation et prendre, le cas échéant, les correctifs nécessaires. À défaut de toute réaction, il manque à son obligation générale de prévention et peut être condamné à indemniser le salarié.
Cass.soc., 27 novembre 2019, n° 18-10.551 FP-PB
Maxence DEFRANCE
Juriste Atlantes
Les informations contenues dans la BDES doivent porter sur les deux années précédentes, sur l’année en cours et intégrer les perspectives sur les trois années suivantes. Quid en cas de fusion pour les entreprises absorbées ? C’est la question à laquelle a répondu la Cour de cassation.
Dans cette affaire et s’agissant de la consultation annuelle sur la politique sociale d’une entreprise résultant de la fusion de deux entités, la Cour de cassation est venue préciser que « dans le cas d’une opération de fusion, les informations fournies doivent porter, sauf impossibilité pour l’employeur de se les procurer, sur les entreprises parties à l’opération de fusion, pour les années visées aux articles précités ».
Même si cette décision a été rendue sous l’égide du CE, elle est pour nous tout à fait transposable au CSE.
Il conviendra donc d’être vigilant sur le sujet et de solliciter ces informations de la direction.
Cass. Soc., 27 nov. 2019, n° 18-22.532
Maxence DEFRANCE,
Juriste Atlantes
Le changement d’année est souvent propice aux bonnes résolutions.
Sachant que le CSE doit au moins 4 fois par an aborder des points en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail, nous vous invitons à ne pas tarder pour demander à la direction le calendrier qu’elle entend mettre en place pour l’année à venir.
Nul doute qu’au nom d’un dialogue social de « haut niveau », votre direction saura vous mettre en copie de cette information. Il vous restera en cas d’oubli, dénué bien évidement de toute malveillance de la part de cette dernière, à solliciter la transmission d’une copie de celle-ci. Il serait pour le moins curieux de constater que les membres du CSE se trouvent être les seuls à ne disposer d’aucune information concernant leur propre activité.
Olivier CADIC
En signant une rupture conventionnelle, l’employeur et le salarié en CDI conviennent d’un commun accord de la rupture du contrat de travail qui les lie. Une fois homologuée - ou validée - par l’inspection du travail, la rupture conventionnelle donne droit au salarié aux allocations chômage et à défaut de meilleur accord, lui permet de bénéficier de l’indemnisation spécifique de rupture prévue par la loi.
Après une baisse en septembre 2019, une récente étude de la DARES nous apprend que le nombre de ruptures conventionnelles est reparti à la hausse le mois suivant. En effet, 37 900 ruptures conventionnelles ont été homologuées en octobre.
Notons également qu’en octobre, 5.3 % des demandes de ruptures conventionnelles ont été refusées par l’administration pour des manquements aux prescriptions légales (tenue d’au moins un entretien, indemnité supérieure au minimum légal, respect du délai de rétractation de 15 jours calendaires…).
L’une des explications de la hausse constante des ruptures conventionnelles peut se trouver dans les politiques successives de flexibilisation de l’emploi. Le plafonnement des indemnités prud’homales, notamment, décourage de nombreux salariés à s’engager dans la voie contentieuse pour faire valoir leurs droits ; ces salariés préférant alors négocier à l’amiable leur départ à travers une rupture conventionnelle. Par ailleurs, il est vrai que souvent, l’employeur veuille un peu plus que le salarié de cette rupture conventionnelle.
Mercredi 11 décembre, Edouard Philippe promettait dans son discours sur les retraites des départs anticipés ou des fins de carrière à temps partiel pour les salariés dont les conditions de travail sont pénibles. Après que le Président de la République ait confié ne pas adorer le mot pénibilité « parce que ça donne le sentiment que le travail serait pénible », qu’est-ce que la pénibilité selon le gouvernement ? Quels salariés sont concernés ?
Depuis 2015, les entreprises doivent déclarer chaque année les salariés exposés à certains facteurs de risques professionnels. Celles et ceux exposés au-delà du seuil réglementaire cumulent des points sur leur compte pénibilité qu’ils peuvent ensuite utiliser pour bénéficier de formations, réduire leur temps de travail ou partir en retraite avant l’âge légal.
A peine élu, alors que dix critères de pénibilité étaient pris en compte, Emmanuel Macron juge que certains facteurs ne sont pas assez pénibles et décide de supprimer :
Par conséquent, le « compte professionnel de prévention » (C2P) ne comporte plus que 6 facteurs de risques :
Les patrons dont les salariés étaient exposés à ces risques devaient payer des cotisations sociales supplémentaires. Depuis le 1er janvier 2018, ces cotisations spécifiques ont été supprimées, ce qui fait donc disparaître toute incitation financière à la prévention.
De plus, ce n’est pas parce qu’un salarié est exposé à l’un des 6 critères de pénibilité qu’il pourra pour autant acquérir des points sur son C2P. En effet, les seuils ont été fixés tellement haut qu’ils n’englobent qu’une maigre partie des salariés subissant des conditions de travail pénibles.
Dépassent par exemple les seuils de pénibilité les salariés travaillant chaque année :
900 morts au travail par an dont 400 suicides, 4500 handicapés du travail, 650 000 arrêts de travail, un demi-million de ruptures conventionnelles signées chaque année…
Ces chiffres ne font pas les unes des chaines d’infos mais reflètent la triste réalité du monde du travail. Alors oui, que l’on adore ou pas ce mot, le travail est bien pénible. Il est navrant de constater qu’en souhaitant modifier une nouvelle fois le dispositif des retraites, un gouvernement fasse à ce point l’autruche sur la question pénibilité, alors que ce thème devrait être au cœur des débats. Ils veulent donc nous faire travailler plus mais dans quel état !
Enfin seriez-vous prêts à laisser monter vos enfants dans un car scolaire conduit par une personne de 64 ans ou voyager dans un avion piloté par un commandant de bord du même âge ?
Malek SMIDA & Olivier CADIC
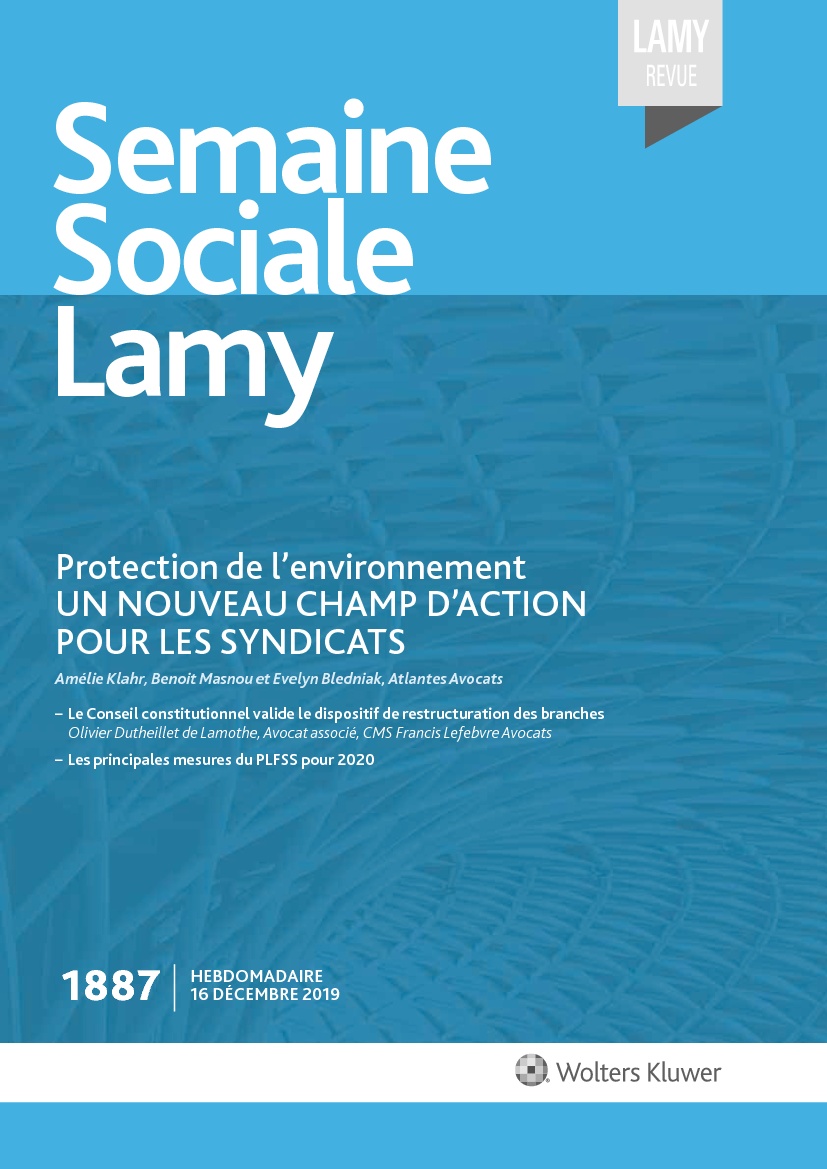
Grâce au travail de notre juriste Amélie Klahr et de nos avocats Benoit Masnou et Evelyn Bledniak, nous publions dans la Semaine sociale Lamy du 16 décembre un article consacré aux syndicats et à la protection de l’environnement : le pouvoir du collectif.
A l’heure où la protection de l’environnement constitue un enjeu capital, il nous a semblé intéressant de revenir sur le rôle que peuvent avoir les organisations syndicales.
Retrouvez l’intégralité de notre article ci dessous :

Nos équipes de formateurs (juristes, avocats, experts…) accompagnent les représentants du personnel en leur fournissant les éléments clés pour exercer leur mandat.
Rôle du CSE, du secrétaire, du trésorier, gestion des budgets, élaboration d’avis, harcèlements au travail mais aussi des thèmes sur la négociation, les restructurations, les ruptures de contrats… C’est plus de 40 sujets, en inter ou en intra, que nous animons dans toute la France !
Séquencées en format court d’une ou deux journées, cette souplesse permet aux élus de programmer des formations tout au long de l’année.
Découvrez notre nouveau catalogue formation : https://atlantes.fr/IMG/pdf/formation2020-1-ok-web.pdf

Jeudi 12 décembre, nous organisions au Théâtre Nouvelle Génération de Lyon notre dernière Matinale de l’année : CSE, partez sur des bases solides ! Animée par nos juristes Justin Saillard-Treppoz et Audrey Lioté, cette rencontre fut l’occasion d’échanger sur la mise en place du CSE et de répondre aux interrogations que la nouvelle instance suscite.
De la disparation des CHSCT au droit d’alerte en passant par les informations-consultations et les situations de harcèlement au travail, de nombreux sujets ont été évoqués au cours de nos discussions.
Nous sommes ravis d’avoir animé cette année des Matinales à Lyon, à Marseille et à Paris. Nous espérons qu’elles vous ont intéressés. Nous vous tiendrons informé.es en 2020 des prochains évènements que nous organiserons !

Depuis trois ans, Atlantes contribue au loto organisé par les sapeurs-pompiers d’Argenteuil (95) au profit du Téléthon. Le 6 décembre dernier, la participation de plus de 500 personnes à cet événement a permis de récolter 7000 €, le plus gros don de toutes les casernes du Val d’Oise ! L’intégralité de cette somme servira à financer des projets de recherche sur les maladies génétiques rares.
Toute l’équipe d’Atlantes félicite les pompiers d’Argenteuil pour ce succès !
Hôpitaux, aéroports, EDF, cheminots, avocats, pompiers, enseignants, étudiants, retraités… En cette veille de mobilisation contre la réforme des retraites, la contestation s’annonce massive. De quoi raviver, 24 ans plus tard, le souvenir des trois semaines de grèves de 1995 qui ont renversé le « plan Juppé » sur les retraites et la Sécurité sociale.
Un contexte tendu à la SNCF.
En 1995, un projet de contrat Etat-SNCF prévoyant la suppression de milliers de kilomètres de lignes met le feu aux poudres. L’attaque contre leur régime de retraite fut la goutte de trop.
En 2019, entre les désaccords sur les conditions de travail, le droit de retrait contesté par la direction et par l’Etat, la réforme ferroviaire qui reste en travers de la gorge des syndicats, l’atmosphère est tout aussi explosive.
Une lutte étudiante convergente.
En 1995, des grèves portant sur les conditions budgétaires s’organisent dans une vingtaine d’universités. La mobilisation des étudiants se joint ensuite au mouvement social contre le plan Juppé.
En 2019, la situation dans les facs est extrêmement préoccupante après l’immolation d’un étudiant devant le CROUS de Lyon. Les syndicats dénoncent une paupérisation estudiantine croissante. Opposés à cette réforme, ces derniers craignent qu’un allongement de la durée de cotisation retarde l’entrée des jeunes sur le marché du travail.
Cette fois-ci, tout le monde est concerné.
En 1995, seuls les fonctionnaires étaient visés par le plan Juppé. Dans le projet de réforme présenté cette année par Jean-Paul Delevoye, l’ensemble des salariés devront cotiser plus longtemps. En effet, l’introduction d’un âge pivot, en dessous duquel le montant des pensions fera l’objet d’un malus, aura pour conséquence un allongement de la durée de cotisation de tous les salariés.
L’absence de Gilets Jaunes en 1995.
Il y a 24 ans, la mobilisation contre la réforme était principalement syndicale. Aujourd’hui, les syndicats peuvent compter sur un mouvement neuf et populaire : celui des Gilets Jaunes. Leurs manifestations les samedis permettront de mobiliser les salariés du privé, souvent moins disposés à faire grève en semaine.
Emmanuel Macron avait annoncé cette réforme pendant sa campagne présidentielle.
En 1995, Jacques Chirac déclare vouloir réduire les déficits « pour qualifier la France pour la monnaie unique européenne ». Il improvise alors une réforme des retraites. Cette fois, l’exécutif ne prend pas les salariés par surprise et mise sur sa légitimité.
Cependant, le manque de base sociale du Président de la République pour instaurer un système par points est contesté. En effet, deux tiers des Français estiment que le mouvement du 5 décembre est justifié (+13% en un mois). Ils sont pourtant aussi nombreux à vouloir un alignement des régimes de retraite du public et du privé. Est-ce paradoxal ? Pas forcément. Nombreux sont ceux à rêver d’un alignement des régimes, mais par le haut !
Malek SMIDA
Condamnée en septembre 2018 à cesser d’employer des salariés dans ses établissements parisiens entre 21 heures et 6 heures du matin, la direction de Monoprix avait alors immédiatement conclu un nouvel accord d’entreprise pour échapper aux sanctions. Alors qu’un Monoprix sur deux est resté ouvert après 21 heures, la CGT a décidé de contester cet accord en justice.
Vendredi 29 novembre, le TGI de Nanterre a donné raison au syndicat et a interdit à l’enseigne d’employer des salariés après 21 heures, sous astreinte de 30 000 euros par infraction constatée.
Face aux obstacles que dresse le travail de nuit dans la vie personnelle des salariés, le droit du travail ne l’autorise dans les zones touristiques qu’à certaines conditions : rémunération double, compensation en heures de repos équivalente au temps travaillé, aide à la garde d’enfants et prise en charge du retour du salarié à son domicile. C’est sur ce dernier point que l’accord d’entreprise relatif au travail de nuit n’apportait pas de garanties suffisantes.
Par cette décision, le tribunal de Nanterre envoie un signal clair à la grande distribution, mais pas seulement. De peur d’ouvrir un nouveau front social avec les syndicats, le gouvernement a reporté le mois dernier un projet de loi prévoyant que le travail de nuit et ses contreparties ne soient plus comptabilisés à partir de 21 heures, mais à partir de minuit ! Dans l’intérêt des salariés et de leur santé, souhaitons que ce report soit définitif.
Malek SMIDA
Grève sauvage, action illégale, prise d’otage… Pendant des semaines, les cheminots ont été diabolisés dans les rédactions. Leur tort ? S’être retirés un jour et demi, à la suite d’une énième collision à un passage à niveau, d’une situation de travail dont ils pensaient qu’elle pouvait représenter une menace pour leur sécurité.
Consciente du danger que représentent en cas d’accident des TER voyageant sans contrôleur, la population estime majoritairement ce droit de retrait justifié (58%). C’est également l’avis de l’Inspection du travail des Hauts-de-France.
Dans un courrier adressé fin novembre à la direction régionale de la SNCF, l’Inspection du travail considère que « dans les circonstances actuelles, avec le risque de défaillance du système d’alarme radio, en cas de choc frontal et dans l’attente d’équipements complémentaires, les dispositions du Code du travail ne sont pas respectées lorsque le conducteur est le seul agent à bord du train ».
Par conséquent, les inspecteurs mettent en demeure la SNCF de réaffecter des contrôleurs dans les trains, pour éviter ainsi les « suraccidents ». La SNCF, qui a enlevé des contrôleurs pour faire des économies, conteste cette sommation auprès de la DIRECCTE.
Les détracteurs d’aujourd’hui teindront-ils la même position lorsque des commandants de bord, copilotes et personnels navigants, utiliseront leur droit de retrait pour refuser de monter à bord d’un Boeing 737 max si d’aventure ce modèle était remis trop rapidement sur le marché pour des raisons bassement financières ?
Olivier CADIC & Malek SMIDA
C’est une information qui tombe mal pour le gouvernement, à une semaine du début de la mobilisation contre la réforme des retraites. Dans une enquête dévoilée mardi 26 novembre, l’Institut de la protection sociale (IPS) anticipe d’importantes pertes pour les futurs retraités avec enfants, et plus particulièrement pour les femmes.
Actuellement, dans notre système de retraite par répartition, les parents bénéficient d’une double majoration.
L’instauration d’un système de retraite par points anéantira cette double majoration. Elle sera remplacée, pour chaque enfant et pour l’un des deux parents seulement, par une majoration de 5% des points acquis.
Présenté par l’exécutif comme favorable aux femmes, ce nouveau système s’avère finalement moins avantageux, aussi bien pour les mères célibataires que pour les familles nombreuses.
C’est ce que nous démontrent, ci-dessous, deux simulations de l’IPS.
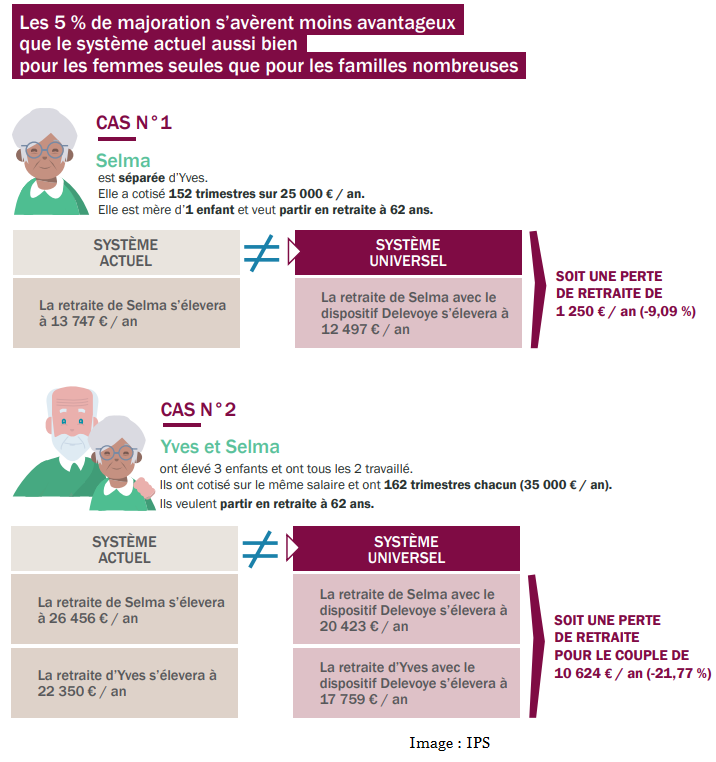
Si ces hypothèses sont confirmées, cette réforme provoquera un véritable séisme social pour des millions de salariés. La grève générale enrayera-t-elle cette catastrophe ?
Malek SMIDA
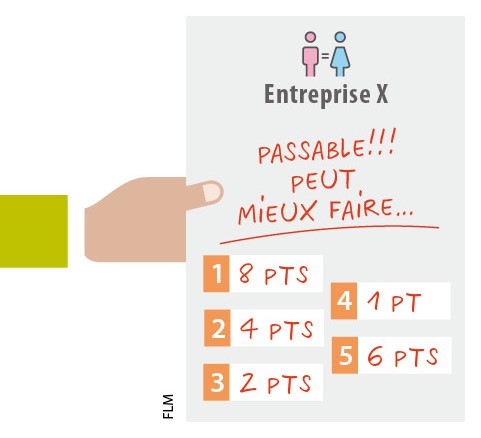
Dans une enquête publiée le 25 septembre dernier, la DARES se penche sur les difficultés rencontrées par les salarié.es pour concilier vie professionnelle et vie familiale.
A la question « Vos proches se plaignent-ils que vos horaires de travail vous rendent trop peu disponible pour eux ? » : 14% des hommes répondent par l’affirmative contre 13% des femmes. Ce résultat s’explique par le fait que les femmes sont quatre fois plus souvent à temps partiel que les hommes. En effet, le temps partiel limite les reproches des familles sur le manque de disponibilité des femmes. Si l’on repose cette question à des salariés à temps plein, l’écart s’inverse : 15% des femmes affirment subir des reproches contre 14% des hommes.
Aussi, lorsqu’est pris en compte l’ensemble des situations de travail, la probabilité de recevoir des reproches familiaux est environ 20 % plus élevée pour les femmes que pour les hommes.
Ces résultats mettent en lumière une persistance certaine des stéréotypes de genre. Selon la DARES, les femmes ont toujours la charge du travail domestique et des enfants tandis que les hommes seraient plus légitimes à s’investir dans leurs activités professionnelles.
Cette division des rôles sociaux permet donc aux hommes de subir moins de reproches lorsque leur travail déborde sur leur vie familiale. Il est grand temps d’abolir ce modèle patriarcal !
Malek SMIDA
Si Emmanuel Macron nous a assuré que l’âge de départ à la retraite à 62 ans était maintenu, l’introduction d’un âge pivot, en dessous duquel le montant des pensions fera l’objet d’un malus, aura pour conséquence, une fois de plus, un allongement de la durée de cotisation des salariés.
Pour justifier ce recul social, l’exécutif n’est pas allé chercher très loin et n’a fait que reprendre les éléments de langage de ses prédécesseurs. Les Français vivent plus longtemps, ils doivent donc travailler plus longtemps. CQFD.
En effet, selon l’INSEE, un homme cadre peut espérer vivre jusqu’à 84 ans, contre 77,6 ans pour un ouvrier. L’espérance de vie d’une cadre est de 88 ans, contre 84,8 pour une ouvrière. Si cet écart de classe reste inacceptable, notre espérance de vie augmente et c’est tant mieux !
Cependant, une donnée tout aussi importante stagne depuis plusieurs années, et a même reculé. Cette donnée, c’est l’espérance de vie sans incapacité, plus connue sous le nom d’espérance de vie en bonne santé.
Après n’avoir fait que grimper dans les années 90 et 2000, l’espérance de vie des hommes en bonne santé piétine depuis 2014 autour de 63 ans. Pour les femmes, cette espérance de vie a connu un recul historique l’année dernière en retombant à 64 ans et demi. Résultat : si la France se situe dans le peloton de tête européen en ce qui concerne l’espérance de vie « tout court », elle n’apparaît que dans la moyenne pour celle en « bonne santé ». La France est même tristement devancée par la Grèce et la Bulgarie et fait jeu égal avec la Pologne !
Ces reculs de l’espérance de vie en bonne santé interviennent au moment où, pour la première fois de notre Histoire sociale, une génération de travailleurs part plus tard à la retraite que la précédente. Simple coïncidence ? Peu probable. C’est justement parce que nous travaillons moins longtemps que nous vivons plus longtemps.
Malek SMIDA
Depuis jeudi, l’application mobile du Compte Personnel de Formation est disponible sur smartphone.
Les 25 millions de salariés et de demandeurs d’emploi dont le CPF est alimenté ont maintenant accès sur leur téléphone à 40 000 formations. La méthode est la suivante :
Ces étapes s’effectuent sans intermédiaire puisque depuis le 1er janvier, le CPF est crédité en euros et non plus en heures. Le Compte Personnel de Formation est crédité à hauteur de 500 euros par année travaillée dans la limite de 5 000 euros. Le compte des salariés non qualifiés peut quant à lui atteindre la somme de 8 000 euros ; ces salariés recevant 800 euros par an.
Si l’accès à la formation professionnelle est à encourager, force est de constater que la généralisation de ce type d’application participe malheureusement à « l’ubérisation » d’une société qui se déshumanise. Espérons qu’un service d’assistance efficace soit mis en place pour guider cette partie de la population qui ne possède pas ou qui maîtrise mal ces nouveaux outils.
Malek SMIDA
A partir du 5 novembre, comparativement aux hommes, les femmes travailleront gratuitement en France. Comment un tel écart salarial est-il possible en 2020 ? Analysons cette iniquité en nous basant sur 3 données présentées par l’Observatoire des inégalités.
Tous temps de travail confondus (temps partiels et temps complets réunis), les femmes touchent 25,7 % de moins que les hommes. Cet écart est révoltant mais reflète une triste réalité : les femmes sont quatre fois plus souvent à temps partiel que les hommes.
Les salaires en « équivalent temps plein » permettent de prendre en compte tous les emplois (temps partiels et temps complets) en imaginant ce que pourraient être les rémunérations à temps partiel si les emplois correspondants étaient à temps plein. Pour cela, l’Observatoire des inégalités transforme un salaire à temps partiel en déterminant à quel niveau il aurait été si l’emploi avait été à temps plein. Le salaire mensuel net moyen des hommes, en équivalent temps plein, est de 2 438 euros. Celui des femmes est de 1 986 euros, soit un écart de 452 euros. Les femmes perçoivent donc un salaire inférieur de 18,5 %.
Si l’on prend en compte les différences de tranches d’âge, de type de contrat, de temps de travail, de secteur d’activité et de taille d’entreprise, il reste un écart moyen de salaire entre les femmes et les hommes de 10,5 %. Il s’agit là purement et simplement d’une discrimination sexiste. Une femme est payée 10,5% de moins car elle est une femme.
Selon une étude de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, si les femmes étaient payées comme les hommes, la hausse des cotisations qui en découlerait permettrait de récupérer 5,5 milliards d’euros. Payer davantage les femmes pour partir à la retraite plus tôt, voilà un horizon enthousiasmant !
Malek SMIDA
En France, en 2019, des êtres humains gagnent 277 fois plus d’argent que d’autres êtres humains.
C’est ce que nous révèle une étude publiée le 6 novembre par la société de conseil Proxinvest : les PDG du CAC 40 gagnent en moyenne 277 fois le SMIC. Avec une moyenne annuelle de 6 millions d’euros, leur rémunération a grimpé de 12,4% en un an. C’est trois fois plus que celle des salariés de leurs groupes.
En 2014, ces dirigeants gagnaient en moyenne 73 fois plus que leurs salariés. Aujourd’hui, c’est 90 fois plus. Un record depuis la crise de 2008.
Sur ce cupide podium, on trouve :
Avant la loi Sapin II de 2016, les patrons du CAC 40 imposaient eux-mêmes à leur conseil d’administration le montant de leur rémunération. Depuis, les actionnaires disposent d’un droit de veto. Ces millions qui s’accumulent chaque année confirment malheureusement nos soupçons : nous ne pouvons pas compter sur les actionnaires pour limiter ces salaires.
Alors que la crise sanitaire a fait basculer dans la pauvreté un million de Français, d’autres nous promettent encore un imminent ruissellement. Ce dogme n’a jamais semblé aussi peu convaincant.
Malek SMIDA
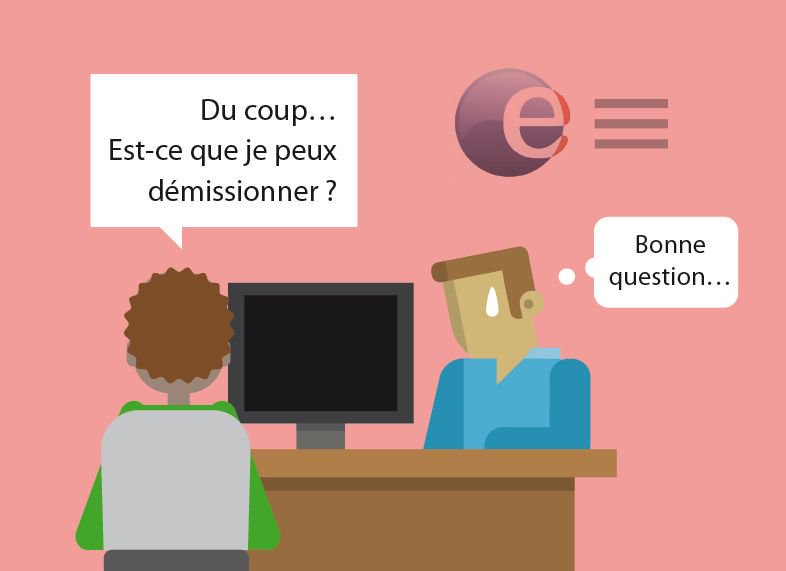
La loi « Avenir professionnel » avait prévu que dès le 1er janvier 2019 des salariés démissionnaires puissent toucher des allocations chômage. Avec un peu de retard, ce dispositif va enfin s’appliquer. Cependant, pour en bénéficier, le travailleur doit remplir des conditions drastiques.
L’article L.5422-1 du Code du travail réservait auparavant l’allocation chômage aux « travailleurs involontairement privés d’emploi » et excluait chaque année du régime d’assurance chômage le million de salariés démissionnaires. Ce même article modifié ouvre désormais le régime d’assurance chômage aux travailleurs dont la privation d’emploi volontaire résulte d’une démission. Selon le gouvernement, seuls 30 000 salariés par an seront concernés par cette indemnisation…
Ces travailleurs doivent répondre à des conditions d’activité antérieure spécifiques (au minimum 5 ans de travail dans l’entreprise) et poursuivre un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou un projet de création ou de reprise d’une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
Avant de présenter son projet à la commission paritaire, le salarié est dans l’obligation de solliciter un conseil sur la validité de son plan de carrière auprès des institutions, organismes ou opérateurs de conseil en évolution professionnelle. Le nouvel article L. 5422-1-1 du Code du travail dispose que le salarié établit avec le concours de l’institution, de l’organisme ou de l’opérateur, son projet de reconversion professionnelle (missions locales, association pour l’emploi des cadres, France compétences, organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées).
Avant de vous lancer dans un projet de reconversion professionnelle, nous vous conseillons de consulter la convention collective applicable à votre entreprise qui, parfois, peut prévoir une indemnité de départ en cas de démission. Votre convention collective vous indiquera également la durée du préavis de démission que vous devrez respecter.
Malek SMIDA
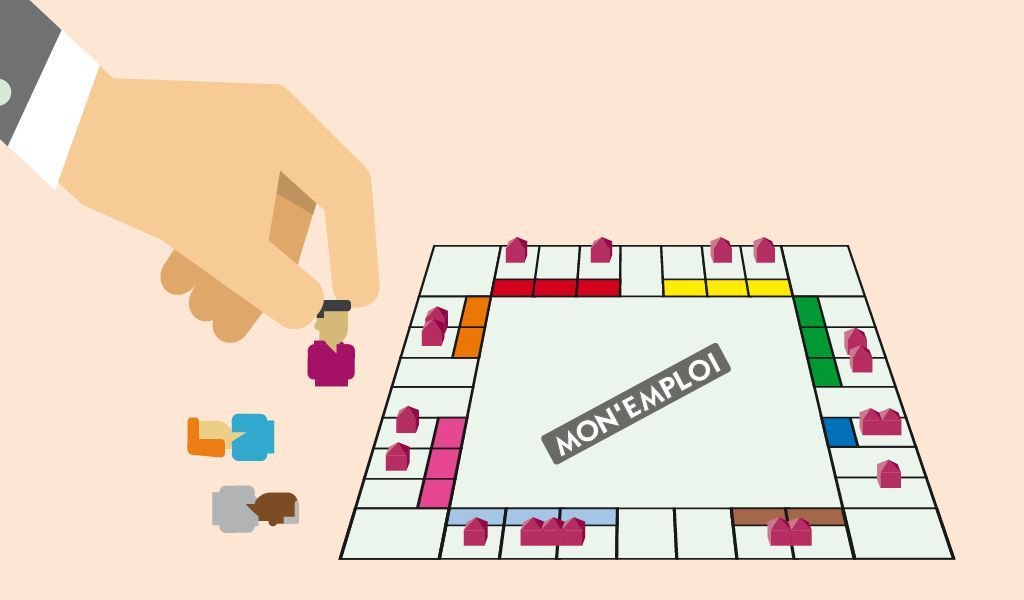
Acte 1, septembre 2018. Contraindre le demandeur d’emploi d’accepter des offres situées, aller-retour, à plus de deux heures de trajet de son domicile.
Acte 2, décembre 2018. Modifier par décret la définition du salaire antérieurement perçu. Le demandeur d’emploi doit accepter des offres dont la rémunération est largement inférieure à ce qu’il percevait précédemment.
Résultat : Hausse des radiations de la liste des demandeurs d’emploi. Baisse du chômage.
Acte 3, novembre 2019. Bouleverser les droits à indemnisation. Le chômeur doit avoir travaillé six mois sur les deux dernières années pour toucher des allocations (contre quatre mois jusqu’ici). Six mois, c’est également la durée qu’il faudra avoir retravaillé pour recharger ses droits au chômage (contre un mois auparavant). Six mois, c’est encore le délai à partir duquel les allocations chômage deviendront dégressives pour les cadres.
Acte 4, avril 2020. Calculer le montant de l’indemnisation non plus sur la base des salaires des jours travaillés dans le mois, mais sur celle des salaires de la période allant du début du premier contrat à la fin du dernier contrat de travail, y compris les jours non travaillés.
Résultat : 25% à 50% d’indemnités en moins pour plus d’un million de demandeurs d’emploi.
200 000 chômeurs privés d’allocations.
Malek SMIDA
Le budget de la Sécurité sociale, distinct de celui de l’Etat, est un héritage du Conseil National de la Résistance. L’idée étant que le budget de la Sécu est sanctuarisé : il est réservé à la protection sociale et à la santé. Alors que le budget de l’Etat est principalement financé par les impôts, celui de la Sécu repose à 80% sur les cotisations sociales (des prélèvements sur les salaires) et sur la CSG (des prélèvements sur les salaires, les retraites et sur d’autres revenus).
Afin de renforcer la séparation entre ces deux budgets, la loi « Veil » du 25 juillet 1994 oblige l’Etat à compenser intégralement sur son budget toute exonération nouvelle de cotisations sociales. En clair, si une décision politique provoque un manque à gagner pour la Sécurité sociale, ce manque doit être comblé par l’Etat.
En décembre 2018, au plus fort du mouvement des gilets jaunes, Emmanuel Macron annonce plusieurs mesures dites « sociales » dont l’anticipation de l’exonération des cotisations sur les heures supplémentaires ainsi que l’annulation de la hausse de la CSG sur les retraites inférieures à 2000 euros. Ces choix impactent directement le budget de la Sécurité sociale à hauteur de 2,7 milliards d’euros. La loi précitée oblige donc l’Etat à financer de telles mesures. Or, le gouvernement refuse de respecter cette obligation.
En effet, le 23 octobre dernier, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture l’article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 qui institutionnalise la non-compensation par l’État des réductions de recettes qu’il impose à la Sécu. Par conséquent, le coût de ces mesures « sociales » est supporté par le budget de la Sécurité sociale, creusant ainsi son déficit.
A terme, ce sont donc les salariés qui payeront ces mesures censées améliorer leur propre pouvoir d’achat ! En effet, ne l’oublions pas, la cotisation sociale est une part du salaire et c’est avec ces cotisations que la Sécu doit payer la note laissée par l’exécutif.
En analysant les choix opérés depuis un an pour le pouvoir d’achat (hausse de la prime d’activité, baisse des cotisations…), on se rend compte que la même logique domine : prendre dans une poche du salarié, pour en remettre un petit peu dans l’autre. Une veille technique conduisant à désorganiser et mettre volontairement dans le rouge un dispositif pour démontrer par la suite qu’il est nécessaire de réformer celui-ci.
Malek SMIDA et Olivier CADIC
Certains accords collectifs prévoient des dispositifs permettant d’apprécier et de mesurer les compétences acquises par un salarié dans le cadre de ses différents mandats de représentants du personnel.
C’était notamment le cas de l’accord de groupe BPCE conclu en 2016, qui prévoyait l’organisation par la DRH d’un entretien « croisé » avec le salarié représentant du personnel et un représentant de son organisation syndicale. Ce dernier, qui a pu suivre la progression syndicale du salarié tout au long de ses mandats, peut, de ce fait, apporter son regard sur l’appréciation des compétences acquises.
La question de la conformité de ce dispositif conventionnel à l’article L. 2141-5 du code du travail, relatif au principe de non-discrimination syndicale, a récemment été posée à la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 9 octobre 2019, la Cour admet la conformité de ce référentiel dont « l’objet est d’identifier ces compétences ainsi que leur degré d’acquisition dans le but de les intégrer au parcours professionnel du salarié » dès lors qu’il a été négocié, qu’il est facultatif pour l’intéressé, que les critères d’appréciation sont objectifs et pertinents et mis en œuvre par l’employeur dans le respect du principe de non-discrimination.
A notre sens, ce genre de dispositif est encourageant pour l’évolution professionnelle des représentants du personnel, même si la légitimité de la DRH pour apprécier ces compétences pose question. Le rapport de force susceptible d’exister entre direction et représentants du personnel, peut en effet rendre la tâche difficile pour la DRH, qui est tenue d’apprécier les compétences du salarié de manière « objective et pertinente ».
L’idée de l’entretien « tripartite » [ DRH + salarié + représentant de l’organisation syndicale à laquelle appartient le salarié] est intéressante et peut apporter un début de solution à cette problématique.
(Cass. Soc. 9 octobre 2019, n°18-13529)
Amélie KLAHR et Audrey LIOTE
Depuis cet été, le Géant Casino d’Angers décide de passer outre l’interdiction légale en ouvrant tous les dimanches après-midi, sans caissières. Pour payer leurs achats, les clients passent aux caisses automatiques ou utilisent une application sur leur smartphone. Pour les assister, l’hypermarché employait des hôtesses par l’intermédiaire d’un prestataire de service spécialisé dans l’évènementiel.
Le 17 octobre dernier, le TGI d’Angers a interdit à ce prestataire d’employer à nouveau des salariés pour orienter et aider les clients, sous peine d’une amende de 5 000 € par infraction constatée. De quoi mettre fin à la polémique : l’hypermarché Géant Casino allant bien-sûr en tirer les conclusions en renonçant à l’ouverture le dimanche après-midi. Et bien non !
En effet, l’enseigne a immédiatement annoncé que l’ouverture restait d’actualité, mais qu’elle supprimerait uniquement le personnel près des caisses. Seuls des vigiles seront présents dans le magasin. Et ce n’est pas tout ! Se sentant confortée dans cette pratique, la direction de Géant Casino a décidé d’étendre l’ouverture dominicale…
Alors que les hypermarchés de Gap et de Chaumont ont ouvert leurs portes dimanche 13 octobre après-midi, celui de Salon de Provence doit en faire de même ce dimanche. Suivra ensuite celui de Fontaine-lès-Dijon en novembre puis ceux de Limoges et du Puy-en-Velay.
Désormais, seul le législateur semble être en capacité d’endiguer cette contagion.
Malek SMIDA
Lundi 21 octobre, trois accords majoritaires ont été signés entre deux organisations syndicales et la direction de General Electric.
Approuvés à une large majorité, ces accords permettent le sauvetage de 307 emplois sur les 792 voués à disparaitre dans l’activité de turbines à gaz. De plus, ce compromis ouvre, dans un premier temps, les départs sur la seule base du volontariat. Les départs contraints, quant à eux, ne pourront intervenir qu’à la fin de l’année 2020, une fois que sera négocié un accord de gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC) ainsi qu’un projet industriel réinscrivant Belfort comme centre d’excellence mondial.
Atlantes est fier d’avoir accompagné des IRP et des OS dans ces négociations, et de l’avoir fait en partenariat avec le cabinet d’experts SECAFI.
Grève sauvage, action illégale, prise d’otage… Depuis une semaine, les superlatifs fleurissent sur les plateaux de télévision pour diaboliser le droit de retrait exercé vendredi par des centaines de cheminots à travers le pays.
Le 16 octobre dernier, une nouvelle fois, un train percute un camion à l’intersection d’un passage à niveau dans les Ardennes. Le bilan est important : 11 blessés dont le conducteur du TER qui a été contraint de secourir seul les passagers accidentés. Blessé à la jambe, ce cheminot a notamment dû marcher 1,5 km pour déposer des agrès de protection sur les voies. La faute à une réduction du nombre de contrôleurs à bord des trains.
En effet, comme dorénavant trois TER sur quatre, ce train voyageait en « équipement agent seul » (EAS), c’est-à-dire sans autre agent à bord que le conducteur. Apprenant le cauchemar vécu par leur collègue, les conducteurs ont alors immédiatement utilisé leur droit de retrait. Droit de retrait qui, contrairement au droit de grève à la SNCF, ne nécessite heureusement aucun préavis.
Commentant les complications qui s’en sont suivies dans les gares, la Ministre du travail a pris soin d’expliquer ce qu’est le droit de retrait… à sa manière ! Code du travail à l’appui, Muriel Penicaud affirme que pour cesser le travail, un salarié doit être confronté à un danger grave et imminent. Un point c’est tout.
Le droit de retrait n’est donc pas lié à l’existence réelle d’un "danger grave et imminent", mais à l’existence d’un "motif raisonnable de penser" que ce danger existe. Par conséquent, il faut que les salariés concernés aient pu raisonnablement penser qu’il y avait un risque. Et c’est justement ce que soulignent les syndicats : l’accident du 16 octobre prouve que ce danger existe et que les salariés ayant exercé leur droit pouvaient, sans exagérer, s’inquiéter de se retrouver dans la même situation que leur collègue. Rappelons qu’en France se trouvent 155 passages à niveaux dont la sécurisation est toujours classée prioritaire.
Ce droit de retrait était donc bien légal, et même souhaitable selon les inspecteurs du travail d’Alsace et de Champagne-Ardenne qui ont préconisé la suspension de la conduite des trains par un agent seul à bord.
Ayant finalement renoncé à engager des poursuites judiciaires contre les conducteurs, la direction de la SNCF annonce qu’elle opérera à la place des retenues sur salaire. Espérons que cet argent servira à remettre quelques contrôleurs dans les trains !
Malek SMIDA
Lors de ses traditionnels vœux aux Françaises et aux Français, François Hollande, lui aussi, usait de son « en même temps ».
Présentant son pacte de responsabilité le 31 décembre 2013, l’ancien Président de la République le résumait en ces termes : « moins de charges sur le travail, moins de contraintes sur leurs activités et, en même temps, une contrepartie, plus d’embauches et plus de dialogue social ». La facture de 46 milliards d’euros fut salée pour les contribuables qui, six ans plus tard, attendent toujours la contrepartie.
Publiée le mois dernier par la CFDT Banque Assurance, une étude vient remettre en question l’équation libérale baisse des cotisations patronales = emploi. En effet, selon trois cabinets d’experts - Syndex, Ethix et Sextant - ayant évalué les mesures du pacte de responsabilité dans le secteur financier, le « donnant-donnant » a surtout profité… aux actionnaires.
La CFDT Banque Assurance estime que les baisses de cotisations patronales du pacte ont permis au secteur financier d’économiser près de 14 milliards d’euros (10 milliards d’euros pour les banques et près de 4 milliards pour les assurances) entre 2014 et 2018. En contrepartie du pacte, le syndicat affirme que les entreprises du secteur bancaire n’ont respecté que 3 des 20 engagements auxquels elles avaient souscrits en 2014 : le volume global de recrutements, la part des femmes parmi les cadres et la définition d’un socle de compétences numériques. « Tous les autres ont été soit totalement ignorés, soit réalisés uniquement de manière partielle », souligne la CFDT.
Cependant, il y a un objectif que les banques n’ont pas ignoré : la hausse des dividendes versés aux actionnaires. Des dividendes qui, sur la même période, ont presque doublé dans le secteur bancaire.
Malek SMIDA
Soutenus par la CGT et son secrétaire général Philippe Martinez, près de 200 travailleurs.ses sans papiers étaient en grève fin 2019. Au bruit des sifflets et des tambours, ils ont occupé temporairement plusieurs sites en région parisienne (KFC, cinéma UGC, Léon de Bruxelles…). Bravant les risques d’une descente policière pouvant conduire à leur expulsion du territoire français, ces travailleurs dénoncent leurs conditions de travail indignes et demandent leurs régularisations ; ces dernières pouvant être obtenues avec le soutien de leurs employeurs.
En effet, pour être régularisé, le travailleur étranger doit apporter aux autorités la preuve d’une embauche ou d’une promesse d’embauche de son patron. Afin de pas être ensuite poursuivi pour travail illégal, l’employeur doit démontrer qu’il n’était pas au courant de la situation irrégulière dans laquelle se trouvait son salarié...
Dans leur communiqué, les travailleurs en grève estiment que les employeurs n’ont aucun intérêt à sortir du bois : « Aujourd’hui, nous sommes confrontés à un arbitraire préfectoral mais aussi à un arbitraire patronal. C’est à notre employeur de décider s’il soutiendra ou pas notre demande de régularisation. Quel intérêt aurait un employeur qui nous surexploite d’accompagner cette demande ? Aucun ! ».
On bosse ici, on vit ici, on reste ici ! C’est derrière ce slogan qu’une cinquantaine d’artistes affichent publiquement leur soutien à ces travailleurs de l’ombre : « Nous sommes solidaires de nos collègues, souvent invisibles dans les cuisines, sur les chantiers et dans le nettoyage, jusque dans les cinémas ou les théâtres qui diffusent notre travail, le nôtre, le leur. Nous sommes solidaires des collègues dans nos propres métiers qui peinent à obtenir leur titre de séjour, ou de visas pour répondre à des invitations pour des manifestations artistiques en France et en Europe. Nous sommes solidaires de celles et ceux qui luttent pour leurs droits. Nous sommes solidaires, contre ceux qui font des étrangers la source de tous les maux et qui instrumentalisent la peur, alors que cette lutte courageuse montre des femmes et des hommes simplement décidés à vivre dignement de leur travail et sans haine. »
Malek SMIDA
Découvrez ci-dessous les premiers signataires de cette tribune.
Gwen Aduh, metteur en scène ; Christophe Alévêque, humoriste ; Siegrid Alnoy, cinéaste ; Ariane Ascaride, actrice ; Josiane Balasko, actrice et cinéaste ; Luc Battiston, cinéaste ; Lucas Belvaux, acteur et cinéaste ; Julie Bertuccelli, cinéaste ; Dominique Blanc, actrice ; Pascale Breton, cinéaste ; Isabelle Broué, cinéaste ; Laurent Cantet, cinéaste ; Philippe Caubère, acteur ; Laurent Chevallier, cinéaste ; Hélier Cisterne, cinéaste ; Romain Cogitore, cinéaste ; Catherine Corsini, cinéaste ; Eva Darlan, actrice et autrice ; Emilie Deleuze, cinéaste ; Arnaud Desplechin, cinéaste ; Penda Diouf, actrice et auteur de théâtre ; Annie Duperey, autrice et actrice ; Annie Ernaux, écrivain ; Abbas Fahdel, cinéaste ; Emmanuel Finkiel, cinéaste ; Marina Foïs, actrice ; Dan Franck, écrivain ; Brahim Fritah, cinéaste ; Dominique Frot, actrice ; Nicolas Gabion, acteur ; Sylvain George, cinéaste ; Thomas Gilou, cinéaste ; Yann Gonzalez, cinéaste ; Romain Goupil, cinéaste ; Denis Gravouil, directeur de la photographie et syndicaliste ; Robert Guédiguian, cinéaste ; Alain Guiraudie, cinéaste ; Imhotep, musicien (IAM) ; Sam Karmann, acteur et cinéaste ; Héléna Klotz, cinéaste ; Serge Le Péron, cinéaste ; Vincent Le Texier, artiste lyrique ; Emily Loiseau, chanteuse ; Paul Marques Duarte, cinéaste ; Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT ; Corinne Masiero, actrice ; Valérie Massadian, cinéaste ; Patricia Mazuy, cinéaste ; Agnès Merlet, cinéaste ; Isa Mercure, actrice ; Guillaume Meurice, comédien ; Ariane Mnouchkine, metteuse en scène ; Dominik Moll, cinéaste ; Edouard Montoute, acteur ; François Morel, acteur, humoriste et auteur ; Valérie Osouf, cinéaste ; Nicolas Philibert, cinéaste ; Franck Pitiot, acteur ; Thomas Pitiot, chanteur ; Gilles Porte, cinéaste et directeur de la photographie ; Marilyne Poulain, responsable syndicale CGT ; Martin Provost, cinéaste ; Katell Quillévéré, cinéaste ; Aude Léa Rapin, cinéaste ; Robin Renucci, metteur en scène et acteur ; Vincent Rottiers, acteur ; Brigitte Rouan, actrice et cinéaste ; Christophe Ruggia, cinéaste ; Céline Sallette, actrice ; Sanseverino, chanteur ; Michel Scotto Di Carlo, acteur ; Florence Seyvos, écrivaine et scénariste ; Claire Simon, cinéaste ; Lucie Sorin, actrice et syndicaliste ; Pascal Tessaud, cinéaste ; Jean-Pierre Thorn, cinéaste ; Aurélien Vernhes-Lermusiaux, cinéaste.
Et voilà réouvert le débat sur les jours de carence pour les salarié-es du privé avec, en creux, les insinuations de fausses maladies.
S’appuyant sur une hausse de 15% du coût des arrêts de travail depuis 2010, la Cour des comptes pointe du doigt, dans un rapport publié le 8 octobre dernier, la responsabilité de médecins « surprescripteurs ». En cas d’arrêt maladie, les magistrats préconisent l’instauration d’un jour de carence obligatoire, c’est-à-dire non payé, à la charge exclusive des salariés.
Réintroduit par Emmanuel Macron depuis le 1er janvier 2018, ce jour de carence obligatoire et sans indemnité existe déjà dans la fonction publique. Dans le privé, ils sont au nombre de trois, mais des accords de branche ou d’entreprise les mettent souvent à la charge de l’employeur. La Cour des comptes ne veut plus entendre parler de cette prise en charge par les patrons qu’elle estime peu dissuasive. En effet, elle pousse un salarié malade... à ne pas aller travailler. C’est pourquoi la Cour souhaite imposer un jour de carence d’ordre public, non indemnisable, ni par la Sécu, ni par l’entreprise. Belle prise en compte du dialogue social.
Agnès Buzyn, ministre de la Santé, semble heureusement avoir fermé la porte à ce jour de carence d’ordre public. Mais jusqu’à quand ? Les pressions pour sa mise en place sont de plus en plus fortes.
Et si l’on améliorait les conditions de travail des salariés pour qu’ils tombent moins malades ? Et s’ils partaient en retraite le plus tôt possible ? Et si l’on arrêtait les horaires à rallonge, les cadences infernales, et les déplacements sans fin ? Et si le patronat avait vraiment à cœur de s’emparer de la problématique de la pénibilité ? Et si le CHSCT n’avait pas fait l’objet d’une mise à mort ? Et si la médecine pouvait faire correctement son travail ? Prendre le problème à l’envers et le combattre à la source, c’est peut-être ça, le plus dissuasif.
Olivier CADIC & Malek SMIDA

Promulgée le 22 mai 2019, la loi PACTE (plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) modifie les niveaux de seuils sociaux existants ainsi que la durée de prise en compte pour en apprécier le franchissement. Elle a également pour objectif de renforcer l’attractivité de l’épargne salariale.
S’agissant de l’épargne retraite, quelques changements sont à souligner :
Lina Abdelali
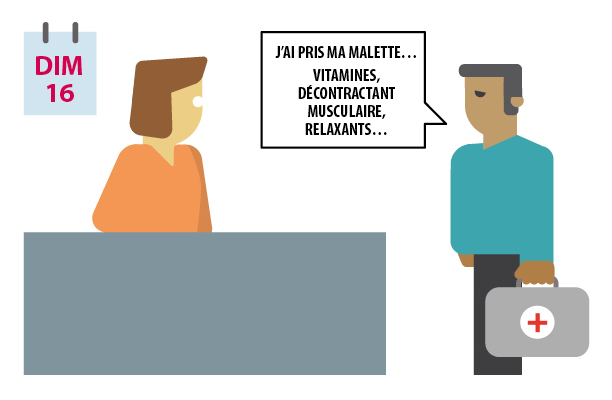
L’ouverture des hypermarchés le dimanche jusqu’à 13h ne suffit pas à la grande distribution, elle en veut encore plus.
Depuis le 25 août dernier, le Géant Casino d’Angers a décidé d’ouvrir tous les dimanches après-midi, mais sans caissières. Pour payer leurs achats, les clients passent aux caisses automatiques ou se servent d’une application sur smartphone. Pour les assister, l’hypermarché emploie quelques vigiles et hôtesses par l’intermédiaire d’un prestataire de service spécialisé dans l’évènementiel. C’est justement cette entreprise sous-traitante du Géant Casino d’Angers qui est assignée en référé par l’Inspection du travail pour « emploi illicite de salariés ».
S’appuyant sur la convention de branche de l’événementiel, ce prestataire affirme être dans son droit en mettant à disposition des salariés le dimanche après-midi. Si cet accord de branche autorise effectivement le travail le dimanche, celui-ci est réservé à des activités d’animation événementielle répond l’Inspection du travail, et non à une activité effectuée traditionnellement par les caissiers.
Hôtesses d’accueil ou caissières ? C’est donc à cette question que répondra le TGI d’Angers le 17 octobre prochain.
En décembre, nous nous inquiétions des conséquences du travail du dimanche sur la santé des travailleurs. En mai, nous nous sommes indignés du licenciement de deux salarié-es ayant refusé de travailler le dimanche. La grande distribution se décomplexe de jour en jour. Il est peut-être temps qu’elle craigne à nouveau la justice prud’homale.
Malek SMIDA

Publiée le mois dernier, une étude de la DARES sur l’exposition des salariés du privé aux risques professionnels a attiré notre attention.
Si la diminution du travail dit « répétitif » et du travail debout est encourageante, d’autres résultats sont plus inquiétants. En effet, cette enquête met en lumière une détérioration des conditions de travail dans plusieurs domaines :
L’exposition à des produits nocifs augmente dangereusement. Depuis 2010, davantage de salariés sont exposés à :
Ces résultats sont à mettre en parallèle avec de précédentes recherches de la DARES sur l’évolution des contraintes physiques au travail dans lesquelles, en vingt-cinq ans, a été constatée une hausse :
Sans surprise, les principales victimes de cette recrudescence de troubles physiques au travail sont les employés et les ouvriers.
Face à ces nombreux reculs, les membres du CSE ou des commissions SSCT ont besoin d’être correctement préparés pour éviter que, dans les entreprises, les conditions de travail ne disparaissent des préoccupations quotidiennes. Pour cela, Atlantes vous propose plusieurs formations en santé, sécurité et conditions de travail : https://www.atlantes.fr/-Vous-etes-un-elu-du-CHSCT-SSCT-
Malek SMIDA
Dans de nombreuses villes françaises, la plateforme de livraison de plats à domicile Deliveroo fait face à une importante contestation sociale menée par ses coursiers non-salariés.
Ces derniers manifestent depuis plusieurs semaines pour le retour d’un tarif minimum de leurs courses à vélo. En effet, les responsables de Deliveroo ont unilatéralement décidé de supprimer la rémunération minimale de 4,70 euros qu’ils versaient à chaque livraison effectuée par leurs coursiers. Dorénavant, la livraison de « courte » distance est rémunérée moins de 3 euros, ce qui entraîne une baisse de rémunération mensuelle de 30 à 50%. De quoi forcer les livreurs à pédaler encore plus vite et à prendre toujours plus de risques pour espérer grapiller quelques centimes supplémentaires.
Comble de la turpitude, la direction de Deliveroo a utilisé le système de géolocalisation de leur application afin d’identifier les coursiers grévistes et de dresser une liste noire des manifestants. Le mois dernier, la plateforme n’a pas hésité à radier l’un des meneurs du mouvement social.
Interrogé par Elise Lucet sur le sujet, le responsable de la communication de Deliveroo semble avoir un gros coup de pompe… Nous vous laissons apprécier sa réaction en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=9odCwtBDHMc
Malek SMIDA
Publié conjointement chaque année par l’Organisation Internationale du Travail et le Défenseur des droits, le Baromètre de la perception des discriminations dans l’emploi est consacré en 2019 à l’engagement syndical. Ses résultats en disent long sur les attaques que subissent quotidiennement les syndiqués en France.
En effet, parmi les salariés syndiqués, 46% estiment avoir été discriminés au cours de leur vie professionnelle, directement ou indirectement, en raison de leur appartenance syndicale.
Plus de la moitié des personnes exerçant ou ayant exercé une activité syndicale considèrent que cet engagement a représenté un frein dans leur évolution professionnelle (qualification, avancement, grade) et 44% d’entre elles affirment que cette activité a eu un impact négatif sur leur rémunération.
Parmi les syndiqués ayant voulu faire cesser la discrimination qu’ils subissaient, 44% d’entre eux ont ensuite fait l’objet de mesures de rétorsion (dégradation des conditions de travail, tentative de licenciement, harcèlement, mise à l’écart, sanction injustifiée…).
60% des personnes interrogées, titulaires d’un ou plusieurs mandats, déclarent que leur charge de travail n’a pas été adaptée suite à la prise de leur dernier mandat.
Enfin, l’engagement syndical est perçu pour l’ensemble de la population active comme un risque professionnel et la peur des représailles de la part de la direction est le facteur qui dissuade le plus les salariés de s’engager dans une activité syndicale (35%). Dans ces conditions, il est plus facile de comprendre pourquoi seuls 8 % de salariés sont adhérents à un syndicat, ce qui situe la France en fin de classement des pays développés.
Face à cette défiance générale vis-à-vis de l’engagement syndical, nous ne pouvions conclure cet article sans saluer tous.tes les syndicalistes qui, chaque jour, subissent de plein fouet ces discriminations et luttent courageusement contre cette répression antisyndicale.
Malek SMIDA
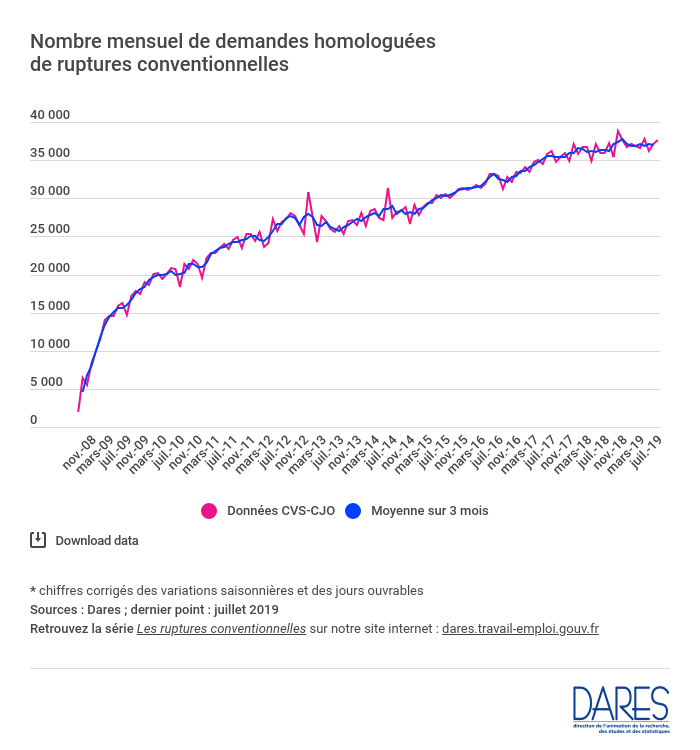
Introduite en 2008, la rupture conventionnelle permet à l’employeur et au salarié en CDI de convenir d’un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Une fois homologuée - ou validée - par l’inspection du travail, la rupture conventionnelle permet au salarié de bénéficier d’une indemnisation spécifique de rupture et lui donne droit aux allocations chômage.
Une étude de la DARES précise que 37 700 ruptures conventionnelles ont été signées pendant le mois de juillet 2019, soit une augmentation de 40 % au regard du nombre de ruptures conventionnelles conclues en juillet 2014.
Selon la DARES, plus de la moitié des ruptures conventionnelles sont signées par des employés et 60% des salariés signataires ont moins de 40 ans.
Notons également qu’en juillet dernier, 4,7 % des demandes de ruptures conventionnelles ont été refusées par l’administration pour des manquements aux prescriptions légales (tenue d’au moins un entretien, indemnité supérieure au minimum légal, respect du délai de rétractation de 15 jours calendaires…).
La hausse constante des ruptures conventionnelles peut s’expliquer par les politiques successives de flexibilisation de l’emploi. Le plafonnement des indemnités prud’homales, notamment, décourage de nombreux salariés à s’engager dans la voie contentieuse pour faire valoir leurs droits ; ces salariés préférant alors négocier à l’amiable leur départ à travers une rupture conventionnelle.
Atlantes a mis en ligne une pétition pour demander la fin du barème des indemnités prud’homales. Pour la signer, rdv sur : https://www.change.org/p/stop-au-bareme-des-indemnites-prud-homales
Atlantes peut également vous accompagner lors de la négociation de votre rupture conventionnelle afin que l’ensemble de vos droits soient respectés. Pour cela, contactez notre service au 01 56 53 65 05 ou par mail à l’adresse formation@atlantes.fr
Après avoir récemment élargi la réparation du préjudice d’anxiété à tous les travailleurs exposés à l’amiante, la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 septembre 2019, a décidé d’étendre l’indemnisation de ce préjudice à tous les salariés exposés à une substance toxique. Ce préjudice spécifique tient à l’inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’exposition à un produit toxique.
Dans son arrêt, la Cour du cassation précise « qu’en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ».
Cette importante décision permettra probablement une meilleure reconnaissance des maladies professionnelles et des préjudices d’anxiété qui en découlent. Selon un rapport de la Direction générale du travail, 10 % des salariés (soit 2,2 millions de travailleurs) ont été exposés à au moins un produit chimique cancérigène sur leur lieu de travail au cours de la dernière semaine travaillée.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1188_11_43553.html
Malek SMIDA

En France, un quart des salariés affirment avoir été victimes d’épuisement professionnel ou de harcèlement moral au travail. 1 femme sur 5 est confrontée à une situation de harcèlement sexuel et 1 femme sur 7 a déjà subi des attouchements ou tentatives d’attouchement au cours de sa vie professionnelle.
Ces chiffres alarmants nous ont conduits à vous proposer, à partir du mois d’octobre, une nouvelle formation d’une journée visant à prévenir et à lutter contre les situations de harcèlements et de violences au travail.
Dispensée par notre équipe de juristes et d’avocats, cette formation permettra aux élu-e-s du CSE, notamment aux référents harcèlement, d’accompagner les salariés dans la lutte contre le harcèlement et la violence au travail par une meilleure connaissance du dispositif légal et permettre ainsi une action efficace pour y mettre fin.
Découvrez l’ensemble du programme sur notre site : https://atlantes.fr/Harcelements-et-violences-au-travail
Depuis un an, les salariés des Agences nationales pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) sont dans le flou le plus total. Le 18 octobre 2018, la direction du principal opérateur public de formation professionnelle a annoncé la suppression de 1 541 postes en CDI sur les 6 500 que compte l’AFPA à travers le pays. 38 agences sont menacées de fermeture. Ce plan social vertigineux vise, selon la direction, à redresser un organisme miné par d’importantes difficultés économiques.
Face aux risques psycho-sociaux que représente ce plan social (un salarié de l’AFPA ayant malheureusement mis fin à ses jours), le tribunal de Bobigny a suspendu la mise en œuvre du projet de réorganisation de l’AFPA, jusqu’à ce que, selon l’ordonnance de référé du 27 juin 2019 :
En conséquence, l’AFPA a décidé cet été de retirer la demande d’homologation de son plan de réorganisation. La direction affirme qu’elle prendra en compte les injonctions du tribunal et qu’elle convoquera rapidement un nouveau comité central d’entreprise pour reprendre le chemin de l’homologation.
Malek SMIDA
Le salarié qui s’estime victime d’une inégalité de traitement notamment en matière de rémunération devra démontrer cette différence de traitement. En la matière, la jurisprudence avait limité la comparaison entre salariés qui demeurent dans l’effectif de l’entreprise (Cass. Soc., 16 septembre 2015, n°13-28415).
Dans cette affaire, les salariés victimes ont souhaité effectuer une comparaison avec des salariés dont le contrat avait été depuis transféré concernant des primes de panier, de trajet et de vacances. La Cour de Cassation est donc venue préciser que le fait que ces salariés « ne fassent plus partie des effectifs de l’entreprise ne saurait priver les intéressés du droit à percevoir un élément de rémunération qui leur est dû en application du principe d’égalité de traitement ».
Cass. Soc., 5 juin 2019, n°18-11.498 à 18-11516.
Maxence DEFRANCE
Vos instances CE, CHSCT et DP vont disparaitre au profit du CSE, au plus tard au 31 décembre 2019. Il est nécessaire de vous organiser dès à présent !
Le cabinet d’avocats ATLANTES, en collaboration avec votre expert-comptable, professionnel du conseil auprès des organisations syndicales et des représentants du personnel, vous accompagne dans cette phase qui engagera durablement la prochaine représentation du personnel.
Pour que cette instance unique de représentation des salariés soit adaptée et le plus efficace possible, il faudra pouvoir :
Avant vos élections professionnelles, pensez à utiliser votre congé de formation économique (5 jours par mandat). Aussi, le cabinet d’avocats Atlantes vous propose de suivre la formation « Le transfert du patrimoine vers le CSE ».
Dispensée par notre équipe de juristes et d’avocats, cette formation permettra aux élu-e-s de comprendre et d’appréhender les obligations et implications du transfert du patrimoine vers le CSE.
Pour découvrir le programme complet de la formation « Transfert du patrimoine vers le CSE », rdv sur notre site : https://atlantes.fr/Le-transfert-du-patrimoinevers-le-CSE
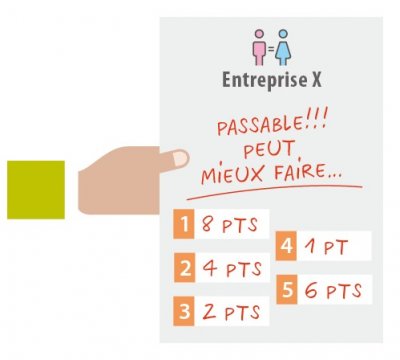
Pris en application de la loi « Avenir professionnel », le décret du 8 janvier 2019 a mis en place un index d’égalité femmes-hommes.
La loi « Avenir Professionnel » instaure désormais une obligation de résultat en matière d’égalité hommes-femmes. Par conséquent, cinq critères sont évalués par cet index :
Chaque année, les entreprises françaises de plus de 50 salariés doivent publier sur Internet le nombre de points qu’elles obtiennent à l’index. S’il est inférieur à 75 sur 100, elles auront trois années pour se mettre en conformité. Le 1er aout dernier, 8 % des entreprises de plus de 1000 salariés n’avaient toujours pas publié leurs résultats…
Parmi les entreprises de plus 1000 salariés ayant publié leurs données, seules quatre ont obtenu la note maximale ! Le ministère du travail refuse de transmettre leur identité.
La note moyenne pour ces grosses entreprises est de 83/100, à la limite de ce qui est donc « acceptable » selon l’index.
19% ont une note inférieure à 75 et doivent prendre des mesures immédiatement. Si le score de ces entreprises est toujours aussi faible dans trois ans, elles seront sanctionnées financièrement jusqu’à 1% de leur masse salariale.
Malek SMIDA
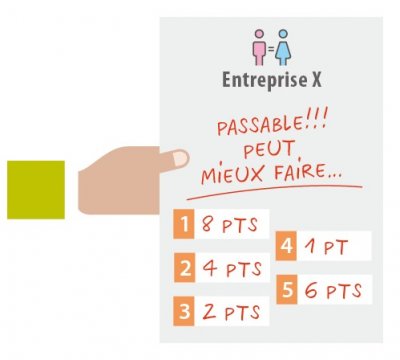
Comme nous avions pu l’étudier dans notre numéro de la plume de janvier dernier, les entreprises doivent désormais évaluer les pratiques en matière d’égalité salariale au regard d’indicateurs (écart de salaires, augmentation de salaires, nombre de femmes dans les plus hautes rémunérations, etc).
La note obtenue sur 100 devra être rendue publique sur le site de l’entreprise et transmise au CSE et à la DIRECCTE. Cette obligation concerne les entreprises d’au moins 1000 salariés depuis le 1er mars 2019 et s’applique à compter du 1er septembre 2019 pour les entreprises d’au moins 250 salariés. Elle sera ensuite étendue aux entreprises d’au moins 50 salariés au 1er mars 2020.
Pour accompagner les entreprises, le ministère du travail a publié un outil de calcul mais également un document questions-réponses : https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/questions-reponses-sur-le-calcul-de-l-index-de-l-egalite
Maxence DEFRANCE
La mesure avait été introduite par la LFSS (loi financement de la sécurité sociale) de 2019, et officialisée par décret en juin dernier.
Le 31 juillet, une circulaire de la CNAM est enfin venue préciser le régime du congé de paternité supplémentaire accordé en cas d’hospitalisation d’un nouveau-né.
Pour rappel, la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant est fixée à 11 jours calendaires consécutifs, ou à 18 jours en cas de naissances multiples.
Cette durée sera allongée dans la limite d’une durée maximale de 30 jours consécutifs en cas d’hospitalisation immédiate après la naissance du nouveau-né dans l’une des unités de soins spécialisée suivantes :
Voici les modalités principales du dispositif :
Anissa CHAGHAL
Références : c. trav. art. L. 1225-35 et D. 1225-8-1 ; arrêté du 24 juin 2019, JO du 25, Circ. CNAM 2019-25 du 31 juillet 2019 ; note d’information interministérielle DSS/2A 2019-125 du 27 juin 2019.
Abondamment commentée dans les médias ces derniers jours, la publication d’une étude réalisée par la société de gestion d’actifs Janus Henderson nous laisse une nouvelle fois sans voix.
« La France, de loin le plus grand payeur de dividendes en Europe, a vu ses dividendes totaux augmenter de 3.1%, ces derniers atteignant 51 milliards de dollars US au cours du deuxième trimestre, un nouveau record historique. Après ajustement des dividendes extraordinaires de Natixis et d’Engie, ainsi que l’affaiblissement des taux de change, la croissance sous-jacente de la France a été de 5.1%, ce qui est bien supérieur à la moyenne européenne … / … Les trois quarts des sociétés françaises de notre indice ont augmenté leurs dividendes par rapport au deuxième trimestre 2018, et seul EDF l’a réduit[i] ».
Cette étude nous permet de découvrir, qu’entre autres, SANOFI, TOTAL, KERING, VIVENDI ou encore BNP Paribas, se sont avérées particulièrement généreuses pour leurs actionnaires. Cela ne gêne toutefois pas cette dernière de vouloir supprimer 500 postes en France dans sa filiale de conservation de titres (BP2S) en procédant à un transfert de postes vers des pays à moindre coûts salariaux.
Et pendant ce temps-là, on continuera de nous faire croire que les employeurs vivent dans la crainte d’embaucher !
Et pendant ce temps, on continuera de nous agiter l’épouvantail de la récession afin de justifier les réformes de l’assurance chômage ou des retraites !
Et pendant ce temps, on laissera les conditions de travail se dégrader un peu plus !
Et pendant ce temps, on fermera les yeux sur les soutiers et les invisibles de l’économie !
Et pendant ce temps, on continuera à taxer le Code du travail de tous les maux !
Et pendant ce temps, on continuera à laisser croître la précarité et les salariés pauvres !
Et pendant ce temps, on ne pourra rien pour les entreprises qui vont mal !
A force de trop tirer sur l’élastique, laissant les inégalités sociales se creuser davantage, il ne faudra dès lors pas s’étonner que la colère gronde de nouveau.
Olivier CADIC
La loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé a récemment été publiée. Nous avons compilé les différentes mesures susceptibles d’intéresser les salariés.
La dématérialisation des arrêts de travail
Sauf exception, les arrêts de travail seront désormais prescrits de manière dématérialisée par l’intermédiaire d’un service mis à la disposition des professionnels de santé par les organismes d’assurance maladie.
Un arrêté devrait fixer au plus tard le 26 janvier 2020 la date d’entrée en vigueur de cette mesure, ainsi que les dérogations à cette règle.
Intégration du dossier médical en santé au travail dans le dossier médical partagé
Mis en place depuis bientôt 15 ans, le « DMP » (dossier médical partagé) sera bientôt alimenté par le dossier médical en santé au travail (entrée en vigueur le 1er juillet 2021).
Pour rappel, le « DMP » est un carnet de santé numérique qui conserve les informations de santé des assurés sociaux, et le dossier médical partagé retrace quant à lui les informations relatives à l’état de santé du travailleur. Il est créé par le médecin du travail.
De plus, le dossier médical en santé au travail sera accessible aux professionnels de santé, sauf opposition du salarié. Jusqu’alors, ce dossier ne pouvait être communiqué qu’à la demande du salarié et au médecin de son choix.
Elargissements de la gratuité des expertises ordonnées dans le cadre du contentieux technique de la sécurité sociale
La loi Santé a également élargi la prise en charge par la CNAM (caisse nationale de l’assurance maladie) des frais résultants des consultations et expertises ordonnées par le TGI à tous les litiges du contentieux technique.
Anissa CHAGHAL
Ces « travailleurs du clic » semblent invisibles mais seraient pourtant 260 000 en France, dont 15 000 très actifs. Leurs tâches sont enfantines, ennuyeuses et ne nécessitent qu’un simple ordinateur. Elles sont pourtant indispensables au développement de l’intelligence artificielle : effectuer une recherche sur internet, légender une image, remplir un questionnaire, trouver un chat sur une photo... Payées au lance-pierre, ces missions rencontrent malgré tout un franc succès.
Enregistrer des phrases en français pour entraîner des assistants conversationnels prend une minute et rapporte 20 centimes d’euro. Catégoriser des produits (DVD, électroménager) sur un site d’e-commerce prend quelques secondes pour 3 centimes. Rechercher des informations sur des individus (profils Twitter, Linkedin, adresses mail) nécessite environ 45 secondes, payées 15 centimes.
Selon une étude sur le micro-travail en France financée par Force Ouvrière, France Stratégie et le CNRS Paris-Saclay, le salaire horaire médian d’un micro-travailleur ne dépasse pas les 1,77 euro. Le travailleur du clic est avant tout une travailleuse (56%) en zone urbaine, entre 25 et 44 ans (63%) et est plus diplômée que la moyenne avec au minimum une licence en poche. 40% des personnes enquêtées sur la plateforme de micro-travail Foule Factory affirment avoir, en plus de leur travail du clic, un CDI et 71% d’entre elles travaillent à temps plein. Ces travailleurs consacrent en moyenne trois heures par semaine à leurs micro-tâches dans le but d’obtenir chaque mois une vingtaine d’euros en compléments de revenus.
Ni salariés, ni travailleurs ubérisés, ni indépendants, la plupart de ces nouveaux forçats du web ne sont pas déclarés, doivent signer des accords de confidentialité et sont soumis au bon vouloir des nouvelles plateformes numériques de micro-travail. Ces plateformes internationales opèrent dans l’ombre et ne se soucient guère des obligations légales et fiscales du droit du travail français.
Très précaire, ce marché du clic exploiterait aujourd’hui la force de travail de 213 millions de personnes à travers le monde. L’Organisation internationale du Travail (OIT) appelle depuis un an à une régulation urgente de cette pratique.
Malek SMIDA
Les principaux thèmes de la négociation d’entreprise en 2018
En tête des principaux thèmes de négociation, on retrouve celui de l’épargne salariale (14244 textes), suivi par les thèmes salaires et primes (12033 textes) ainsi que temps de travail (environ 10770 textes). Seuls 2424 accords ont été signés sur les conditions de travail et 2373 sur l’emploi. Les classifications et la formation, avec moins de 500 accords, arrivent en fin de classement.
Une année marquée par le CSE
En 2018, ce sont 5647 accords relatifs soit au CSE soit aux IRP qui ont été négociés. Un chiffre qui a plus que doublé par rapport à 2017. 78% de ces accords sont spécifiques au CSE et le ministère du travail précise à ce titre que la négociation s’est principalement portée sur la mise en place du CSE (PAP, vote électronique, etc).
On ne peut que regretter le manque de négociations relatives au fonctionnement et aux moyens du CSE.
Des nouveaux thèmes de négociation après les ordonnances de 2017
Issus des ordonnances dites « Macron », 124 accords de performance collective ont été conclus en 2018 ainsi que 60 accords relatifs à la rupture conventionnelle collective.
Vous pouvez retrouver le bilan en suivant le lien suivant : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/bnc_2018.pdf
Maxence DEFRANCE
En France, 1 femme sur 5 est confrontée à une situation de harcèlement sexuel et 1 femme sur 7 a déjà subi des attouchements ou tentatives d’attouchement au cours de sa vie professionnelle. Un quart des salariés ont déjà été victimes d’épuisement professionnel ou de harcèlement moral.
Il était plus que temps d’agir au niveau international !
Le 21 juin dernier, les membres de l’Organisation internationale du travail (représentants des travailleurs, des employeurs et des gouvernements des 187 Etats membres) ont adopté à une très large majorité la convention n° 190 visant à éliminer la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Seuls les représentants des employeurs de Singapour, de la Malaisie et des pays d’Amérique centrale ont voté contre.
Attendue depuis plusieurs années par le mouvement syndical mondial, cette première convention de l’OIT depuis 2011 a pour objectif principal de protéger les salariés victimes de violences sexistes et sexuelles. Prochaine étape : sa ratification par le Parlement français, qui devrait être effectuée rapidement selon Muriel Pénicaud, ministre du travail. Cependant, après la ratification de la convention, les travailleurs devront attendre douze mois pour l’invoquer en droit interne.
Dans la Plume de l’alouette de février, nous avions consacré deux articles à ces fléaux que sont le harcèlement moral et sexuel au travail. Découvrez nos analyses sur notre site : https://atlantes.fr/ANALYSE-ATLANTES-931 ; https://atlantes.fr/ANALYSE-ATLANTES-928
Découvrez le programme complet de cette formation sur notre site : https://atlantes.fr/Harcelements-et-violences-au-travail
Malek SMIDA
Le 22 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Grenoble a jugé le barème des indemnités prud’homales inconventionnel et a donc fait fi de l’avis de l’assemblée plénière de la Cour de cassation. Rendu quelques jours plus tôt, cet avis a validé le barème « Macron » en l’estimant conforme à l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT.
Dans cette affaire, une salariée d’une douzaine d’années d’ancienneté est licenciée pour motif disciplinaire. Contestant la faute qui lui est reprochée, elle saisit le conseil de prud’hommes de Grenoble et réclame à sa direction 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les juges entendent son argumentation. Ils considèrent que sa faute apparait insuffisamment démontrée et que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée. Son licenciement est donc jugé sans cause réelle et sérieuse.
Pour calculer le montant de l’indemnité due, les juges prennent en compte son ancienneté, son âge (55 ans) et la perte subie par la salariée du fait de ne plus pouvoir monter dans la hiérarchie de l’entreprise.
Considérant que l’avis rendu par la Cour de cassation ne constitue pas une décision de fond, le conseil de prud’hommes juge alors le barème contraire à la convention n° 158 de l’OIT en ce qu’il ne permet pas d’octroyer à la salariée injustement licenciée une indemnité adéquate au préjudice subi.
Les juges ont donc condamné l’employeur à verser 35 000 euros de dommages-intérêts à son ancienne salariée, soit 12 000 euros de plus que ce que permet le barème.
Ce jugement est d’autant plus important qu’il a été rendu en départage, c’est-à-dire en présence d’un juge professionnel.
Comme nous l’affirmions la semaine dernière, le combat n’est pas perdu ! Pour pousser la Cour de cassation à changer de position, continuons à afficher notre opposition à cette disposition socialement injuste. Signez et partagez massivement notre pétition : https://www.change.org/p/stop-au-bareme-des-indemnites-prud-homales
Malek SMIDA
Depuis l’arrêt de la CJUE du 14 mai 2019 obligeant les employeurs à mettre en place un système objectif, fiable et accessible pour mesurer la durée du temps de travail journalier de chaque travailleur, il est difficile de savoir si la législation française en la matière est conforme aux obligations européennes. La principe interrogation porte sur le forfait-jours.
En effet, cette spécificité française permet à l’employeur de contourner la durée légale du travail et de mettre en place des conventions individuelles avec des salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. (Article L.3121-58 du Code du travail).
En signant cette convention de forfait annuel en jours, le salarié accepte d’être rémunéré sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement. La durée prévue est donc comptabilisée en jours et non plus en heures.
Un tel système est intrinsèquement contraire à un décompte horaire du temps de travail et semble incompatible avec l’obligation européenne de l’employeur de mesurer le temps de travail journalier de ses salariés. Sa viabilité pourrait donc être menacée si la CJUE est un jour amenée à se prononcer spécifiquement sur la conformité du forfait-jours au regard de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE et des directives sur l’aménagement du temps de travail et sur l’amélioration de la santé des travailleurs.
Malek SMIDA
Saisie pour avis par le conseil de prud’hommes de Louviers, la Cour de cassation a validé ce mercredi le barème d’indemnités prud’homales en estimant que ce dispositif est conforme aux textes internationaux ratifiés par la France.
Considérant que les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne ne sont pas d’effet direct en droit français, la Cour s’est alors penchée sur l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT qui octroie aux salariés « le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée » en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Etonnamment, les magistrats n’ont pas vu dans le terme « adéquat » un synonyme du mot « adapté » mais au contraire, ont considéré qu’il offrait une marge d’appréciation aux Etats dans le montant de cette indemnité.
Selon eux, le fait que le juge soit contraint de verser à des salariés d’un an d’ancienneté une indemnité d’un montant minimal d’un mois de salaire brut et d’un montant maximal de deux mois n’est pas contraire à la Convention de l’OIT.
Pour défendre cette conventionnalité, la Cour de cassation a affirmé que le salarié avait toujours la possibilité d’être réintégré dans l’entreprise et que ce barème était écarté par le juge en cas de licenciement nul…
Quand bien même cette position ait été prise en assemblée plénière, rappelons tout de même qu’il ne s’agit que d’un avis et qu’il n’a donc pas la même portée qu’un arrêt de la Cour de cassation. Par conséquent, des cours d’appel pourront toujours juger ce barème inconventionnel et octroyer aux salariés des indemnités adéquates.
Le combat n’est donc pas perdu ! Nous sommes 1500 à avoir signé la pétition contre ce plafonnement. Continuons à la partager massivement : https://www.change.org/p/stop-au-bareme-des-indemnites-prud-homales
Malek SMIDA
Selon le ministère du travail, 142 accords de performance collective (APC) ont été signés ces dix-huit derniers mois. C’est dix fois plus que les accords de maintien de l’emploi conclus sous le quinquennat de François Hollande. Alors que les trois quarts de ces APC ont vu le jour dans des entreprises de moins de 250 salariés, des multinationales telles que Schneider Electric, PSA ou encore Generali n’ont pas hésité à utiliser ce nouvel outil issu des ordonnances « Macron » du 22 septembre 2017. Une bonne nouvelle ? Pas vraiment.
En principe, le contrat de travail prime sur l’accord collectif lorsqu’il est plus favorable. Avec l’accord de performance collective, ce n’est plus le cas. En effet, si l’APC est approuvé par des syndicats représentatifs dans l’entreprise ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives aux dernières élections du CSE, cet accord s’impose aux salariés quand bien même il diminuerait leurs salaires ou augmenterait leurs temps de travail sans aucune compensation.
A défaut, il est possible de recourir à un référendum si la ou les organisations signataires représentent plus de 30% des suffrages requis. L’article L.2232-12 du Code du travail précise que l’accord peut alors être validé s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Symbole de la flexibilité imposée aux travailleurs, cet accord de performance collective est le fruit de plusieurs dispositifs instaurés ces dernières années, avec plus ou moins de succès.
Avant 2013 étaient signés des accords de compétitivité, principalement dans des entreprises de la métallurgie, sans aucune codification.
Le 14 juin 2013, le Parlement adopte une loi instituant les accords de maintien de l’emploi. Pour mettre en place un tel accord, les patrons devaient justifier de graves difficultés économiques conjoncturelles. Ce fut un échec.
Ainsi, la loi « travail » du 8 août 2016 a créé les accords de préservation ou de développement de l’emploi. Cette nouvelle possibilité offerte aux entreprises n’aura pas pu être véritablement appliquée puisque l’accord de performance collective verra le jour un an plus tard.
Contrairement à l’accord de maintien de l’emploi, les directions n’ont plus à justifier de difficultés économiques pour proposer un APC. En effet, l’article L.2254-2 du Code du travail précise que l’accord de performance collective doit seulement répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise en vue de préserver ou de développer l’emploi. Succès garanti.
Pour faciliter encore plus le recours aux APC, les ordonnances « Macron » sont allées encore plus loin. Si un salarié refuse d’accepter les mesures prévues dans l’accord, la direction n’a même plus besoin de justifier d’un motif économique pour le licencier : le refus d’un salarié de se soumettre à l’APC constitue en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement !
En somme, si le salarié refuse une baisse de salaire, l’employeur est en capacité de le licencier sans difficulté. Aucune obligation de licencier les salariés non-signataires de l’accord ne pèse sur l‘employeur. Cependant, le climat social dans l’entreprise sera évidemment dégradé et des tensions apparaîtront entre les salariés ayant signé l’accord et ceux l’ayant refusé.
Le développement croissant des accords de performance collective s’explique également par le fait que certaines directions, après une fusion d’entreprises, harmonisent les statuts collectifs en négociant des APC sans que cela réponde précisément à la philosophie de l’ordonnance Macron.
Les partenaires de la négociation d’un APC sont les délégués syndicaux d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Cependant, dans les entreprises dont l’effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer un APC s’ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu’un seul salarié (art. L2232-24 CT).
Par conséquent, plus les salariés seront nombreux à se mobiliser au premier tour des élections du CSE et plus sera renforcée la légitimité des organisations syndicales en cas de négociation d’un accord de performance collective !
Malek SMIDA
Mais quelle mouche a bien pu piquer certains dirigeants du MEDEF ?
En décidant d’inviter à sa prochaine université d’été une ancienne députée d’un parti d’extrême droite, anti libéral, ce qui n’est pas vraiment l’ADN de l’organisation patronale, et qui il y a encore peu revendiquait une sortie de l’Europe, ils ont pour le moins lancé une passerelle pour rejoindre la rive nauséabonde du rubicond des valeurs.
Est-ce l’expérience de l’ancienne salariée qui collabora aux côtés de son papa qu’ils souhaitaient entendre ou est-ce la directrice d’école qui retenait leur attention ?
On nous soutient qu’il s’agissait ni plus ni moins que de mettre les populistes de tout poil « face à leurs contradictions économiques ».
Nul besoin de petits fours et d’obséquiosité pour dire tout le mal que l’on pense de l’extrême droite, y compris quant aux positions économiques de ses dirigeants. Heureusement que cette organisation syndicale compte encore dans ses rangs des personnes éclairées pour éviter que la peste brune ne gangrène insidieusement tous les rouages de la société. Nous leurs en sommes reconnaissants.
Olivier CADIC
La loi n°2019-486 du 22 mai 2019, dit loi PACTE a pour but de renforcer l’attractivité de l’épargne salariale.
Pour l’intéressement, il sera possible d’insérer de nouvelles thématiques dont l’atteinte d’objectifs pluriannuels.
De même des « projets multi entreprises » lors de la réalisation d’un projet commun à des entreprises distinctes, même hors d’un groupe, pourront être prévus dans un accord d’intéressement.
Attention : Elles devront mettre en commun une activité comme la réalisation d’un chantier. Reste à savoir quelles entreprises seront prêtes à faire intéressement commun et comment s’organisera en pratique la négociation d’un tel accord.
La loi PACTE a relevé le plafond individuel de l’intéressement qui est fixé aux trois-quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale (PASS).
Attention : le montant du PASS est revu chaque année (pour 2019, 3 PASS = 121 572€). Pour l’épargne salariale, il faut se baser sur celui qui entre en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.
Dans le cadre d’un accord de participation, il est toujours prévu la constitution de la réserve spéciale de participation (RSP). Si sa redistribution reste calculée en fonction du bénéfice net de l’entreprise, l’accord peur prévoir, sous conditions, un autre mode de calcul.
En outre, si la répartition de la participation est proportionnelle au salaire perçu, la base de calcul diminue de 4 à 3 PASS. Ceci doit permettre une répartition plus équitable selon la loi, d’où en ce sens, l’établissement demandé d’un rapport du Gouvernement au Parlement afin de mesurer la possibilité de réduire encore ce plafond à 2 PASS d’ici à 3 ans.
Pour les plans d’épargne, la loi renforce l’obligation d’information des salariés, notamment dans la mise en place d’une aide à la décision pour les choix de placement.
L’employeur aura deux nouvelles possibilités d’abondement du plan d’épargne entreprise, même en l’absence de contribution du salarié. Cette disposition a pour objectif de permettre le développement de l’actionnariat salarié. Contrairement à d’autres dispositions de la loi PACTE qui s’appliqueront automatiquement au 1er janvier 2020, en l’espèce, une adaptation des accords en cours avec l’employeur devra être envisagée.
Enfin, la loi PACTE encourage les branches à s’emparer de cette thématique notamment en négociant à leur niveau des accords d’intéressement ou de participation.
Emilie BOHL, Juriste ATLANTES Metz/Est
La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 dite loi « Pacte » (plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) a été publiée au journal officiel le 23 mai dernier.
Elle contient différentes mesures applicables en droit social liées notamment à l’épargne salariale ou l’actionnariat salarié. La loi revoit également certains seuils d’effectifs.
Ces dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2020.
Des nouveaux seuils applicables
Afin de rendre plus homogène les dispositifs en les centrant autour de 3 seuils : 11, 50 et 250 salariés.
Ainsi, le seuil passe de 20 à 50 salariés notamment pour :
Un gel sur 5 ans des effets de seuil
Outre les dispositifs d’application immédiate, un certain nombre de dispositifs retardent les effets du dépassement d’un certain seuil en reportant l’obligation à une date ultérieure ou oblige à dépasser ce seuil sur une certaine durée : prérogatives économiques, emploi de travailleurs handicapés, participation à l’effort de construction, etc.
Avec l’objectif annoncé de réduire les effets de seuils, le dispositif généralisé prévoit donc dans la majeure partie des cas que le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque celui-ci a été atteint ou dépassé pendant 5 ans.
A noter toutefois que la majeure partie des dispositions étaient applicables de façon immédiate ou après 3 ans. Un grand nombre de seuils risquent donc d’être plus difficiles à atteindre.
Les règles de décompte du code de la sécurité sociale
Droit du travail et droit de la sécurité sociale avaient des modalités de décompte différentes. Le droit du travail reprendra dans un certain nombre de cas les modalités de décompte de la sécurité sociale : l’effectif annuel moyen de l’année n-1. Concernant les personnels à prendre en compte, un décret est attendu sur le sujet.
Maxence DEFRANCE, Juriste ATLANTES
L’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne pose deux principes :
La directives 2003/88/C.E. du 4 novembre 2003 sur l’aménagement du temps de travail et la directive 89/391/C.E.E. du 12 juin 1989 sur l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs complètent l’arsenal juridique de l’Union Européenne en la matière. Ces directives, lues à la lumière de la Charte, protègent les salariés des Etats-membres contre des heures supplémentaires non payées ou contre des charges de travail si volumineuses qu’elles empêchent le respect des temps de repos.
Saisie d’une question préjudicielle par une juridiction espagnole, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a eu l’occasion d’interpréter les directives de l’UE sur le temps de travail et sur la santé ainsi que la Charte des droits fondamentaux. La question était la suivante : les employeurs ont-ils l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par leurs salariés ?
Dans un arrêt du 14 mai 2019, la CJUE rappelle tout d’abord que le travailleur doit être considéré comme la partie faible dans la relation de travail, de telle sorte qu’il est nécessaire d’empêcher que l’employeur lui impose une restriction de ses droits. Elle réaffirme « l’importance du droit fondamental de chaque salarié à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire ». Selon la Cour, « ces directives, lues à la lumière de la Charte, s’opposent à une réglementation qui, selon l’interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n’impose pas aux employeurs l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. »
La Cour de Luxembourg ajoute que pour « assurer l’effet utile des droits conférés par la directive sur le temps de travail et par la Charte, les États membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. »
Les droits fondamentaux des salariés à la santé et au repos semblent être devenus les meilleures armes pour faire respecter les durées légales de travail.
Malek SMIDA
La loi du 23 décembre 1998 permet aux salariés ayant été particulièrement exposés à l’amiante de bénéficier d’un départ à la retraite anticipé, même s’ils n’ont pas développé de maladie professionnelle liée à cette exposition.
C’est en se fondant sur cette loi que la Cour de cassation a admis le 11 mai 2010, pour les salariés ayant travaillé dans l’un des établissements mentionnés par arrêté ministériel, la réparation d’un préjudice d’anxiété lié à l’amiante. Ce préjudice spécifique tient à l’inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante. Pour être indemnisé, il n’est pas demandé aux salariés concernés de prouver la réalité de l’anxiété ressentie.
En revanche, la chambre sociale avait exclu de cette réparation les salariés exposés à l’amiante ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ou dont l’employeur n’était pas inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel. Ce 5 avril 2019, l’Assemblée plénière a enfin modifié sa position.
Il est désormais possible pour un salarié justifiant d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, d’agir contre son employeur sur le fondement de son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés par arrêté.
Espérons que ce revirement de jurisprudence permettra à des salariés injustement exposés à ce matériau nocif de bénéficier d’une réparation à la hauteur du scandale sanitaire que l’amiante a provoqué.
Malek SMIDA
Comme vous le savez, notre cabinet est dédié à la défense des intérêts des salariés, des institutions représentatives du personnel et des organisations syndicales. Nous offrons une assistance en continu associant formation, assistance juridique et conseil, contentieux individuel et collectif.
Nous sommes composés d’une quarantaine de collaborateurs avocats, de juristes et salariés.
Nous recherchons un-e juriste spécialisé-e en droit du travail, justifiant d’au moins 5 ans d’expérience dans le domaine des relations sociales et disponible immédiatement pour travailler dans notre cabinet situé à Paris (13ème).
Salaire : 38 à 41K€ brut selon votre profil.
Si vous êtes intéressé-e, merci de nous adresser votre CV et votre lettre de motivation à RH@atlantes.fr
Merci de partager cette actualité pour nous aider à trouver un juriste prêt à défendre les salariés !
Dans cette affaire, une société basée en Haute-Savoie est rachetée par un groupe dont le siège social est situé en région parisienne. La direction du groupe annonce aux élus du comité d’entreprise que désormais les réunions du CE n’auront plus lieu en Haute-Savoie mais au siège social du groupe.
Malgré la prise en charge des frais de déplacement par leur employeur, les membres du CE refusent de parcourir ces 1200 km aller-retour. Ils assignent alors le groupe en justice aux fins de voir ordonner à l’employeur d’organiser à nouveau les réunions du comité sur leur site d’origine.
Dans un arrêt du 3 avril 2019, la Cour de cassation donne raison aux salariés. Bien que le choix du lieu des réunions du comité soit une prérogative de l’employeur, ce choix ne peut être abusif.
Pour la chambre sociale, le fait « qu’aucun salarié de la société rachetée ne travaille en région parisienne, que le temps de transport pour s’y rendre est particulièrement élevé et de nature à décourager les vocations des candidats à l’élection, que ce choix est de nature à avoir des incidences sur la qualité des délibérations à prendre par le comité d’entreprise et que des solutions alternatives n’avaient pas été véritablement recherchées » sont des éléments qui constituent un abus de la part de l’employeur.
Il ne fait guère de doute que cette solution est transposable aux réunions du CSE.
Malek SMIDA
La DARES a récemment publié une étude statistique sur l’emploi intérimaire.
En mars 2015, il y avait en France 562 000 travailleurs intérimaires. Ils sont aujourd’hui 802 000, soit une hausse de 43% en quatre ans !
Alors que sur l’ensemble des salariés, tous contrats confondus, seul un cinquième travaille dans l’industrie et dans la construction, ce secteur continue de recourir massivement aux contrats d’intérim. En effet, en 2019, 60% des intérimaires sont embauchés dans le secteur secondaire.
Un bonus-malus sur les contrats courts va-t-il enfin voir le jour ?
Malek SMIDA
Dans un arrêt du 3 avril 2019, la Cour de cassation a affirmé qu’à compter de l’annulation de son mandat, un délégué syndical reste tout de même protégé pendant 12 mois, s’il a exercé ces fonctions pendant au moins un an. La nullité de la désignation du mandat syndical n’est donc pas rétroactive.
Pour rappel, le principal effet de la nullité, c’est la rétroactivité. Par rétroactivité il faut entendre que l’acte est censé n’avoir jamais existé.
La question était de savoir si, en cas d’annulation du mandat syndical par le juge, l’employeur était tenu d’obtenir l’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail. La Cour de cassation a donc répondu par l’affirmative, à condition que le délégué syndical ait exercé ces fonctions au moins un an avant l’annulation de son mandat. Le délégué syndical reste protégé pendant 12 mois à compter de la décision d’annulation.
Cette décision fait écho à une décision antérieure concernant l’annulation des élections professionnelles des membres du Comité d’Entreprise : dans cette affaire, ces salariés devaient bénéficier de la protection pendant 6 mois à compter de l’annulation de leur mandat (Cass. soc., 2 déc. 2008, n°07-41.832). Il convient, à notre sens, d’appliquer ce même principe à tous les représentants du personnel qui se voient attribuer une protection par le Code du travail, y compris dans le cadre du Comité Social et Economique.
Marine AZAIS
Juriste Atlantes
La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi « Macron », a apporté de nouvelles dérogations au repos dominical, notamment dans le commerce de détail alimentaire qui a désormais l’autorisation d’ouvrir le dimanche jusqu’à 13h. L’accord du salarié peut être nécessaire lorsqu’une nouvelle répartition de l’horaire de travail, qui a pour effet de priver le salarié de son repos dominical, constitue une modification de son contrat de travail.
Ce n’est pas l’avis de la direction du Cora de St-Malo qui n’a pas hésité à licencier deux salariés ayant refusé de travailler un dimanche. Dans sa lettre de licenciement, la direction expose son motif : “Le Code du travail prévoit que vous devez accepter de travailler quand on vous le demande”.
Cette décision est contestable. En effet, aucune mention de travail dominical ne figurerait dans leur contrat de travail. De plus, il n’y aurait eu aucun avenant aux contrats de travail de l’ensemble des 200 salariés lorsque la direction a décidé l’année dernière d’ouvrir son magasin tous les dimanches matin.
L’une des deux salariés, licenciée après 18 années d’ancienneté, envisage d’attaquer son employeur devant le conseil de prud’hommes. Ce jeudi 23 mai 2019, le ministère du Travail a demandé à l’inspection du travail de procéder à « l’analyse juridique » de la situation. Espérons que l’inspection du travail réaffirmera le droit des salariés à un repos dominical.
En décembre, nous nous inquiétions des conséquences du travail du dimanche sur la santé des salariés. Malheureusement, ces deux licenciements renforcent nos inquiétudes. Les pressions exercées à l’encontre des salariés refusant d’abandonner leur repos dominical semblent être de plus en plus fortes.
Cette affaire illustre combien le discours ambiant vantant les mérites d’un dialogue social vertueux ou d’une meilleure articulation entre la vie privée et la vie professionnelle paraît en complet décalage avec la réalité. Le nouveau crédo d’un patronat totalement décomplexé, se moquant des conséquences judiciaires de ses actes, tant le contentieux prud’homal est devenu prévisible, se résume donc désormais à : « Travailler plus ou licencier plus ».
Nous avions cru comprendre qu’en sécurisant les procédures auprès des conseils de prud’hommes cela permettrait au patronat d’embaucher plus sereinement. C’est l’inverse qui se produit et ce n’est hélas guère surprenant puisque les lois iniques produisent toujours des effets délétères.
C’est notamment pour cela qu’il faut impérativement s’unir pour demander la suppression du barème des indemnités prud’homales et un changement de politique sociale.
Olivier CADIC et Malek SMIDA
Depuis des mois, c’est le sujet qui empoisonne les négociations entre partenaires sociaux sur l’assurance-chômage.
Lundi 29 avril, Muriel Pénicaud a annoncé que le gouvernement instaurera cet été, par décret, un système de bonus-malus sur les contrats courts. Ce mécanisme augmenterait les cotisations à l’assurance-chômage des entreprises où le personnel tourne trop.
Sans surprise, le MEDEF s’oppose à ce bonus-malus qui selon lui va « détruire des CDD et des emplois intérim sans pour autant créer de CDI ». Rappelons tout de même qu’en 20 ans, le nombre de CDD de moins d’un mois a été multiplié par 2,5.
L’inflation des contrats courts a créé, en France comme en Allemagne, un marché du travail précaire, où de nombreux salariés alternent entre des périodes au chômage et des courtes périodes d’emploi.
Nous vous tiendrons informés cet été de la publication -ou non- de ce décret attendu aussi bien par les organisations syndicales que par des milliers de salariés précaires.
Malek SMIDA
Mardi 14 mai, les syndicats Force Ouvrière et CFE-CGC, qui représentent plus de 50% du personnel de Carrefour, ont annoncé qu’ils allaient signer le projet de rupture conventionnelle collective (RCC) négocié avec la direction.
Issue des ordonnances « Macron » du 22 septembre 2017, la rupture conventionnelle collective permet, en application d’un accord collectif négocié avec les syndicats, de rompre des contrats de travail d’un commun accord entre les salariés et leur employeur, ce dernier n’ayant aucun motif à exposer. Une fois approuvée par accord collectif puis validée par la DIRECCTE, la RCC donne donc à l’employeur la possibilité de supprimer des postes sans mettre en place de plan de sauvegarde de l’emploi ; le salarié bénéficiant quant à lui d’une indemnité légale de rupture conventionnelle et des allocations chômage, voire d’autres mesures et/ou montants négociés dans le cadre de l’accord.
Le développement de ces ruptures conventionnelles, individuelles et collectives, semble être l’une des principales causes de la baisse du contentieux prud’homal. Après PSA, IBM et la Société Générale, c’est désormais au tour de Carrefour de plébisciter ce mode de rupture « à l’amiable ».
Le plan de restructuration présenté par le géant de la grande distribution prévoit désormais 3000 départs dont 1231 suppressions de postes. C’est plus du double de ce qui était initialement annoncé. À la rupture conventionnelle collective, s’ajoutent également des centaines de départs en préretraite.
La CGT et la CFDT ont refusé de signer ce projet. Selon la CGT, ces réductions de postes dans 46 hypermarchés ont pour objectif d’accentuer l’automatisation des entrepôts et des caisses. La CFDT estime quant à elle que l’ouverture de départs volontaires alors que des métiers sont supprimés dans la bijouterie et l’électroménager « met ces salariés dans des situations intenables ». De plus, la phase de volontariat proposée aux salariés est jugée trop courte pour construire un projet professionnel ou pour obtenir un reclassement.
En effet, les salariés volontaires ont jusqu’à la fin de l’année pour se manifester auprès du groupe. L’accord stipule qu’aucun départ contraint ne pourra avoir lieu à l’issue de cette phase de volontariat, entre le 31 décembre 2019 et fin 2020. Doit-on donc penser que, passé ce délai, des départs seront contraints ?
Malek SMIDA
La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et le décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 sont venus compléter le dispositif existant en matière de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes : référent d’entreprise, référent du CSE et affichages des textes (voir notre article dans la plume de février).
L’inspection du travail a diffusé le 8 mars dernier un guide pour appréhender au mieux les problématiques tant d’un point de vue juridique que pratique du harcèlement sexuel et des agissements sexistes au travail.
Aussi bien à destination des salariés que des employeurs, le guide rappelle notamment :
Ces nouvelles obligations peuvent être l’occasion d’échanger avec la direction sur un dispositif adapté à l’entreprise pour se prémunir au mieux du harcèlement.
Il sera également opportun, dans le silence des textes, de définir les missions qui pourraient être attribuées au référent du CSE en la matière. La mise en place du CSE et l’élaboration du règlement intérieur peuvent être l’occasion de définir ses missions.
Retrouvez le guide pratique et juridique en cliquant ici.
Maxence DEFRANCE
Juriste Atlantes
La loi du 5 septembre 2018 « Avenir professionnel » met en place une obligation de publication annuelle d’indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer.
Chaque entreprise de plus de 50 salariés se verra attribuer un score sur la base de ces indicateurs. Dès lors que ce score est inférieur à 75 points, l’entreprise disposera d’un délai de 3 ans pour se mettre en conformité. Si à l’expiration de ce délai l’obligation n’est toujours pas remplie, une pénalité financière pouvant aller jusqu’à 1% de la masse salariale pourra être appliquée.
En outre, depuis un décret en date du 29 avril 2019, s’il est constaté par l’agent de contrôle de l’inspection du travail que l’entreprise n’a pas publié ces informations pendant une ou plusieurs années consécutives, ou n’a pas défini de mesures de correction permettant d’améliorer son score, l’employeur sera mis en demeure de remédier à la situation dans un délai d’1 mois minimum. Ce délai est fixé en fonction de la nature du manquement et de la situation relevée dans l’entreprise (article R.2242-3 code du travail).
Si l’employeur n’agit pas à l’issue de ce délai, il se verra appliquer cette pénalité pouvant atteindre jusqu’à 1% de la masse salariale. Le montant de cette pénalité est fixé par l’inspection du travail en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle et salariale, ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect de l’obligation de publication des indicateurs prévus.
Lina ABDELALI
Une étude de la DARES du 20 mars 2019 nous apporte des éléments intéressants sur la durée individuelle de travail des salariés en France.
En 1990, un salarié à temps complet travaillait 39,6 heures par semaine contre 39,1 heures en 2018, soit une baisse de trente minutes.
Les lois « Aubry » de 1998 et 2000 diminuant la durée légale de travail à 35 heures n’ont pas interdit le recours aux heures supplémentaires mais les ont découragées en les majorants. En 2002, le temps de travail réel des salariés était de 37,7 heures par semaine. Or, depuis, le recours aux heures supplémentaires facilité n’a fait qu’augmenter la durée hebdomadaire de travail des salariés.
Contrairement aux idées reçues, en France les salariés ne travaillent pas moins que chez leurs voisins. Avec 34,9 heures de travail par semaine (temps partiel et temps complet réunis), Eurostat situe la France dans la moyenne de la zone Euro.
Malek SMIDA
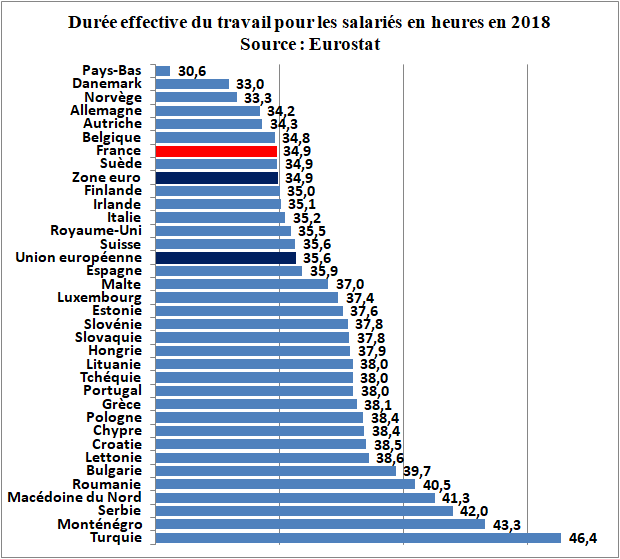
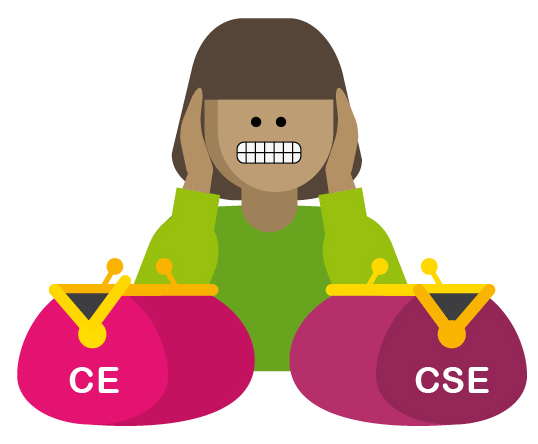
L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d’entreprise, des comités d’établissement, des comités centraux entreprises, des délégations uniques du personnel, des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l’article L. 2391-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, existant à la date de publication de la présente ordonnance sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques prévus au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019.
Lors de leur dernière réunion, les instances mentionnées au premier alinéa décident de l’affectation des biens de toute nature dont elles disposent à destination du futur comité social et économique et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. Lors de sa première réunion, le comité social et économique décide, à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues par les instances mentionnées au premier alinéa lors de leur dernière réunion, soit de décider d’affectations différentes. Les transferts de biens meubles ou immeubles prévus au présent article ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l’Etat ni à perception de droits ou de taxes.
Le 27 mars 2017, l’Assemblée nationale a adopté la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. Les entreprises de plus de 5000 salariés ont désormais l’obligation d’identifier et de prévenir les atteintes aux libertés fondamentales, à la santé, à la sécurité des personnes ainsi qu’à l’environnement, qui résultent non seulement de leurs propres activités, mais aussi de celles de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale établie, en France et dans le monde.
A l’issue de la première année d’application de cette loi, des ONG membres du Réseau citoyen pour la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) présentent un rapport dans lequel elles ont étudié 80 plans de vigilance publiés entre mars et décembre 2018. Leurs résultats sont préoccupants.
Ces ONG constatent que les objectifs de la loi ne sont que très partiellement pris en compte. Chaque entreprise a appliqué la loi avec des niveaux d’exigence disparates. La plupart des plans de vigilance sont très centrés sur les risques pour les sociétés et leurs investisseurs, et non sur les risques pour les tiers ou l’environnement...
Pire, malgré l’obligation légale, certaines entreprises telles que Lactalis, Crédit agricole, Zara ou encore H&M n’ont toujours pas publié de plan de vigilance !
Constatant les insuffisances de cette loi, ces ONG demandent notamment au gouvernement :
Malek SMIDA
Petit tour d’horizon de ces éventuelles nouveautés à venir...
Le projet de loi Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises (PACTE) : qui prévoit une simplification de la création d’entreprise et de la vie des PME et des ETI, une réforme de l’épargne salariale et du plan d’épargne retraite, une modification du régime du Volontariat International en Entreprise (VIE). On relève que le projet vise également à harmoniser le mode de calcul des effectifs en entreprise, ainsi que les effets des seuils. Cela devrait avoir un impact notamment sur la mise en place de représentants du personnel.
Le projet de loi d’orientation des mobilités (LOM) : qui envisage de mettre en place des mesures incitatives de transition vers des modes de déplacements vertueux, afin de sortir de la dépendance automobile ; ainsi que d’augmenter la protection des travailleurs indépendants en sécurisant les plateformes numériques sur lesquelles ils trouvent des clients.
Négociation sur la notion de « cadres » par les partenaires sociaux : qui est rendue nécessaire suite à la fusion AGIRC-ARRCO.
Négociation sur l’assurance chômage : qui visait à trouver un dispositif pour décourager les contrats de travail très courts.
Enfin, des projets de loi sont prévus, mais non déposés : un projet de loi sur la santé au travail (suite au rapport Lecocq commandé par le gouvernement en janvier 2018) et un projet de loi sur les retraites.
Projet de loi PACTE • 11 avril : adoption définitive par l’Assemblée nationale ; saisine du Conseil Constitutionnel le 16 avril, qui a jusqu’au 16 mai pour rendre sa décision.
Projet de LOM • 2 avril : adoption au Sénat ; transmission à l’Assemblée nationale le 3 avril. Débats, adoption et promulgation à venir.
Négociation sur la notion de « cadres » • Négociation qui aurait dû être bouclée au 1er janvier 2019. Prochaine réunion de négociation : 29 mai.
Négociation sur l’assurance chômage • 20 février : échec des négociations. A ce stade, les négociations ont été rompues par le MEDEF.
Projet de loi sur la santé au travail • A venir.
Projet de loi sur les retraites • Concertation entre les partenaires sociaux en cours.
Marine AZAIS
La loi « Travail » d’août 2016 a introduit la possibilité pour les entreprises de recourir, par accord collectif dans un secteur où la branche l’autorise, à une modulation du temps de travail des salariés pour une durée pouvant aller jusqu’à 3 ans. Concrètement, cette pluri-annualisation du temps de travail a contraint des salariés de la métallurgie à travailler davantage pendant des périodes « hautes » et un peu moins lors de périodes « basses ».
La CGT, présumant cette mesure non-conforme à l’article 4§2 de la Charte sociale européenne, a saisi le Comité européen des droits sociaux. Devant ce comité du Conseil de l’Europe, le syndicat affirme que cette modulation du temps de travail sur 3 ans prive les travailleurs de leurs droits à une rémunération équitable et à un taux majoré de rémunération pour les heures supplémentaires. En effet, les salariés concernés fournissent les efforts et subissent les contraintes liées à des durées de travail plus élevées pendant les périodes « hautes », qui peuvent être longues, mais ne perçoivent aucune compensation pécuniaire ou en repos. Les périodes « basses » peuvent être placées plusieurs mois voire plus d’un ou deux ans plus tard et en aucune façon elles ne peuvent être considérées comme des compensations puisqu’elles correspondent purement et simplement à la différence arithmétique entre les heures effectuées en période haute et la durée légale du travail.
Le 15 mars 2019, le Comité abonde dans ce sens et juge « trop longues pour être conformes à la charte » les périodes « de 24 mois, 27 mois et 36 mois qui figuraient dans les conventions collectives ». Toujours selon le Comité, « plus la période de référence est longue, plus elle offre de souplesse pour répartir le temps de travail de façon inégale, une situation qui pourrait aboutir […] à des durées de travail hebdomadaires supérieures à 60 heures […] excessivement longues ».
Une victoire pour la CGT qui estime que, comme pour les barèmes d’indemnités prud’homales, les salariés pourront désormais saisir le juge « pour faire écarter l’application des mécanismes d’aménagement de leur temps de travail contraires à la Charte sociale européenne et demander le paiement d’heures supplémentaires ».
Malek SMIDA
Selon de nombreux économistes français, le « modèle allemand » aurait eu pour effet une baisse significative du taux de chômage chez nos voisins. Notre législateur n’y est pas resté insensible. La loi « El-Khomri », les ordonnances « Macron » ou encore plus dernièrement le décret sur les allocations chômage du 28 décembre 2018, s’inspirent largement du « modèle allemand » et de l’esprit d’une série de réformes adoptées outre-Rhin : les lois Hartz.
Entre 2003 et 2005, suite aux recommandations d’une commission dirigée par Peter Hartz, le gouvernement social-démocrate allemand a souhaité flexibiliser son marché du travail. Pour cela, les lois Hartz reposent sur deux piliers :
Une des mesures les plus controversées étant les Ein-Euro-Job, des emplois à un euro de l’heure pour les chômeurs de longue durée.
Or, une récente étude universitaire vient contredire les prétendus effets positifs de ces réformes sur le marché du travail allemand.
Selon Jake Bradley et Alice Kügler, chercheurs à l’Université de Nottingham et au University College de Londres, les lois Hartz ont d’abord eu pour conséquence une importante baisse des salaires (-4%). Selon ces universitaires, cette baisse est principalement liée à l’effondrement du pouvoir de négociation des chômeurs qui se retrouvent alors dans l’obligation d’accepter des contrats précaires. En position de force, les employeurs allemands n’ont donc pas hésité à diminuer les salaires. Les personnes peu qualifiées, dont le pouvoir de négociation salariale est encore plus faible, ont vu une baisse de leur salaire moyen de 10 % !
Le second constat de cette étude est plus surprenant. Alors que depuis 2005 en Allemagne, le nombre de demandeurs d’emploi a baissé de 7 points, les lois Hartz n’ont permis de diminuer le chômage que de 0,16% ! Selon Jake Bradley et Alice Kügler, la baisse du chômage outre-Rhin n’a donc aucun lien direct avec les lois Hartz et est principalement liée au vieillissement de la population ainsi qu’aux bons résultats en matière d’exportation, eux-mêmes conséquence en partie, il est vrai, de la modération salariale.
Les réformes Hartz ont donc créé un marché du travail précaire, où les salariés alternent entre des courtes périodes d’emploi et des courtes périodes sans-emploi. Tant de précarité pour une baisse du chômage de 0,16%… Le jeu en valait-il la chandelle ?
Malek SMIDA
Le nombre de mandats successifs est limité à trois, excepté :
Le nombre maximal de mandats successifs s’applique également aux membres du CSE central et aux membres des CSE d’établissement sauf dans les entreprises ou établissements de moins de cinquante salariés et, le cas échéant, si le protocole d’accord préélectoral (PAP) en stipule autrement, dans les entreprises ou établissements dont l’effectif est compris entre cinquante et trois cents salariés.

La Cour de cassation a rendu, le 16 janvier 2019, une décision intéressante concernant l’étendue de la dévolution des biens du comité d’entreprise.
Dans cette affaire, une société a absorbé le 1er juillet 2012 deux autres entreprises. Du fait de cette fusion, les biens des CE des entreprises absorbées ont été dévolus au comité d’entreprise de la société absorbante.
Le comité d’entreprise de la société absorbante a saisi la justice d’une demande de rappel de la subvention de fonctionnement des comités d’entreprise des sociétés absorbées pour les années précédant l’opération de fusion.
La question qui se pose aux juges est la suivante : la dévolution des biens par le comité d’entreprise de la société absorbée à celui de la société absorbante emporte-t-il transmission des actions en justice tendant au paiement de rappel de subventions ? Et cela, alors même qu’aucune action judiciaire n’avait été initiée par les CE des sociétés absorbées.
Dans son arrêt, la Cour de cassation considère que lorsqu’un comité d’entreprise, appelé à disparaître à la suite d’une fusion, affecte la totalité de ses biens à un autre comité d’entreprise, cette transmission universelle de patrimoine englobe la transmission de créances quelles qu’elles soient : actuelles, éventuelles ou conditionnelles. La Cour de cassation a donc condamné l’entreprise absorbante à payer au comité d’entreprise la somme de 64 726 euros à titre de rappel des subventions de fonctionnement pour les années 2009 à 2012.
Cet arrêt du 16 janvier 2019 est important. Concernant les demandes de rappels de subventions des CE, la société absorbante est donc responsable des manquements des entreprises qu’elle absorbe.
Malek SMIDA
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000038060641
En février, nous nous inquiétions d’une disposition de la loi anti-casseurs qui permettait aux préfets d’interdire de manifestation, déclarée ou non, « toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ». Nous considérions que cette interdiction administrative était préoccupante quant au respect de notre droit de manifester et de notre liberté de circulation, protégés par la Déclaration universelle des droits de l’Homme.
Hier, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel. Les Sages ont estimé que « le législateur a porté au droit d’expression collective des idées et des opinions une atteinte qui n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée ».
Quand bien même le reste de la loi ait été validé par le Conseil constitutionnel, cette censure de l’article 3 est une victoire pour le respect de nos libertés fondamentales.
Malek SMIDA
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019780DC.htm
La consultation doit notamment pouvoir être abordée sous trois angles spécifiques :
Depuis des arrêts rendus sur l’amiante en 2002, nous savons que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés en matière de protection de leur santé et de leur sécurité, notamment pour les faits de discrimination. Mais dans cette affaire, la question qui se pose à la Cour de cassation est de savoir si l’employeur est responsable des agissements d’un bénévole sur l’une de ses salariées.
En l’espèce, une salariée est employée comme agent polyvalent par une association sportive. Lors d’une soirée organisée par son employeur, une insulte à connotation sexiste est proférée à son encontre par un bénévole et des détritus lui sont jetés dessus, sans réaction de son supérieur hiérarchique, présent au moment des faits.
Après avoir dénoncé ces agissements, la salariée assigne alors son employeur en paiement de dommages-intérêts pour discrimination et violation de son obligation de sécurité.
La Cour de cassation donne raison à la salariée et affirme qu’en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l’employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur ses salariés.
Dans certains cas de figure, notamment en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l’employeur peut donc être amené à répondre de faits commis par un tiers à la relation de travail.
Malek SMIDA
Arrêt n° 153 du 30 janvier 2019 (17-28.905) - Cour de cassation – Chambre sociale
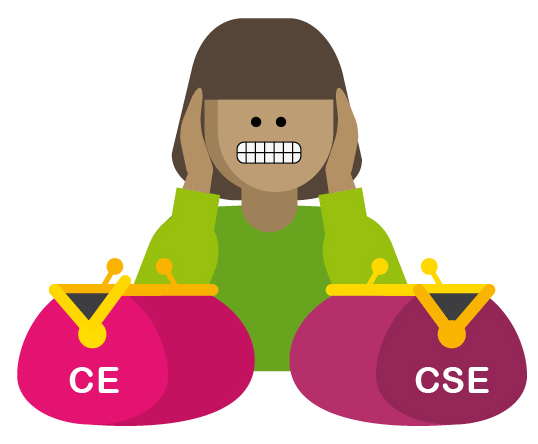
L’employeur verse au comité un budget de fonctionnement qui, d’après la loi, est d’un montant équivalent à 0,2 % ou 0,22 % (sociétés de 2000 salariés et plus) de la masse salariale brute annuelle.
À cet effet, la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de Sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ou de l’article L.741-10 du Code rural et de la pêche maritime, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Introduite en 2008, la rupture conventionnelle permet à l’employeur et au salarié en CDI de convenir d’un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Une fois homologuée par l’inspection du travail, la rupture conventionnelle permet au salarié de bénéficier d’une indemnisation spécifique de rupture et lui donne droit aux allocations chômage.
Une étude de la DARES indique que, l’année dernière, 437 700 ruptures conventionnelles individuelles ont été homologuées, soit une augmentation de 3,9 % par rapport à l’année précédente.
Excepté la Normandie, toutes les régions françaises sont touchées par cette forte hausse. Selon la DARES, plus de la moitié des ruptures conventionnelles sont signées par des employés et 60% des salariés signataires ont moins de 40 ans.
La hausse des ruptures conventionnelles en 2018 peut s’expliquer par les politiques successives de flexibilisation de l’emploi.
Le plafonnement des indemnités prud’homales, notamment, décourage de nombreux salariés à s’engager dans la voie contentieuse pour faire valoir leurs droits, ces salariés préférant alors négocier à l’amiable leur départ à travers une rupture conventionnelle. Atlantes a mis en ligne une pétition pour demander la fin du barème des indemnités prud’homales. Pour la signer, rdv sur : https://www.change.org/p/stop-au-bareme-des-indemnites-prud-homales
Atlantes peut également vous accompagner lors de la négociation de votre rupture conventionnelle afin que l’ensemble de vos droits soit respecté. Pour cela, contactez notre service au 01 56 53 65 05 ou par mail à l’adresse formation@atlantes.fr
Malek SMIDA
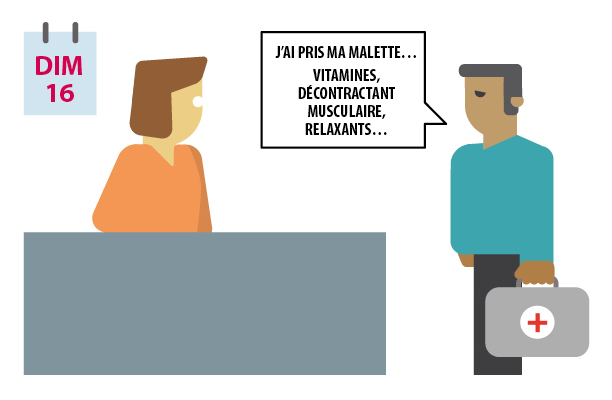
Le mois dernier, la DARES a publié une étude sur l’évolution des contraintes physiques et l’intensité du travail en France de 1984 à 2016. Ses conclusions sont alarmantes.
Il y a 25 ans, 16% des salariés déclaraient rester longtemps au travail dans une posture pénible ou fatigante. Ils sont plus du double aujourd’hui.
En 1984, moins de 17% des salariés effectuaient des déplacements à pieds longs ou fréquents sur leur lieu de travail. Ils sont 37,3% en 2016.
De nos jours, près de 40% des salariés portent ou déplacent des choses lourdes. Ils n’étaient « que » 21,5% en 1984.
Sans surprise, les principales victimes de cette recrudescence des troubles physiques au travail sont les employés et les ouvriers.
Le 17 février 2019, 18 maires se sont mobilisés dans une tribune contre les inégalités sociales de mortalité en France et ont rappelé qu’un homme de 35 ans, s’il est ouvrier, a une espérance de vie inférieure de 6,4 ans à celle d’un cadre.
Si des initiatives locales salutaires peuvent être prises dans la lutte contre l’obésité infantile ou en matière bucco-dentaire, c’est avant tout au législateur d’attaquer le problème à la racine. Et la meilleure manière d’améliorer l’espérance de vie d’un ouvrier est d’améliorer… ses conditions de travail d’ouvrier !
En décembre dernier, nous nous inquiétions des conséquences de la généralisation du travail le dimanche sur la santé des salariés.
Il y un an, nous nous alarmions de la suppression, initiée par les ordonnances Macron, de 4 des 10 facteurs de risques du compte de prévention de la pénibilité.
Enfin, que dire de la suppression des CHSCT au 1er janvier 2020 ?
Face à ces nombreux reculs, les salariés ont besoin d’élus du CHSCT-SSCT correctement préparés pour défendre leurs conditions de travail. Pour cela, Atlantes vous propose plusieurs formations en santé, sécurité et conditions de travail : https://www.atlantes.fr/-Vous-etes-un-elu-du-CHSCT-SSCT-
Malek SMIDA
En septembre 2017, le gouvernement imposait par voie d’ordonnance de plafonner les indemnités qu’un salarié est susceptible de percevoir en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Plusieurs conseils de prud’hommes, dont l’une des missions est de contrôler la conformité des lois françaises au regard des conventions internationales, ont depuis jugé que ce plafonnement était contraire à l’article 24 de la Charte sociale européenne ainsi qu’à l’article 10 de la convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). Ces articles prévoient qu’une juridiction, en cas de licenciement infondé, doit pouvoir ordonner le versement au salarié d’une « indemnité adéquate » ou toute autre forme de réparation « appropriée ». Affolement au plus haut sommet de l’Etat. Le ministère du travail allant même jusqu’à remettre en cause la formation juridique des conseillers prud’homaux !
Le 26 février dernier, fait rare en droit du travail : le ministère de la justice a adressé une circulaire à tous les procureurs généraux des cours d’appel pour leur demander de recenser les décisions ayant retenu l’inconventionnalité du barème et de défendre ce plafonnement lorsque les cours d’appel seront saisies de cette question. La Chancellerie n’ayant pas oublié de mettre en copie « pour information » les président-e-s des cours d’appel et des tribunaux de grande instance.
Pour légitimer ce qui ressemble tout de même à une réelle pression sur le pouvoir judiciaire, la ministère de la justice a joint en annexe de sa circulaire des décisions du Conseil Constitutionnel et du Conseil d’Etat ayant validé ce plafonnement des indemnités.
Rappelons que, le 21 mars 2018, le Conseil Constitutionnel a contrôlé la constitutionnalité de ce barème et non sa conformité au regard des conventions internationales. Cette décision des juges constitutionnels est donc hors-sujet. L’arrêt du Conseil d’Etat du 7 décembre 2017, quant à lui, a été rendu en urgence, dans le cadre d’une procédure de référé-suspension en réponse à plusieurs demandes formulées par la CGT qui ne soulevait alors pas tous les arguments portés aujourd’hui à l’encontre du barème. De plus, le Conseil d’Etat a lui-même affirmé que « le rejet de ces demandes ne préjuge toutefois pas de l’appréciation [qu’il] portera sur la légalité des deux ordonnances, sur laquelle il se prononcera dans les prochains mois ». Par conséquent, aucune de ces deux décisions ne sauraient lier les juges judiciaires.
Cette circulaire ministérielle a pour but principal d’empêcher de possibles confirmations en appel de ces jugements des conseils de prud’hommes. Le dernier mot reviendra ensuite à la Cour de Cassation qui ne s’est pas encore prononcée sur la conventionnalité de ce barème. N’oublions pas qu’en 2008, le ministère de la justice avait recadré de la même manière les juges du fond dans le but de défendre le Contrat nouvel embauche (CNE). Cela n’avait pas empêché la Cour de Cassation, le 1er juillet de cette même année, de juger inconventionnel le CNE au regard de cette même Convention 158 de l’OIT !
Vous aussi, mettez la pression sur le pouvoir exécutif. Exigez du gouvernement la suppression du plafonnement des indemnités prud’homales en signant dès maintenant notre pétition : https://www.change.org/p/stop-au-bareme-des-indemnites-prud-homales
Malek SMIDA
En janvier dernier, l’IFOP a publié une étude pour Syndex sur la mise en place du CSE. L’enquête a été menée fin 2018 auprès d’un échantillon de 1147 élus du personnel français.
Les négociations pour le passage en CSE se déroulent dans un contexte social mitigé, voire dégradé aux yeux de nombreuses personnes interrogées.
Aussi, 55% d’entre elles attribuent une note inférieure à 5 sur 10 à la qualité du dialogue dans leur entreprise. 64% de ceux qui vont négocier anticipent un manque d’ouverture au dialogue de la part de leur direction, ce à quoi 50% de ceux qui ont déjà négocié ont dû faire face. Pour qualifier les directions, le terme « opportuniste » est, de loin, le plus plébiscité par les répondants (72%).
De plus, 4 élus sur 10 associent le passage en CSE à un affaiblissement de leur poids face à celui de la direction ainsi qu’à une diminution des moyens alloués et du temps disponible pour accompagner les salariés.
Cela est regrettable quand on sait que, s’agissant des moyens et règles de fonctionnement du CSE, presque tout peut être négocié au sein de l’accord de mise en place de la nouvelle instance unique. Il est donc possible d’y intégrer des dispositions améliorant les droits de la représentation du personnel.
Or, seuls 34% des élus d’entreprises de plus de 1000 salariés sont accompagnés dans les négociations par un cabinet d’avocats. Pour les entreprises de moins de 1000 salariés, c’est encore pire : seulement 28% des représentants le sont.
Ceci est d’autant plus alarmant lorsque 75% des représentants sont inquiets vis-à-vis de leur passage en CSE. Parmi ces élus inquiets, 81% affirment être mal préparés à la négociation !
Le cabinet ATLANTES peut justement vous préparer à ces négociations cruciales. Notre formation « Préparer le passage en CSE » vous permettra d’approfondir la méthodologie de négociation (calendrier de négociation / constitution du groupe de négociation / durée de la négociation / articulation entre accords, protocole électoral et règlement intérieur…). Pour plus d’informations sur cette formation, rdv sur : https://www.atlantes.fr/Preparer-le-passage-en-CSE
Malek SMIDA
En septembre 2018, la loi « avenir professionnel » avait déjà fragilisé les demandeurs d’emploi en les contraignant d’accepter des offres situées, aller-retour, à plus de deux heures de trajet de leur domicile. Par décret, le gouvernement Edouard Philippe a frappé encore plus fort.
Le 28 décembre dernier, l’exécutif a modifié une nouvelle fois les droits et devoirs des demandeurs d’emploi. Ce décret étend l’obligation d’accomplir des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi et abroge la définition du salaire antérieurement perçu.
En effet, l’ancien article R5411-15 du Code du travail, supprimé par ce décret, définissait la notion de salaire antérieurement perçu qui était prise en compte pour déterminer l’offre raisonnable d’emploi. Dorénavant, le demandeur d’emploi est dans l’obligation d’accepter une offre dont la rémunération est très inférieure à ce qu’il percevait précédemment.
Avant ce décret du 28 décembre 2018, le demandeur d’emploi était privé d’un pourcentage de ses allocations chômage en cas de manquement à l’une de ses nombreuses obligations (absence à un rdv Pôle emploi, refus à deux reprises d’accepter une offre « raisonnable », non-justification d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi…). Désormais la sanction est la suppression pure et simple de la totalité de ses allocations chômage.
Fatalement, ces nouvelles dispositions auront pour conséquence une hausse des radiations de la liste des demandeurs d’emploi. Un subterfuge pour faire baisser les chiffres du chômage ?
Malek SMIDA
Les documents ou pièces justificatives nécessaires à l’établissement de l’assiette ou au contrôle des cotisations et contributions sociales doivent désormais être conservés durant 6 ans minimum, au lieu de 3 ans, en conformité avec la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale. Le point de départ de ce délai est à la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis ou reçus.
Notons que les documents comptables doivent être conservés durant 10 ans. Concernant les documents de l’instance : Rapports et Procès-verbaux, eu égard à leur valeur juridique, nous conseillons de les conserver à vie.
Maxence DEFRANCE
Image Traits d’Union - Secafi

S’agissant des moyens et règles de fonctionnement du CSE, presque tout peut être négocié au sein de l’accord de mise en place de la nouvelle instance unique. Pourtant, trop peu de CSE installés ont été signés à la suite d’un accord collectif. De nombreux élus n’ont donc pas pu intégrer des dispositions améliorant les droits de la représentation du personnel.
Atlantes peut vous préparer à ces négociations. Notre formation « Préparer le passage en CSE » vous permettra d’approfondir la méthodologie de négociation (calendrier de négociation / constitution du groupe de négociation / durée de la négociation / articulation entre accord, protocole électoral et règlement intérieur…). Pour plus d’informations sur cette formation, rdv sur : https://www.atlantes.fr/Preparer-le-passage-en-CSE

Vous étiez nombreux à vous joindre à nous le 14 février dernier pour participer à notre Matinale ayant pour thème « Le CSE : premiers constats et dernières lignes droites ». La complexité du sujet et la richesse de nos échanges nous rappellent combien il est nécessaire de rester vigilant et de s’impliquer dans la construction de la nouvelle architecture mise en place au plus tard le 31 décembre 2019.
Les premiers retours confirment ce que nous craignions dès la publication des ordonnances. Le big-bang social n’aura pas lieu. Les directions, dans leur grande majorité, appliquent à la lettre le Code du travail, alors que le gouvernement n’a eu de cesse de vanter la mise en place du CSE de manière concertée. Le nouveau dispositif censé structurer le dialogue social de demain est davantage appréhendé comme un formidable outil de simplification des rapports sociaux et un véritable gisement d’économies. Nous assistons à l’organisation du concours Lépine du DRH qui réussira à réduire au maximum le nombre de réunions et de représentants du personnel.
Combien d’accords innovent véritablement sur la régularité des réunions du CSE, le niveau des heures de délégation, le nombre d’élus, la place des suppléants, l’organisation des procédures d’information consultation ? Combien d’accords se détachent véritablement du Code du travail pour inventer un monde nouveau ?
Cela ne nous surprend pas dès lors que pour certains le 23 septembre 2017 résonne comme la nuit du 4 août pour d’autres.
Cela ne nous étonne pas dès lors qu’il fallait « libérer » l’entreprise et adapter le Code du travail en conséquence.
Cela nous questionne en revanche sur la capacité de certaines directions à appréhender les rapports sociaux sur le long terme. Mais à quoi bon s’évertuer à penser le collectif lorsque certains ne passent pas plus de 3 ou 4 ans à la tête d’une entreprise.
Tout ceci manque singulièrement d’audace et d’imagination.
Faute de temps, de recul et de moyens, il est difficile pour les organisations syndicales, ou les élus, de repenser la structuration de la représentation du personnel au pas de charge sans avoir le réflexe naturel de tenter de reproduire l’univers qu’ils connaissent depuis de très nombreuses années.
Les dés étaient pipés dès le départ. Nous le savions, mais le cynisme avec lequel certains agissent sera lourd de conséquences lorsque faute d’interlocuteurs ou de représentants aguerris, les salariés se réveilleront dans quelques temps avec la gueule de bois. En réduisant drastiquement les moyens d’agir des représentants du personnel, en limitant les lieux d’échanges, c’est à l’ensemble de la collectivité des salariés que l’on s’en prend. La dégradation des rapports sociaux aura forcément des effets néfastes sur les salariés, tant d’un point de vue individuel que collectif, tant d’un point de vue économique que social, tant d’un point de vue psychique que mental. Certains en viennent déjà à repenser les accords fraichement signés. C’est pour dire !
Vous nous posiez la question de savoir comment faire pour que les suppléants ne se sentent pas totalement inutiles et que finalement aucun salarié ne se porte demain candidat à une telle fonction. Il y a à notre sens un espace de négociation possible entre le fait que les suppléants participent à toutes les réunions plénières (certains accords l’ont acté) et le fait qu’ils n’y participent que pour remplacer un titulaire absent (c’est la grande majorité). Pourquoi ne pas décider qu’un certain nombre participera d’office à ces réunions ? Pourquoi ne pas fixer une liste de thèmes (projet important ayant des effets sur l’emploi ou les conditions de travail, consultations récurrentes du CSE…) pour lesquel ils participeront de droit à celles-ci ? D’autres hypothèses sont par ailleurs possibles.
Il est loin le temps où l’on se mettait à rêver de la possibilité de faire adhérer les salariés au projet de l’entreprise, notamment par l’intermédiaire de leurs représentants du personnel.
Il est encore temps de changer les choses avant la date butoir, et c’est pourquoi l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices du Cabinet resteront mobilisés à vos côtés dans les mois à venir. D’autres Matinales nous en donneront cette occasion.
Olivier CADIC

Le 14 février dernier, s’est déroulé aux Canaux, dans le 19ème arrondissement de Paris, la deuxième édition des Matinales d’Atlantes. Ces Matinales sont des lieux d’échanges constructifs entre élus.
Animée par Olivier Cadic, directeur des activités juridiques et de conseil d’Atlantes, et Diego Parvex, avocat associé du cabinet, cette Matinale nous a permis de dresser collectivement un premier bilan du Comité Social et Economique et de préparer les participants à leur passage en CSE. Cette rencontre a également été l’occasion pour notre équipe d’aider les élus à maîtriser l’organisation interne et les règles de fonctionnement de cette nouvelle instance.
Nous vous tiendrons informé-e de notre prochain évènement sur notre site internet : https://www.atlantes.fr/-Les-Matinales-d-Atlantes-331-
Un mois après l’élection du CSE, il appartient à votre employeur d’organiser la première réunion et de fixer seul son ordre du jour.
A défaut d’accord, l’employeur communique une documentation économique et financière précisant :
1° La forme juridique de l’entreprise et son organisation ;
2° Les perspectives économiques de l’entreprise telles qu’elles peuvent être envisagées ;
3° Le cas échéant, la position de l’entreprise au sein du groupe ;
4° Compte tenu des informations dont dispose l’employeur, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l’entreprise dans la branche d’activité à laquelle elle appartient. (art. L2312-57 du Code du travail)
C’est aussi lors de cette première réunion qu’il convient de procéder à :
- la constitution du bureau : la désignation du secrétaire et du trésorier (et éventuellement des adjoints)
- la reddition des comptes par les anciens membres du CE
- les préconisations relatives au transfert des biens, droits et obligations du CE vers le CSE
- la présentation de la Base de Données Economiques et Sociales
- l’établissement d’un calendrier des réunions (et plus généralement de l’agenda social)
- la désignation des commissions éventuelles (dont la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail le cas échéant) et de ses membres
- la désignation des Représentants de proximité (selon les modalités fixées par accord majoritaire prévoyant leur mise en place) le cas échéant
- la désignation du représentant au CA, au conseil de surveillance ou à l’AG dans les entreprises concernées
- la désignation des membres du Comité social et économique central le cas échéant.
Cette première réunion permet donc de commencer à faire vivre le CSE et de s’interroger de manière opérationnelle sur le fonctionnement du CSE (par exemple sur l’articulation de la CSSCT avec le CSE).
Le CSE (pour les entreprises de plus de 50 salariés) doit, conformément à l’article L.2315-24 du Code du travail, mettre en place un règlement intérieur pour cette instance qui en définira le fonctionnement. La première réunion pourra également être l’occasion d’initier ce travail de construction du règlement, en désignant par exemple les élus qui se chargeront d’émettre un projet de règlement intérieur.
Le cabinet ATLANTES peut vous accompagner dans la rédaction de ce règlement intérieur. Plus d’informations sur notre site : https://www.atlantes.fr/-Accompagnement-au-quotidien-
Oui. Une fois que l’ordre du jour a été transmis à l’ensemble des membres du CSE par le président, rien n’interdit au secrétaire du comité de communiquer celui-ci auprès de l’ensemble des salariés selon les règles de communication habituelles (panneaux d’affichage, intranet, site du CSE …), et ce, sans avoir au préalable à requérir l’autorisation de l’employeur.
Oui. Les représentants de proximité bénéficient de la protection contre le licenciement prévue par le Code du travail, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Pour licencier un RP, l’employeur doit préalablement requérir l’autorisation de l’inspecteur du travail :
Ces règles s’appliquent également aux représentants de proximité :
Dans cette affaire, un salarié a été licencié pour avoir effectué des prestations de covoiturage avec son véhicule de fonction. Sans l’accord de son employeur, ce salarié a publié sur le site Blablacar 112 annonces de trajets payants en 4 ans.
Dans son arrêt du 31 août 2018, la Cour d’Appel de Rennes considère que le fait pour un salarié de pratiquer du covoiturage avec un véhicule de fonction à l’insu de son employeur, en l’exposant à un risque compte tenu de l’absence de couverture de cette activité par l’assureur, constitue une faute justifiant le licenciement.
Malek SMIDA
CA Rennes, 8ème Chambre prud’homale, 31 août 2018, n° 16/6462
La proposition de loi visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs, dite loi anti-« casseurs », a été adoptée hier à l’Assemblée nationale.
L’article 2 de ce texte donne la possibilité aux préfets d’interdire de manifestation, déclarée ou non, « toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public » et ayant été précédemment condamnée pour des actes de violence, de dégradation d’un bien appartenant à autrui ou pour avoir tracé des inscriptions sur le mobilier urbain, au cours d’une manifestation.
Mais ce n’est pas tout. Toujours selon cet article, est également visé par cette interdiction un manifestant qui « appartient à un groupe ou entre en relation de manière régulière avec des individus incitant, facilitant ou participant à la commission de ces mêmes faits » de violence ou de dégradation.
Cette loi est inquiétante quant au respect de notre droit de manifester et de notre liberté de circulation, protégés par la Déclaration universelle des droits de l’Homme.
Malek SMIDA
http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1352.asp

Merci à toutes celles et ceux qui ont signé la pétition demandant l’abrogation du barème des indemnités prud’homales. Plus nous serons nombreux à la signer et à la partager, plus ce sujet s’imposera dans les débats à venir.
Nous comptons à nouveau sur votre mobilisation !
Ensemble, faisons disparaître cette disposition qui interdit aux salariés injustement licenciés de bénéficier d’une indemnisation à la hauteur de leur situation personnelle.
https://www.change.org/p/stop-au-bareme-des-indemnites-prud-homales
Le temps consacré aux enquêtes réalisées à la suite d’un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation. Il est payé comme du temps de travail effectif. Il en va de même pour le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent.

Dans un arrêt du 10 janvier 2019, la Cour d’appel de Paris a requalifié le contrat de partenariat entre un chauffeur et la société UBER en un contrat de travail. Pour cela, les magistrats se sont appuyés sur la jurisprudence de la Cour de Cassation « Take It Easy » du 28 novembre 2018 que nous avons présenté il y a quelques semaines.
En l’espèce, un chauffeur VTC a signé un contrat de « partenariat » avec la société UBER. Après avoir effectué plus de 2000 courses avec cette dernière, son application UBER a été désactivée sans explication, le privant ainsi de la possibilité de recevoir de nouvelles demandes de réservation. La société explique avoir désactivé l’application du chauffeur en raison de ses manquements graves et répétés. Débouté en première instance de sa demande de requalification de son contrat en un contrat de travail, il interjette appel pour contester les conditions de cette désactivation qu’il assimile à un licenciement abusif.
Devant la Cour d’appel, la société UBER estime que les clients sont les seuls donneurs d’ordre des chauffeurs, qu’aucun lien de subordination n’existe entre elle et ces derniers, et que l’appelant échoue à renverser la présomption de non-salariat qui lui est applicable au titre de son inscription au Répertoire des Métiers.
Ce n’est cependant pas l’avis des juges d’appel qui ont renversé cette présomption simple de non-salariat. En effet, les juges du fond affirment que le chauffeur a été contraint, pour pouvoir devenir « partenaire » de la société UBER et de son application éponyme, de s’inscrire au Registre des Métiers, et qu’il ne pouvait pas décider librement de l’organisation de son activité, de rechercher une clientèle, de choisir ses fournisseurs ou encore de fixer lui-même ses tarifs, tout cela étant entièrement décidé par UBER. Comme dans l’affaire Take Eat Easy, l’arrêt retient que lorsque le chauffeur se connecte à l’application, UBER lui donne des directives, en contrôle l’exécution et exerce un pouvoir de sanction à son endroit. Il existe donc bien un lien de subordination entre la société UBER et son chauffeur, caractérisant l’existence d’un contrat de travail.
Cette affaire est par conséquent renvoyée devant le conseil de prud’hommes afin qu’il détermine si cette rupture constitue ou non un licenciement abusif.
Une nouvelle déconvenue pour ces plateformes numériques qui, depuis trop longtemps, contournent les règles du droit du travail.
Malek SMIDA
CA Paris, 10 janv. 2019, n° 18/08357

Présentée comme une réforme de simplification faisant émerger un interlocuteur unique, la mise en place du CSE a également été perçue par les salariés et leurs représentants comme un recul de leurs droits et moyens.
Un an après, quelles premières constatations pouvons-nous faire ?
Le CSE a-t-il permis une amélioration de la représentation des salariés et de leurs intérêts ou a-t-il au contraire affaibli celle-ci ? Nos avocats et juristes vous feront part de leurs retours d’expérience.
Nous comptons sur votre présence pour livrer les vôtres et venir débattre avec nous, afin que votre passage en CSE se passe dans les meilleures conditions, au mieux de vos intérêts et de celui des salariés que vous représentez.
Ensemble jusqu’à 12h00 pour échanger, comprendre vos besoins et vous accompagner au mieux.
Jeudi 14 février 2019
à partir de 9h, jusqu’à 12h (petit déjeuner offert)
Aux "Canaux"
6 Quai de la Seine, 75019 PARIS
(proximité métros Stalingrad et Jaurès)
Tous les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, et ce quel que soit l’effectif de l’entreprise (entre 11 et 49 salariés ou 50 salariés et plus), et y compris s’il existe une commission santé, sécurité et conditions de travail.
Merci à toutes celles et ceux qui ont d’ores et déjà signé la pétition demandant le retrait du Code du travail du barème des indemnités prud’homales.
Nous sommes persuadés que plus nous serons nombreux à signer et faire circuler celle-ci, plus ce sujet s’imposera dans les débats à venir.
Nous comptons sur votre mobilisation pour œuvrer à faire disparaître cette disposition socialement injuste.
Le lien de la pétition : https://www.change.org/p/stop-au-bareme-des-indemnites-prud-homales

Avec des conseillers prud’homaux entrés en résistance et nos confrères œuvrant pour la défense des salariés, le cabinet Atlantes Avocats demande au Président de la République que le plafonnement des indemnités prud’homales soit définitivement abrogé.
Ce plafonnement :
Si nous sommes nombreux à signer et à partager cette pétition, alors nous pourrons nous faire entendre !
Le lien de la pétition : https://www.change.org/p/stop-au-bareme-des-indemnites-prud-homales

Dans cette affaire, deux collègues ont une grosse altercation verbale sur leur lieu de travail. Le lendemain, la direction organise une réunion avec les deux salariés pour tenter de résoudre leur différend et anime par la suite des réunions périodiques avec l’ensemble des salariés afin de faciliter l’échange d’informations entre services.
Or, après cette altercation, l’un des deux salariés voit sa santé se dégrader et devient inapte à son poste de travail.
Le 17 avril 2014, il saisit la juridiction prud’homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement de l’employeur à diverses obligations, dont l’obligation de sécurité. Le 12 octobre 2015, sa société le licencie malgré tout pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Ce salarié étant protégé, l’inspection du travail doit alors se prononcer sur cette demande d’autorisation de licenciement. Elle se prononce favorablement.
Dans son arrêt du 17 octobre 2018, la Cour de cassation rappelle que l’inspection du travail n’a pas à rechercher la cause de cette inaptitude. Elle doit se contenter de contrôler la réalité de l’inaptitude et de vérifier l’impossibilité de reclassement, ce qui a été correctement réalisé en l’espèce. Le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur.
La Cour de cassation affirme également dans son arrêt que la société, bien qu’ayant eu connaissance des répercussions immédiates causées sur la santé du salarié par cette première altercation, des divergences de vues et des caractères très différents voire incompatibles des protagonistes et donc du risque d’un nouvel incident, n’a pris aucune mesure concrète pour éviter son renouvellement hormis diverses réunions. La direction n’a pas mis en place les mesures nécessaires permettant de prévenir ce risque, assurer la sécurité du salarié et protéger sa santé physique et mentale.
Les juges de la Cour suprême ont cassé et annulé l’arrêt d’appel afin que le salarié puisse obtenir, devant une autre cour d’appel, des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Malek SMIDA
Chaque année, Décideurs magazine réalise un classement des meilleurs cabinets d’avocats de France en se basant sur plusieurs critères : taille de l’équipe, niveau de formation des collaborateurs, nombre et qualité des dossiers traités par la structure…
Toute l’équipe d’Atlantes est fière d’être positionnée en 2019 dans la meilleure catégorie de ce classement et de faire partie des 8 cabinets « incontournables » pour le conseil des salariés et des organisations syndicales.
L’intégralité du classement est disponible sur le site du magazine Décideurs : https://www.magazine-decideurs.com/classements/ressources-humaines-conseil-des-salaries-et-des-organisations-syndicales-classement-2019-cabinet-d-avocats-france?locale=fr

Depuis 2 ans, Atlantes contribue au loto organisé par les sapeurs-pompiers d’Argenteuil (95) au profit du Téléthon. Le 7 décembre dernier, la participation de 450 personnes à cet événement a permis de récolter 7300 € pour financer des projets de recherche sur les maladies génétiques rares.
Toute l’équipe d’Atlantes félicite les pompiers d’Argenteuil pour ce succès et vous souhaite, au passage, d’excellentes fêtes de fin d’année !

Par délibération du 12 novembre 2018, un CHSCT a voté le recours à un expert agréé par le Ministère du Travail en application des articles L.4612-1 et L.4614-12 du Code du travail, pour la réalisation d’une expertise « risque grave » en présence d’une exposition des travailleurs du magasin à des risques psycho-sociaux.
Le CHSCT a procédé ainsi après avoir constaté plusieurs dysfonctionnements organisationnels au sein du magasin ayant généré des situations de souffrances au travail pour de nombreux salariés.
La société concernée a alors saisi le Tribunal de Grande Instance (TGI) pour demander l’annulation de cette délibération en faisant valoir qu’il n’existait à son sens aucun risque grave, identifié et actuel pour la santé des salariés.
Dans une ordonnance en la forme des référés du 7 décembre 2018, le Tribunal de Grande Instance de Chartres a suivi l’intégralité de l’argumentaire développé par le cabinet ATLANTES dans la défense des intérêts du CHSCT.
Le Tribunal a en effet reconnu son droit de pouvoir bénéficier du « recours à un expert indépendant à l’abri de toute pression, qui permette une analyse parfaitement objective de la situation en termes de risques psychosociaux au sein du magasin » - dans la lignée d’autres solutions jurisprudentielles antérieures.
A l’appui de sa décision, le Tribunal a relevé que le CHSCT a notamment démontré -sur la base d’indicateurs chiffrés et précis, de déclarations circonstanciées de salariés de la société et du médecin du travail- l’existence :
Selon le TGI, ces éléments constituent des « révélateurs objectifs de risques psycho-sociaux graves au sein du magasin », justifiant le recours à une expertise.
La société a donc été déboutée de sa demande d’annulation de la délibération du CHSCT.
Une victoire pour les représentants du personnel et pour leur droit de faire appel à un expert lorsque la santé des salariés est menacée !
Dans cette affaire, la société DHL international express, qui a repris l’activité et les salariés de l’une des cinq entités économiques de la société DHL express, a prononcé des sanctions disciplinaires en application d’un règlement intérieur qui avait été élaboré par cette dernière.
Dans son pourvoi en cassation, la société DHL international express considère qu’en cas de transfert d’une entité économique autonome, le règlement intérieur est automatiquement transmis au nouvel employeur qui doit en faire application.
La Cour de cassation ne partage pas cette position et rejette le pourvoi de la société. Les juges estiment que le règlement intérieur ne suit pas les salariés transférés. En effet, ce règlement constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions sont encadrées par la loi et l’article R. 1321-5 du Code du travail impose à une telle entreprise nouvelle d’élaborer son propre règlement intérieur dans les trois mois suivant son ouverture.
Afin de lutter plus efficacement contre les inégalités femmes-hommes en entreprise, le gouvernement met en place un nouvel outil : un index d’égalité femmes-hommes.
Sous la forme d’une note sur 100 points, cet index évalue cinq grands critères (rémunérations, augmentations, promotions, retours de congé maternité, nombre de femmes parmi les 10 plus hauts salaires de l’entreprise).
Chaque année, les entreprises françaises de plus de 50 salariés devront publier sur Internet le nombre de points qu’elles auront obtenu à l’index. S’il est inférieur à 75 sur 100, elles auront trois ans pour se mettre en conformité. Dans le cas contraire, elles seront sanctionnées financièrement jusqu’à 1% de leur masse salariale.
Pour éviter de possibles sanctions, de nombreuses entreprises risquent d’amplifier leur nombre de points. Pour éviter ces fraudes, le Gouvernement promet un quadruplement des contrôles de l’inspection du travail sur l’égalité salariale.
Une promesse qui semble difficile à tenir quand les syndicats affirment qu’au cours des dix dernières années, les contrôleurs du travail ont perdu plus de 20% de leurs effectifs.
Plus d’informations sur cet index d’égalité femmes-hommes sur le site du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/index-de-l-egalite-femmes-hommes-comment-ca-marche
Malek SMIDA
 Nos équipes de formateurs (juristes, avocats, experts…) accompagnent les représentants du personnel en leur fournissant les éléments clés pour exercer leur mandat.
Nos équipes de formateurs (juristes, avocats, experts…) accompagnent les représentants du personnel en leur fournissant les éléments clés pour exercer leur mandat.
Rôle du CE, du CSE, du secrétaire, du trésorier, la gestion des budgets mais aussi des thèmes sur la négociation, les restructurations, les ruptures de contrats…
C’est plus de 40 sujets, en interCE ou en intraCE, que nous animons dans toute la France.
Séquencées en format court d’une ou deux journées, cette souplesse permet aux élus de programmer des formations tout au long de l’année.
Pour découvrir notre tout nouveau catalogue de formations : https://www.atlantes.fr/IMG/pdf/2018-03_catalogue_formations_web.pdf
Dans cette affaire, un coursier « partenaire » de la société de livraison Take Eat Easy a saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande de requalification de son contrat de prestataire indépendant en un contrat de travail.
Dans son activité professionnelle, ce coursier estime être subordonné à l’entreprise Take Eat Easy, le lien de subordination caractérisant l’existence du contrat de travail. Selon lui, cette dernière a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses manquements.
Pour démontrer l’existence de ce lien de subordination, le livreur met en avant le système de pénalités mis en place par Take Eat Easy en cas de manquements des coursiers à leurs obligations contractuelles (une pénalité distribuée en cas de désinscription tardive d’un créneau horaire de livraison, d’absence de réponse à son téléphone pendant cet horaire ou d’incapacité de réparer une crevaison, 2 pénalités lors d’une connexion en dehors de la zone de livraison ou sans inscription sur le calendrier et 3 pénalités en cas de cumul de retards importants sur livraisons et de circulation avec un véhicule à moteur…). Sur une période d’un mois, une seule pénalité ne porte à aucune conséquence, le cumul de deux pénalités entraîne une perte de bonus, le cumul de trois pénalités entraîne la convocation du coursier "pour discuter de la situation et de sa motivation à continuer à travailler comme coursier partenaire de Take Eat Easy" et le cumul de quatre pénalités conduit à la désactivation du compte et la désinscription des horaires de livraison réservés.
Le 20 avril 2017, l’arrêt d’appel retient qu’un tel système de pénalités ne suffit pas à caractériser un lien de subordination entre la société et son coursier. La Cour d’appel considère que les pénalités ne sont prévues que pour des comportements objectivables du livreur constitutifs de manquements à ses obligations contractuelles et ne remettent nullement en cause la liberté de celui-ci de choisir ses horaires de travail.
Ce dernier forme alors un pourvoi en cassation et, le 28 novembre 2018, la Cour suprême lui donne raison : « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ».
Dans leur décision, les juges de la Cour de Cassation précisent que l’application Take Eat Easy était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et que, de plus, l’entreprise Take Eat Easy disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier, prouvant l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination.
Cet arrêt du 28 novembre 2018 (17-20.079) est déterminant. Il pourrait permettre à de nombreux livreurs, travaillant dans les mêmes conditions que ceux de Take Eat Easy, de demander la requalification de leurs contrats en des contrats de travail et de bénéficier, ainsi, du statut de salarié, beaucoup plus protecteur que celui d’auto-entrepreneur.
La Cour de cassation envoie un signal fort au législateur : il est grand temps que le Parlement mette fin à ces contournements du droit du travail.
Malek SMIDA
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1737_28_40778.html
A notre sens, la seule solution qui a jusqu’à présent porté ses fruits, c’est de demander une augmentation des salaires aux dirigeants des entreprises. Plus vous serez nombreux à revendiquer et à soutenir les délégués syndicaux qui vont prochainement aborder les négociations annuelles portant notamment sur les salaires, plus vous mettrez des chances de votre côté pour améliorer en partie votre pouvoir d’achat.
Les pistes de réflexion sont multiples : augmentation de la participation patronale au restaurant d’entreprise, aux titres restaurant ou dans la mutuelle, participation aux frais de transports, mise en place d’une épargne salariale permettant un véritable partage des profits avec abondement de l’entreprise, mise en place du télétravail partout où l’activité des salariés le permet avec contreparties, refus d’accepter que la contrepartie aux heures supplémentaires soit fixée à 10% comme le préconisent la loi de 2016 et les ordonnances de 2017, amélioration des dispositifs permettant l’articulation entre vie privée et vie professionnelle (frais de garde, aide à personne gravement malade ou en fin de vie …).
En 1968, les grèves et la mobilisation générale ont permis d’obtenir une augmentation de 25% du SMIC.
Dans cette affaire, la Fédération CGT des Bureaux d’étude poursuit la condamnation des sociétés SOCOTEC du fait de violation à la législation et la réglementation relative à l’amiante et de manquements à l’égard de leurs salariés, à leur obligation de garantir leur santé et de leur sécurité.
En effet, tant les procès-verbaux du CHSCT que ceux de l’Inspection du Travail ont mis, notamment, en exergue ces manquements graves allant de la non fourniture d’équipements de protection individuels, l’insuffisance des modes opératoires ou encore l’absence de traçabilité des expositions des salariés et des déchets d’amiante.
Le rapport « Expertise risque grave – Agence d’Ivry-sur-Seine », établi par le Cabinet SECAFI le 21 décembre 2017 a confirmé l’existence de ces différents manquements de l’entreprise, manquements qui constituent tous des risques d’éventuelles contaminations des salariés mais aussi des tiers à l’amiante.
Représentée par le Cabinet ATLANTES, la Fédération CGT a fait assigner SOCOTEC France, puis ses 5 émanations, par-devant le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES.
Le 18 octobre 2018, en déboutant la CGT de toutes ses demandes, le Tribunal de VERSAILLES a rendu une décision étonnante, au seul motif que la Fédération n’apporterait pas les preuves suffisantes venant étayer la persistance actuellement de ces violations généralisées de la réglementation applicable. Or, depuis quand est-il nécessaire de justifier de la persistance d’un manquement à une règle de sécurité ? La simple preuve de l’existence d’une faute suffit normalement à condamner le fautif.
Alarmée par les risques encourus par les salariés de la SOCOTEC pour leur santé, la Fédération CGT a demandé au Cabinet ATLANTES de faire appel de cette décision.
Nous n’abandonnerons pas le combat pour le respect des règles relatives à l’amiante et nous vous tiendrons informés de la suite de cette affaire.
L’article L.2314-37 du Code du travail précise que lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions pour une cause spécifique (décès, démission, rupture du contrat de travail, perte des conditions requises pour être éligible, révocation) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.
Les ordonnances de septembre 2017 et la loi de ratification du 29 mars 2018 imposèrent à la délégation du personnel au CSE de ne pouvoir disposer de plus de trois mandats successifs au sein de cette instance.
Cette limite ne s’applique toutefois pas aux entreprises de moins de 50 salariés, et peut également être écartée par le protocole d’accord préélectoral dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 300 salariés (L.2314-33).
Le décret du 26 octobre 2018 précise que les stipulations qui font exception à la limite de trois mandats successifs sont conclues pour une durée indéterminée, sauf précision contraire dans le protocole (R.2314-26). Cette disposition est applicable aux seuls protocoles conclus à compter du 1er janvier 2019. Cette nouveauté permet d’inscrire cette dérogation dans la durée.
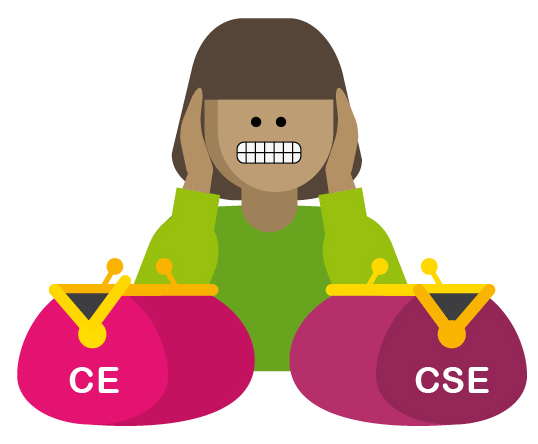
Nous savions depuis la publication des ordonnances en septembre 2017 que les membres du CSE peuvent décider, par délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement (L.2312-84), et inversement, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement pour participer au financement des activités sociales et culturelles (L.2315-61).
Le décret du 29 décembre 2017 (n°2017-1819 - JO du 30 décembre 2017) plafonnait la possibilité de transférer l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent. (R.2312-51)
Celui-ci était en revanche muet quant à la limitation appliquée au transfert d’une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement vers celui destiné aux activités sociales et culturelles.
Le décret du 26 octobre 2018 (n°2018-920 – JO du 28 octobre 2018) vient enfin clarifier cette situation.
Ce dernier précise que l’excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles dans la limite de 10 % de cet excédent. (R.2315-31-1).
Presqu’un an pour aboutir à un tel parallélisme des formes, nous laisse imaginer combien la recherche d’un compromis fut difficile à trouver tant les appétits de certains à réaliser un hold-up « légal » sur le budget de fonctionnement étaient aiguisés. Restons vigilants pour éviter que cette dernière limite ne trouve à céder trop rapidement.
Le 11 octobre nous avons eu le plaisir de vous accueillir pour la première matinale gratuite du cabinet ATLANTES : « La négociation collective avec ou sans Délégué Syndical : un exercice sous pression ».
Nous souhaitons d’abord remercier toutes celles et tous ceux qui ont pu y assister. La préparation d’un tel évènement a nécessité la mobilisation de nos équipes et nous sommes ravis que celle-ci ait rencontré votre adhésion et votre satisfaction.
Il est vrai que les mécanismes et les enjeux de négociation collective dans l’entreprise sont des sujets au cœur des dernières réformes législatives avec notamment l’élargissement du champ de la négociation collective et des acteurs habilités à conclure des conventions ou accord collectifs. Ce sujet ne serait pas si difficile à appréhender si les règles et enjeux ne présentaient pas aujourd’hui un certain degré de complexité et d’importance. Vos nombreuses interrogations sur ce sujet démontrent si besoin était qu’il faudra encore du temps pour parfaitement les appréhender.
Négocier aujourd’hui, c’est en effet intégrer les nouvelles règles d’articulation entre les normes collectives (Code du travail, Convention collective de branche, accord de groupe et d’entreprise). Mais c’est aussi et peut-être surtout avoir conscience que l’accord qui sera demain soumis à votre appréciation pourra aussi contenir des dispositions moins favorables que certaines du Code du travail ou de votre Convention collective. Alors oui, ce diagnostic n’est pas toujours évident mais ATLANTES est aussi présent pour vous épauler.
Négocier, c’est aussi associer et informer plus que jamais les salariés sur les termes de vos négociations. En cas de referendum à l’initiative des organisations syndicales signataires et « minoritaires » ou de la Direction, ce seront eux qui décideront si l’accord peut ou non s’appliquer dans l’entreprise. Or comment préparer les salariés à cette consultation si vous n’avez pas dors et déjà anticipé leur potentielle consultation.
Dans d’autres cas, en l’absence d’organisations syndicales représentatives, oui, la seule signature des Titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, suffira pour que l’accord négocié s’applique à tous les salariés. Le CSE en tant qu’instance collégialement habilitée à négocier des accords va assurément être plus souvent sollicité.
Mais négocier, c’est aussi prendre conscience avec l’accord de performance collective que ce qui aura été négocié s’imposera au salarié et qu’il pourra même « justifier » son licenciement ; quand bien même entendrait-il déroger défavorablement au code du travail, à la convention collective voire au contrat de travail, au point d’entendre le modifier d’autorité.
Cette matinale nous a conforté dans notre décision de renouveler cet évènement en début d’année prochaine, sur un thème qui sera plus que jamais d’actualité : « CSE : dernière ligne droite ».

Sauf pour remplacer un titulaire absent, les élus suppléants ne participent plus aux réunions plénières. Ils doivent toutefois recevoir les mêmes éléments que ceux transmis aux titulaires et notamment l’ordre du jour des réunions ainsi que les documents nécessaires à leur information et consultation.
Sachant qu’ils ne disposent pas d’heures de délégation et qu’ils ne participent pas aux réunions plénières, il est possible de négocier dans l’accord sur le fonctionnement du CSE et/ou dans le règlement intérieur du CSE leur présence en réunion plénière (ou au moins à certaines d’entre elles : lors des 3 consultations annuelles obligatoires du CSE, en cas de projet important, en cas de restructuration avec compression d’effectif ou encore sur les points relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail) et un crédit d’heures pour qu’ils puissent participer aux réunions préparatoires.
En l’absence d’accord plus favorable, les titulaires pourront mutualiser leurs heures de délégation avec les suppléants pour que ces derniers puissent a minima participer aux réunions préparatoires du CSE.
Dans cette affaire, un employeur a refusé de verser à une salariée en congé maternité un bonus de coopération destiné à rémunérer l’activité des travailleurs ayant transmis leur savoir-faire à des salariés du siège italien de l’entreprise. L’employeur, qui a versé la totalité du salaire de base mensuel de sa salariée pendant son congé maternité, considère qu’il n’avait pas à lui verser un bonus pour une activité qu’elle n’avait pas effectuée. Estimant qu’elle ne peut, du seul fait de sa grossesse, être exclue du versement de ce bonus, la salariée forme un pourvoi en cassation pour obtenir un rappel de salaire et une indemnité pour discrimination à ce titre.
Dans un arrêt du 19 septembre 2018 (17-11.618), la Cour de Cassation donne raison à l’employeur et ne voit aucune discrimination dans son refus de lui verser ce bonus. Dans leur décision, les juges de la Cour suprême s’appuient sur une directive européenne de 1992 affirmant que lorsqu’une travailleuse est en congé maternité, la protection minimale exigée n’implique pas le maintien intégral de sa rémunération, comme si elle occupait effectivement, comme les autres travailleurs, son poste de travail.
Malek SMIDA
Dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et moins de 300 salariés
Seul le délégué syndical (DS) peut occuper le siège de RS au CSE (la personne aura donc deux mandats distincts : RS et DS).
Dans les entreprises de 300 salariés et plus
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical parmi les salariés de l’entreprise.
Mis en place de manière facultative par voie d’accord entre l’employeur et les salariés tous les 3 ans, l’intéressement consiste à verser à chaque salarié une prime liée à la performance de l’entreprise.
Avant la loi Pacte (Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises), le versement de cette prime d’intéressement était assujetti à une contribution payée par l’employeur, le forfait social, dont le taux, dans la majorité des entreprises, était de 20%. Avec l’entrée en vigueur de la loi Pacte au 1er janvier 2019, ce forfait social sur l’intéressement sera supprimé pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés.
Lors des prochaines négociations portant sur leur accord d’intéressement, les salariés d’entreprises de moins de 250 salariés peuvent songer à la possibilité de faire valoir la suppression du forfait social pour obtenir une hausse de leurs primes. L’employeur ne payant dorénavant plus de contribution sociale sur ces primes d’intéressement, il est tout à fait envisageable que les salariés voient leurs nouvelles primes bonifiées.
Malek SMIDA
Non. C’est à l’employeur et aux délégués syndicaux de décider par accord s’ils jugent opportun de mettre en place des représentants de proximité. C’est avant tout en fonction de l’organisation de l’entreprise et de sa répartition territoriale que les arbitrages se feront. Il s’agira d’adapter la représentation du personnel à la structuration et aux spécificités de l’entreprise afin de disposer d’interlocuteurs de terrain.
Oui. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le règlement intérieur revêt un caractère obligatoire. Le Code du travail énonce que le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées, ainsi que les modalités d’arrêté de ses comptes annuels.
En l’espèce, une salariée avait remis à son employeur une lettre d’un syndicat l’informant de la création d’une section syndicale et de sa désignation en qualité de représentante de la section syndicale (RSS).
L’employeur avait saisi le tribunal d’instance en annulation de cette désignation en faisant valoir que la lettre ne mentionnait pas le lieu de la désignation (entreprise ou établissement).
Le tribunal d’instance avait rejeté cette demande au motif que le lieu de la désignation ne faisait pas de doute dès lors que la lettre avait été remise en main propre au secrétariat de direction (en l’absence du directeur de la société) et qu’il s’en déduisait que la désignation du RSS avait été faite au niveau de l’entreprise.
Ce raisonnement est cassé par la Cour de cassation : la Chambre sociale rappelle que le syndicat qui mandate un RSS doit préciser, à peine de nullité, le périmètre de cette désignation (soit l’entreprise, soit l’établissement) dans la lettre de désignation. De plus, cette lettre « fixe les limites du litige » de sorte que le juge ne peut pas apprécier la validité d’une désignation dans un autre cadre que celui qu’elle vise.
Malek SMIDA
Le comité est une instance de dialogue et d’échanges, un lieu de coopération entre les représentants des salariés et le chef d’entreprise. Pour faciliter et rendre effective cette coopération, l’ordre du jour est arrêté conjointement par le président et par le secrétaire du CSE.
Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative (consultation sur la politique sociale, consultation en cas de restructuration et compression d’effectifs...) ou réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l’un ou par l’autre. Dans ces dernières situations, cela n’exonère pas le président du CSE de procéder à une élaboration conjointe de l’ordre du jour.
Le fait d’insulter son employeur sur un groupe Facebook fermé justifie-t-il un licenciement pour faute grave ? C’est la question à laquelle a répondu la Cour de Cassation dans un arrêt du 12 septembre 2018 (n°16-11.690).
Dans cette affaire, une salariée a diffusé des messages injurieux et humiliants à l’encontre de son employeur sur un groupe Facebook fermé intitulé « Extermination des Directrices chieuses ». Ces propos n’étaient accessibles qu’aux 14 membres de ce groupe agréés par la salariée.
Selon la Cour suprême, les propos injurieux tenus à l’encontre d’une supérieure hiérarchique sur un réseau social ne caractérisent pas une faute grave lorsqu’ils sont diffusés dans un cercle privé. Cette décision de la chambre sociale est dans la lignée de celle de la première chambre civile laquelle avait considéré dans un arrêt du 10 avril 2013 (n°11-19.530) que les propos litigieux tenus sur les sites Facebook et MSN ne constituaient pas des injures publiques dès lors qu’ils n’étaient visibles que par les personnes agréées par l’intéressé en nombre très restreint lesquelles formaient une « communauté d’intérêts ».
Malek SMIDA
Le licenciement envisagé de certains salariés protégés (notamment les DP et membres du CE) est soumis à l’avis du CE, après audition du salarié concerné. Saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement, l’administration doit alors s’assurer que la procédure de consultation du CE a été régulière.
Le Conseil d’Etat précise que le seul constat de l’insuffisance du délai laissé au salarié pour préparer son audition par le CE ne rend pas automatiquement irrégulière cette procédure (en l’espèce, la salariée avait eu connaissance des griefs reprochés le matin à 9h et son audition était intervenue l’après-midi du même jour à 14h).
Ce constat ne peut être invoqué par l’administration à l’appui d’un refus d’autorisation que s’il permet d’établir que le CE n’a pas été « mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation ».
Tel n’est pas le cas notamment en présence d’un avis du CE unanimement défavorable au projet de licenciement…
De quoi inciter les élus à repenser le cas échéant les conditions dans lesquelles ils rendent un avis sur un tel projet en cas de brièveté du délai de préparation de l’audition du salarié, en préférant par exemple signaler être dans l’incapacité de rendre un avis « en toute connaissance de cause » plutôt que de rendre un avis défavorable à l’unanimité.
Lors d’une conférence au salonsCE de Paris le 19 septembre, un élu d’un CSE a posé cette question simple et pratique : « Avec le CSE, nous passons à une réunion tous les 2 mois. Faut-il attendre 2 mois pour faire valider le PV et pouvoir le communiquer aux salariés ? C’est quand même bien long ! »
Découvrez ci-dessous l’article d’actuEL CE, le quotidien des représentants du personnel, avec les réponses et conseils d’Aurélien et Kama du cabinet Atlantes pour communiquer au mieux votre PV du CSE.
Telle est la solution de principe posée par la Chambre sociale dans un arrêt rendu à l’issue d’une procédure contentieuse au long cours.
Sans entrer dans le détail, notons qu’un accord sur le périmètre d’implantation de CHSCT avait été conclu en mai 2011 entre des CHSCT d’une entreprise de plus de 500 salariés. Or, dans sa version applicable en l’espèce, le Code du travail prévoyait que -dans ces entreprises- le nombre des CHSCT à constituer devait être déterminé par le CE et l’employeur (et non par des CHSCT).
Dans un premier arrêt du 22 février 2017 (16-10770), la Cour de cassation avait donc déclaré invalide l’accord précité conclu en mai 2011 entre les CHSCT.
Cela étant, entre temps, cet accord bien qu’illicite avait reçu exécution (des désignations de membres de CHSCT étant notamment intervenues en 2015).
Dans ce contexte, fallait-il considérer que l’annulation de l’accord prononcée en 2017 entraînait l’annulation rétroactive des désignations de 2015 (en application du principe classique suivant lequel ce qui est nul est censé n’avoir jamais existé) ? Ou retenir que cette annulation ne valait que pour l’avenir ? La Cour tranche en faveur de cette seconde solution.
A priori, compte tenu des termes très généraux de l’attendu de principe de cet arrêt, cette solution pourrait également valoir pour les accords collectifs de mise en place du CSE.
Présenté il y a 10 jours, le plan vélo a pour objectif d’inciter les salariés à adopter la bicyclette pour leurs trajets domicile-travail. Après les annonces de la Ministre des transports, Elisabeth Borne, sur le montant et les conditions du forfait vélo, cet objectif semble compromis...
Me Parvex, avocat associé du cabinet Atlantes accompagne un agent du pôle emploi accusé à tort par sa direction d’apologie du terrorisme.
Le cabinet Atlantes accompagne de nombreux salariés et représentants du personnel du pôle emploi au quotidien.
L’article 2324-10 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi dite « Rebsamen » du 17 août 2015, prévoit que, dans le cas d’annulation des élections CE/DP pour non-respect des règles de représentation équilibrée Hommes/Femmes, l’employeur n’est pas tenu d’organiser des élections partielles et ce, même si les conditions de l’article étaient réunies (collège électoral plus représenté ou nombre de membres titulaires réduit de moitié ou plus).
Or, comme pour le CSE, le Conseil constitutionnel a décidé que des élections partielles doivent être organisées, même si la carence d’élus est la conséquence de l’annulation de leur élection pour non-respect des règles relatives à la représentation équilibrée hommes/femmes.
Dès lors, les entreprises, encore dotées de CE et de DP et dont certains sièges se trouvent vacants du fait de l’annulation d’élections pour non-respect des règles de proportionnalité femmes/hommes, doivent, si les conditions sont remplies, organiser des élections partielles dans les conditions légales.
L’article L. 1224-3 du Code du travail prévoit que la personne publique doit proposer aux salariés concernés un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur contrat. En cas de refus des salariés, leur contrat prend fin de plein droit, sans qu’il s’agisse d’un licenciement pour motif personnel ou pour motif économique. La question des salariés protégés concernés par un tel transfert n’avait jamais été posée, jusqu’à cette décision du Conseil d’Etat.
Malek SMIDA
Il semble possible de distinguer suivant les modalités de détermination de l’établissement distinct :
1) Lorsque l’établissement distinct est reconnu par un accord d’entreprise ou, à défaut d’un tel accord et en l’absence de délégué syndical, par un accord avec le CSE, la loi ne fixe pas de critères particuliers à prendre en considération (articles L.2313-2 et L. 2313-3 du Code du travail).
Dans ces conditions, le nombre et le périmètre des établissements distincts devraient a priori pouvoir être déterminés relativement librement par les « partenaires sociaux » (en ce sens, le QR sur le Comité social et économique publié le 19 avril 2018 sur le site du Ministère du travail - réponse à la question n°25), sous réserve de conformité à l’ordre public et de l’absence de fraude à la loi.
2) Lorsque l’établissement distinct résulte d’une décision unilatérale, la prise en compte de certains critères s’impose.
A cet égard, l’article L.2313-4 du code du travail dispose que : « En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ».
Avant l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, la jurisprudence avait défini les critères de l’« établissement distinct » au sens du CE comme suit :
- une implantation géographique distincte ;
- un caractère de stabilité dans le temps ;
- et, surtout, un degré d’autonomie suffisant d’un représentant de l’employeur sur place, concernant la gestion du personnel (embauche, formation, sanction disciplinaire, etc.) et l’exécution du service (conduite de l’activité économique de l’établissement, etc.).
Dans son dernier état, la jurisprudence prenait surtout en considération ce dernier critère lié à l’autonomie, les deux premiers étant plus secondaires.
Après les ordonnances, seul le critère de « l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel » est expressément repris par la loi (article L.2313-4 du Code du travail).
Cette mention de l’adverbe « notamment » dans l’article précité permet l’admission d’autres indices relatifs à l’autonomie du chef d’établissement (et en particulier dans le domaine de l’exécution du service…).
Comme annoncé par l’évolution de la jurisprudence antérieure, l’éventuelle absence des critères relatifs à l’« implantation géographique distincte » et à sa « stabilité » ne semble plus déterminante.
Le cabinet Atlantes met à disposition des salariés et des  représentants du personnel un nouvel outil : une application mobile ! Téléchargeable gratuitement sur Google Play et dans l’App Store, cette application vous permet de suivre toute l’actualité juridique en droit du travail et de connaitre du bout des doigts toutes les évolutions que connaissent les contentieux individuels et collectifs.
représentants du personnel un nouvel outil : une application mobile ! Téléchargeable gratuitement sur Google Play et dans l’App Store, cette application vous permet de suivre toute l’actualité juridique en droit du travail et de connaitre du bout des doigts toutes les évolutions que connaissent les contentieux individuels et collectifs.
Facile d’utilisation, l’application Atlantes vous permettra également de découvrir ou de redécouvrir les dernières publications d’Atlantes, mais aussi notre catalogue de formations et notre mensuel « La Plume de l’alouette ». Vous pourrez alors retrouver vos articles préférés en les ajoutant en un clic à vos favoris !
Le cabinet Atlantes a toujours eu pour objectif de vous informer au mieux pour que vous soyez suffisamment armé-es dans la défense de vos droits et de vos intérêts. Nous espérons donc que cette application vous sera utile !
Pour la télécharger gratuitement, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Google Play ou sur App Store
L’article L.2143-3 du Code du travail dispose que chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, ayant constitué une section syndicale, peut désigner parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur.
En octobre 2016, le syndicat CGT NAM, créé deux années plus tôt et affilié à la confédération CGT représentative dans l’entreprise, désigne deux délégués syndicaux au niveau de son unité économique et sociale (UES). Ces derniers ont été élus représentants du personnel sur une liste CGT ayant obtenu 19,8% des voix au 1er tour des élections professionnelles organisées en 2012 au sein de l’UES de Natixis.
Dans son pourvoi en cassation, le syndicat CGT NAM considère qu’il peut bénéficier des suffrages obtenus par la CGT en 2012 et désigner des délégués syndicaux dès lors que la confédération CGT ne s’y est pas opposée et qu’il est le seul à disposer d’une section syndicale de celle-ci au sein de l’entreprise.
La Cour de cassation estime quant à elle, logiquement, que le syndicat CGT NAM ne pouvait pas procéder à des désignations de délégués syndicaux puisque ce dernier n’avait pas participé aux élections professionnelles marquant le début du cycle électoral.
La représentativité est attachée au syndicat l’ayant obtenue aux dernières élections et ce, pour l’ensemble du cycle électoral. Il est opportun d’être vigilant dans les désignations faites mais également de privilégier les regroupements et affiliations lors du renouvellement de l’instance.
Malek SMIDA
Au regard des textes, il semble que doivent être mises en place au sein du CSE central :
- Une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail centrale, dans les entreprises d’au moins 300 salariés (article L.2316-18 du Code du travail) ;
- Une Commission économique, dans les entreprises d’au moins 1.000 salariés (article L.2315-46 du Code du travail : « En l’absence d’accord (…), dans les entreprises d’au moins mille salariés, une commission économique est créée au sein du comité social et économique ou du comité social et économique central ») ;
- Une Commission des marchés a priori, sous réserve de remplir les conditions légales d’instauration d’une telle commission : cela peut se déduire de l’article L.2316-19 du Code du travail étant toutefois relevé que pour indiquer semble-t-il que les règles de la commission des marchés sont applicables au CSE central, cet article L.2316-19 précité fait un renvoi vers les dispositions du « sous-paragraphe 5 du paragraphe 3 de la sous-section 6 de la (…) section 3 » qui ont pourtant été abrogées par la loi de ratification…
A l’exception de ces commissions, la loi ne prévoit pas expressément que d’autres commissions doivent être constituées au sein du CSE central.
Cela étant, l’ordonnance n°2017-1386 prévoit qu’à défaut d’accord, sont mises en place au sein du CSE, dans les entreprises de 300 salariés et plus, les commissions ci-après :
- commission de la formation professionnelle ;
- commission d’information et d’aide au logement ;
- commission de l’égalité professionnelle.
Dans ce contexte, à notre sens, pour assurer un effet utile aux dispositions relatives aux commissions et plus généralement à la consultation du CSE central :
- les commissions imposées par la loi pour le CSE semblent devoir également être créées au sein du CSE central, si l’entreprise atteint les seuils requis ;
- si un ou plusieurs établissements atteignent des effectifs suffisants, les commissions devraient également être constituées au sein du ou des CSE d’établissement concernés (cf. Soc. 4 avril 1978, n° 76-13.410 : solution rendue à propos d’un comité d’établissement qui devrait être transposable au CSE d’établissement).
Ces points mériteraient d’être confirmés par des textes ultérieurs ou par la jurisprudence.
Le Code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. (article L.2141-5 du Code du travail)
considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. (article L.2141-5 du Code du travail)
En outre, le harcèlement moral est caractérisé par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (article 1152-1 du Code du travail)
A rappeler : Que cela soit en matière de discrimination ou de harcèlement moral, l’administration de la preuve est aménagée. Une fois que le salarié a établi des éléments de faits laissant présumer l’existence d’une discrimination ou d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’une discrimination ou d’un harcèlement et que sa décision se fonde sur des éléments objectifs étrangers. (articles L.1154-1 et L.1134-1 du Code du travail)
Dans cet arrêt, un salarié, délégué syndical puis représentant syndical au CE et au CHSCT de son entreprise, estime être victime de harcèlement moral et de discrimination de la part de son employeur en raison de son appartenance syndicale.
Pour reconnaitre la discrimination et le harcèlement, faute d’éléments objectifs apportés par l’employeur, la Cour de cassation a retenu les éléments suivants :
- L’affectation dans un local isolé de ses collègues
- La notification d’un avertissement suivi d’une procédure de licenciement avortée suite à la contestation par le salarié
- Des pressions et des menaces envers lui alors qu’il assistait une collègue en qualité de représentant syndical
- Une mise à pied disciplinaire jugée disproportionnée et annulée
- Deux procédures de licenciement que le ministre du travail avait refusé d’autoriser
Notre conseil : Chaque fois qu’une décision professionnelle semble guidée par l’exercice du mandat, il est opportun de chercher à réunir un maximum d’éléments écrits quitte à demander confirmation par écrit de propos tenus oralement. Cela peut permettre de préparer au mieux un éventuel contentieux mais également d’alerter l’employeur sur ses pratiques ou celles de ses représentants.
Le 1er août 2018, l’Assemblée nationale a définitivement adopté le projet de loi avenir professionnel visant à établir « une nouvelle société de compétences ». Cette loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019, comporte un volet créant de nouveaux droits à indemnisation pour les salariés démissionnaires. Pour en bénéficier, le travailleur doit remplir des conditions drastiques.
L’article L.5422-1 du Code du travail réservait alors l’allocation chômage aux « travailleurs involontairement privés d’emploi » et excluait chaque année du régime d’assurance chômage le million de salariés démissionnaires.
Modifié par la loi avenir professionnel, cet article ouvre désormais le régime d’assurance chômage aux travailleurs dont la privation d’emploi volontaire résulte d’une démission. Selon le gouvernement, 30 000 salariés par an pourraient être concernés par cette indemnisation.
Ces travailleurs doivent répondre à des conditions d’activité antérieure spécifiques (au minimum 5 ans de travail dans l’entreprise) et poursuivre un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou un projet de création ou de reprise d’une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
Avant de présenter son projet à la commission paritaire, le salarié est dans l’obligation de solliciter un conseil sur la validité de son plan de carrière auprès des institutions, organismes ou opérateurs de conseil en évolution professionnelle. Le nouvel article L. 5422-1-1 du Code du travail dispose que le travailleur salarié établit avec le concours de l’institution, de l’organisme ou de l’opérateur son projet de reconversion professionnelle (missions locales, association pour l’emploi des cadres, France compétences, organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées).
Avant de vous lancer dans un projet de reconversion professionnelle, nous vous conseillons de consulter la convention collective applicable à votre entreprise qui, parfois, peut prévoir une indemnité de départ en cas de démission. Votre convention collective vous indiquera également la durée du préavis de démission que vous devrez respecter.
Malek SMIDA
Il y a deux ans, nous vous éclairions sur votre droit à la déconnexion pendant vos vacances (Plume Eté 2017). Aujourd’hui, nous nous penchons sur une autre difficulté rencontrée par certains salariés : celle de devoir revenir travailler pendant leurs congés payés.
Si votre employeur souhaite modifier les dates de départ en vacances de ses salariés, il doit, pour cela, respecter les délais inscrits dans votre accord d’entreprise, d’établissement ou, à défaut, dans votre convention ou accord de branche. Si aucun délai n’a été négocié, c’est la loi qui s’applique.
L’article L3141-16 du Code du travail dispose que l’ordre et les dates de départ en vacances fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date de départ prévue, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Par conséquent, confronté à une situation inhabituelle, votre chef d’entreprise peut vous demander, au dernier moment, de retarder votre départ en congés, voire de revenir accomplir votre mission alors même que vous vous trouvez en vacances. Votre employeur doit alors motiver les raisons de son rappel.
A défaut d’une définition légale, c’est la jurisprudence qui a délimité ces circonstances exceptionnelles. Cette dernière s’est majoritairement prononcée sur des cas de salariés refusant de reporter leurs vacances. Selon nous, a fortiori, ces circonstances exceptionnelles peuvent également s’appliquer dans l’hypothèse du rappel de salariés pendant leurs congés.
Ainsi, les juges considèrent que l’employeur peut modifier les dates de congés d’un salarié sans respecter le délai de prévenance d’un mois lorsque l’entreprise fait face à de graves difficultés financières (CE 11 février 1991, n°68058), ou encore lorsqu’il est nécessaire de remplacer un salarié brutalement décédé (Cass. Chambre sociale, 15 mai 2008, n° 06-44354).
En revanche, une intervention urgente ne peut pas constituer une circonstance exceptionnelle lorsqu’elle fait partie de l’activité courante de l’entreprise (CA Aix-en-Provence, 24 juin 1997, n°1248).
Si votre entreprise doit faire face à une circonstance exceptionnelle, nous vous déconseillons de refuser un retour au travail. En effet, un refus vous exposerait alors à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave. En cas de doute sur le fait que votre entreprise soit confrontée à une situation inhabituelle, il peut être opportun de poser la question à vos instances représentatives du personnel.
En cas de conflit sur les raisons avancées par l’employeur, seul le juge pourra déterminer si ces dernières justifiaient le rappel du salarié.
Tout salarié a droit chaque année à des congés payés à la charge de l’employeur. L’article L.3141-3 du Code du travail fixant la durée de ces congés est une règle d’ordre public. La jurisprudence considère qu’il appartient à votre employeur de prendre les mesures propres à assurer à ses salariés la possibilité d’exercer effectivement leur droit à congé (Cass. sociale, 13 juin 2012, n°11-10.929).
En acceptant de revenir travailler pendant vos congés, vous êtes donc en droit de bénéficier du reliquat des congés payés que vous n’avez pas pu prendre. Si votre employeur refuse de vous les accorder, cela constitue un préjudice ouvrant droit à des dommages-intérêts (Cass. sociale, 6 mai 2002, n° 00-43655).
La Cour de cassation estime également que les frais de déplacement qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés (Cass. soc. 25 février 1998 n° 95-44.096 ; Cass. soc., 25 mars 2010, n° 08-43.156).
En conséquence, vous êtes en droit de solliciter le remboursement intégral des frais de transport depuis votre lieu de vacances.
Nous vous conseillons également de consulter la convention collective applicable à votre entreprise qui, parfois, peut prévoir des compensations dans l’hypothèse d’un retour anticipé de congés payés, comme par exemple, des jours de congés supplémentaires.
Malek SMIDA
Le 23 mai 2018, le TGI de Paris a rendu une décision incluant les suppléants et les représentants syndicaux au décompte des membres permettant la tenue d’une réunion extraordinaire du comité d’entreprise.
L’article L. 2325-14 du Code du travail dispose que le comité d’entreprise peut solliciter la tenue d’une réunion extraordinaire « à la demande de la majorité de ses membres ». Cependant, la jurisprudence ne s’était alors jamais prononcée sur la qualité de ces membres. S’agit-il uniquement des membres titulaires et suppléants ou les représentants syndicaux peuvent aussi s’exprimer ?
Le TGI de Paris fait la distinction entre deux hypothèses :
La demande de réunion extraordinaire ne nécessite pas la tenue d’une réunion du CE. La condition de majorité de cette demande ne peut donc s’apprécier de la même manière que pour le vote des résolutions.
En l’espèce, bien que remise au président lors d’une réunion du CE, cette demande de réunion extraordinaire ne pouvait être assimilée à une résolution. En effet, elle n’a pas été soumise au vote et il n’a été demandé à aucun membre titulaire de se prononcer individuellement sur cette demande.
Le TGI a rendu une décision inédite qui renforce le rôle des suppléants et des représentants syndicaux au sein du CE : Le fait que les suppléants et les représentants syndicaux n’aient qu’une voix consultative ne les privent pas du droit de solliciter une réunion extraordinaire.
Les délégués du personnel, avaient, avant la réforme (« ordonnances Macron »), pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail, et des autres dispositions légales concernant la protection sociale et les conventions et accords applicables dans l’entreprise.
Les ordonnances qui ont réformé le code du travail, et qui ont créé le CSE, soulignent que ce dernier reprend pour l’essentiel les attributions des délégués du personnel. Mais qu’en est-il aujourd’hui des dispositions propres à cette procédure ?
Pour les entreprises de moins de 50 salariés, le code du travail précise que cette attribution spécifique auparavant attribuée aux délégués du personnel, est désormais une prérogative attribuée aux membres de la délégation du personnel du CSE. L’article 2315-22 énonce ainsi en ces termes « Sauf circonstances exceptionnelles, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique remettent à l’employeur une note écrite exposant l’objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.
L’employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.
Les demandes des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les réponses motivées de l’employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.
Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés de l’entreprise désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail ».
Toutefois aucune disposition n’aborde le cas des entreprises de plus de 50 salariés.
Du silence des textes, certains voudraient déduire qu’il n’existerait plus de registre spécial au-delà de 50 salariés.
Ce n’est pas notre lecture. D’une part car la philosophie du dispositif et son efficacité passe à notre sens par l’existence d’une procédure et d’outils spécifiques. D’autre part, car en l’absence de précision de l’administration ou de la jurisprudence, il est judicieux de conserver un registre spécial pour les réclamations et les réponses de la direction, dans les entreprises de plus de 50 salariés. Aussi nous vous invitons à être vigilants sur ce thème et à pérenniser le dispositif dans les entreprises de plus de 50 salariés dans le cadre des accords de mise en place du CSE.
C’est notamment ce qu’a fait la MAIF dans son accord CE du 30 avril dernier, en créant une commission d’application des textes, qui reprend la mission des délégués du personnel, et notamment celle relative au registre spécial.
Du 11 septembre au 18 octobre 2018, Atlantes reviendra pour une nouvelle saison de salons CE/CSE à Paris et en région (Lille, Lyon, Nantes, Rouen, Limoges, Annecy, Orléans, Toulouse, Valence, Saint-Etienne, Marseille et Dijon).
Pour cette rentrée, le CSE sera au cœur de toutes les discussions, venez donc nous rencontrer pour découvrir nos prestations d’accompagnement/de conseil et participez à nos conférences sur le sujet.
Un format inédit de conférence-échange « A vous la Parole » vous permettra d’interagir sur le CSE avec un binôme de juriste/avocat lors du salon de Paris à Porte de Versailles.
Plus d’information à venir.
Depuis une vingtaine d’années, nombreux sont les dispositifs légaux relatifs à l’égalité femmes-hommes (Loi Génisson de 2001, Décret du 18 décembre 2012 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes visant à combattre les inégalités entre hommes et femmes dans les sphères privée, professionnelle et publique, Loi Travail introduisant l’exigence de proportionnalité femmes/hommes dans le cadre des élections professionnelles et l’égalité comme thème de négociation obligatoire,…).
D’expérience, avez-vous constaté dans les entreprises des évolutions notables ? Pensez-vous que le sujet soit devenu concrètement un thème de négociation collective ?
Axelle Martini : Vous rappelez l’historique juridique « récent » et les nombreux dispositifs successifs et vous avez raison : ce thème est un vrai « serpent de mer » sans cesse repris. Qui se souvient que l’article 2 du Traité de Rome garantissait déjà en 1957 une « égalité de rémunération entre travailleurs masculins et féminins pour un même travail ou un travail de même valeur » ? L’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes a été inscrite dans notre Code du Travail dès 1972 et le rapport annuel de situation comparée dès 1983 !
Pourquoi tant de difficultés à envisager et résoudre ce problème ?
A-M : Parce que le sujet est loin d’être simple. Il touche directement à nos représentations et à notre culture. En effet, qu’est-ce qui va déterminer que tel travail a davantage de « valeur » que tel autre ? Qu’est-ce qui va définir qu’il est légitime de rémunérer davantage tel poste plutôt que tel autre ? Par exemple, si les contraintes physiques ou les disponibilités horaires sont davantage valorisées, alors les métiers plus « masculins » seront davantage rémunérés par rapport à des métiers où de grandes qualités relationnelles sont attendues, mais moins valorisés. D’où un premier écart entre les métiers « plus féminins » et les métiers « plus masculins ».
Et même au sein d’un même métier, l’écart femme-homme se ressent dès le recrutement par crainte de l’arrêt maternité, de l’implication maternelle au sein du foyer, d’une moins grande disponibilité…
Il y a donc encore beaucoup de travail : faire évoluer une problématique aussi ancrée dans la culture demande du temps et de la persévérance.
Lors d’expertises, notre travail d’analyse des écarts de rémunération a permis de mettre le doigt sur des écarts au sein d’un même métier et de construire un argumentaire pour débloquer une enveloppe supplémentaire à celle des NAO, spécifiquement dédiée à la réduction des écarts de rémunération. Dans d’autres, notre analyse a permis d’identifier des problématiques d’organisation du travail ou de gestion des carrières. Nous avons pu accompagner la mise en place de groupes de travail pour construire des préconisations adaptées qui prennent en compte les contraintes liées à la parentalité… qui n’est bien sûr pas un enjeu exclusivement féminin.
Les ordonnances ont renforcé les outils à disposition des organisations syndicales pour préparer la négociation sur l’égalité professionnelle : le CSE peut désormais nommer un expert pour l’accompagner dans le cadre de cette négociation. Au sein de Secafi, nous sommes en train de développer une offre au niveau national pour répondre au mieux à ce nouveau cadre.
D’expérience, quelles sont les manifestations les plus importantes de ces inégalités (inégalités salariales, temps partiels contraints, stagnation de l’évolution professionnelle, absence des postes à responsabilité/ de décision…) ?
A-M : Vous citez l’essentiel des problèmes. La précarité des femmes – en particulier pour les jeunes femmes - et les temps partiels contraints sont les points les plus criants et les plus difficiles à faire évoluer.
Chez certains clients, nous avons pu mettre en évidence le coût de la précarité et contribuer à une prise de conscience côté Direction. La difficulté est bien d’arriver à ce que la Direction prenne d’abord conscience du problème, puis accepte de le traiter, et enfin le traite. Cela peut prendre du temps, d’où l’intérêt de la récurrence de nos interventions, année après année, pour faire avancer les choses. Car il s’agit là de travailler à la fois la représentation culturelle et l’organisation du travail… une approche par les coûts, telle que nous la portons dans notre expertise annuelle dans le cadre de la consultation sur la politique financière, reste souvent l’argument de départ. L’approche socio-organisationnelle vient ensuite : diagnostic organisationnel, groupes de travail, analyse sociale... sont des leviers que nous utilisons davantage dans l’expertise « politique sociale et conditions de travail ».
La question de l’évolution professionnelle mérite d’être mieux explorée : une évolution de carrière professionnelle implique-t-elle toujours une évolution vers des postes à plus grande amplitude horaire ? L’évolution vers le management est-elle la seule possibilité de carrière ? Certaines femmes ne se reconnaissent pas dans les contraintes auxquelles se trouvent confrontés les cadres à responsabilités. Nous préconisons une gestion des carrières qui intègre aussi la possibilité de choisir des parcours d’évolution « horizontaux » et qui reconnaissent davantage les expertises.
N’oublions pas non plus les problématiques de harcèlement sexuel souvent liées à des situations de « domination masculine » renforcées par un lien hiérarchique ou décisionnel : certaines femmes sont confrontées à des situations de travail inimaginables ! Fort heureusement, la parole se libère désormais. Il est tout à fait essentiel d’en profiter pour intégrer ces thématiques à la négociation sur l’égalité professionnelle.
On constate un nombre peu important de procédures pour discrimination et/ou rupture d’égalité liées au sexe. Selon vous, que cela nous dit-il ? Est-ce lié aux difficultés d’une procédure (durée, technicité, coût, charge de la preuve, peur des conséquences…) ?
A-M : N’y a-t-il pas de la part des femmes une part d’autocensure ? La culture ambiante et le fameux « plafond de verre » n’ont-ils pas tendance à leur faire tout simplement admettre cet écart de rémunération et de parcours professionnel ?
Depuis le 1er janvier 2018, et administrations islandaises et les entreprises de plus de 25 salariés doivent obtenir une certification afin de prouver qu’à travail égal, elles versent le même salaire aux deux sexes. A terme, les entreprises qui n’auront pas obtenu cette certification pourront se voir infliger une amende de 50 000 couronnes (400 euros) maximum par jour. Ce dispositif est-il, selon vous, envisageable en France ?
A-M : Nous avons évoqué la difficulté de définir ce qu’était un « travail de valeur égale » et l’impact du contexte culturel pour la construction de cette définition.
En France, le projet de loi « Avenir professionnel » prévoit de sanctionner par une amende les entreprises dans lesquelles un écart non expliqué persisterait en 2022. Cela pourra contribuer à faire évoluer les choses… car si cette « menace » existe déjà en cas d’absence d’accord égalité ou de plan d’action, la nouveauté réside dans l’obligation de « résultat ».
Oui, mais quel résultat ?
Tout l’enjeu réside dans le choix des indicateurs : nous attendons un décret qui les précisera. Au sein d’un même métier, la tentation sera grande de définir un maximum de variables qui justifieront par « A + B » les différences de rémunération entre les hommes et les femmes.
Ainsi, selon les indicateurs retenus, l’obligation de « résultat » pourra être remplie alors même que rien n’aura changé, puisque les indicateurs permettront d’expliquer tous les écarts observés.
Le futur décret nous permettra de voir si, en fonction des indicateurs retenus ou laissés à la libre appréciation des entreprises, le dispositif français est suffisamment ambitieux pour vraiment permettre de diminuer les écarts de rémunération ou s’il servira finalement à davantage justifier les écarts existants… au risque de renforcer l’acceptation des femmes et de normaliser encore un peu plus la situation actuelle.
L’idée islandaise d’exiger des entreprises d’obtenir une certification tous les 3 ans est plus ambitieuse… Notre culture latine a encore du chemin à faire…
Pour en savoir plus sur ce sujet, rendez vous sur la Plume de l’alouette du mois de juin, et son dossier spécial sur l’égalité Femmes/Hommes dans le monde du travail.
Dans le numéro de février dernier de la Plume de l’alouette, l’équipe d’Atlantes revenait sur les motifs de licenciement, et les droits des salariés à cet égard. Avant l’été, retrouvez quelques conseils avertis de nos juristes !
Selon une jurisprudence constante, les limites du litige étaient fixées par les motifs énoncés dans la lettre de licenciement : après l’envoi de la lettre, l’employeur ne pouvant plus ajouter de nouveaux motifs de licenciement.
Désormais, la fixation des limites du litige peut être différée après la notification du licenciement. En effet, les motifs contenus dans la lettre pourront être précisés par l’employeur, soit de sa propre initiative soit à la demande du salarié, après la notification du licenciement dans certaines conditions (Article L. 1235-2 du Code du travail).
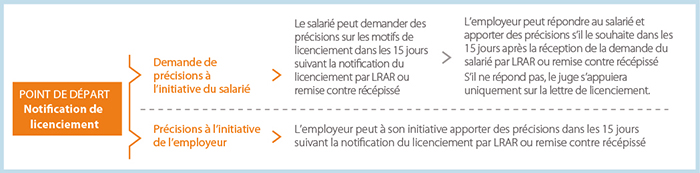
La demande de précisions formulée par le salarié emporte des conséquences sur la qualification du licenciement pour cause réelle et sérieuse en cas d’insuffisance de motivation et, donc, sur les indemnités qu’il percevra. Le salarié devient donc acteur dans la défense de ses droits.
Le schéma ci-dessous est basé sur l’hypothèse selon laquelle la lettre de licenciement a été insuffisamment motivée par l’employeur et a été considérée comme telle par le juge. Il permet de visualiser les conséquences indemnitaires pour le salarié lorsqu’il avait pris le soin de demander des précisions à l’employeur et lorsqu’il s’est abstenu de le faire.
Etre réactif et prendre conseil, telles sont nos préconisations pour savoir s’il vous faut demander des précisions ou non !
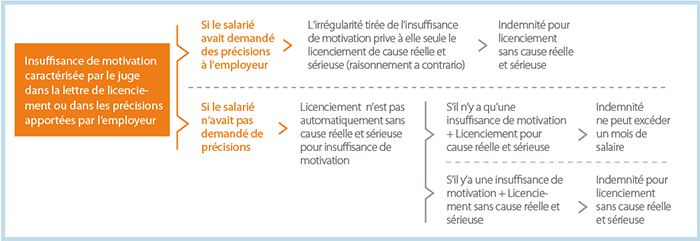
Marie VILLENEUVE, Juriste
 Il y a un an, on vous parlait de de l’impact des réseaux sociaux sur les relations de travail (Plume Eté 2017). Alors avant l’été, Atlantes vous rapelle quelques conseils sur la protection de votre vie privée au travail et l’utilisation de ces réseaux.
Il y a un an, on vous parlait de de l’impact des réseaux sociaux sur les relations de travail (Plume Eté 2017). Alors avant l’été, Atlantes vous rapelle quelques conseils sur la protection de votre vie privée au travail et l’utilisation de ces réseaux.
Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, Youtube, LinkedIn, ...
En 2016, l’étude ORFEO sur 6 pays européens dont la France, a évalué à partir des journaux de connexion des entreprises que les salariés « surferaient » environ 1h15 à titre personnel sur leur lieu de travail (contre 50 min en 2014).
L’émergence des réseaux sociaux a bouleversé les relations de travail. Si la jurisprudence a eu à traiter de la sanction des propos tenus sur la toile hors temps de travail et de l’usage des réseaux sociaux pendant le temps de travail, de nouvelles problématiques apparaissent et restent encore sans réponse : consultation des réseaux sociaux par le recruteur, usage des smartphones pendant le temps de travail, incitation par les managers à utiliser les réseaux sociaux comme outil professionnel. Face à ces nouveaux enjeux, il est indispensable que les salariés adoptent les bons réflexes.

En 2015, 69% des recruteurs auraient consulté les réseaux sociaux pour vérifier les informations contenues dans le CV* , ou glaner des informations personnelles sur eux. Le risque de discrimination est donc bien réel et la preuve en la matière difficile à apporter.


La question du contrôle des propos et échanges impliquant l’entreprise et des conséquences pouvant en résulter (sanction, licenciement, poursuites pénales pour injure et diffamation) est complexe. Elle met en jeu la liberté d’expression des salariés dans l’entreprise et hors de celle-ci, dont on sait qu’elle leur permet de s’exprimer sur l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise et sur leurs conditions de travail à condition de ne pas commettre d’abus et de ne pas violer leurs obligations de discrétion et de loyauté.
Elle conduit à s’interroger sur la légitimité du contrôle de l’employeur, pour des propos souvent tenus hors temps et lieu de travail sur une page du réseau personnel du salarié. Un tel accès est-il compatible avec le respect de la vie privée et en particulier le secret des correspondances privées ? Comment déterminer si ces propos ont été diffusés sur un espace public ou privé ? Force est de constater que les frontières sont fines entre ces 2 notions et que les juges du fond adoptent des solutions divergentes résumées ci-dessous :
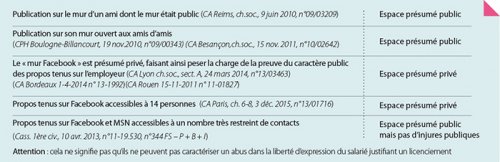


Il a été jugé à de nombreuses reprises qu’un usage abusif d’internet à des fins personnelles sur le temps de travail pouvait être sanctionné voire justifier un licenciement : faute grave pour être resté connecté, à des fins personnelles, 41 heures en un mois (Cass. soc. 18 mars 2009, n°07-44.247) ou encore lorsque les connections sur internet et réseaux sociaux, pour raisons personnelles, dépassent 20% du temps de travail du salarié (CA Rennes, 7e ch., 20 nov. 2013, n°12/03567). En revanche, n’a pas été jugé fautif le salarié qui consacrait un temps limité à l’envoi de tweets non professionnels (environ 4 minutes par jour) pendant ses heures de travail (CA Chambéry, ch. soc., 25 févr.2016, n°15/01264).

Mais attention, la tentation d’utiliser son smartphone au travail n’est pas sans risque : l’employeur pourra toujours reprocher au salarié le travail non exécuté ou le manque de productivité. |
par Lise BIANNIC, Juriste
La Cour, en revenant sur sa jurisprudence antérieure, dévoile une nouvelle conception de l’égalité de traitement en matière de CDD et CDI. En substance, elle considère dorénavant que le salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée est préparé à la rupture de son contrat, contrairement au salarié titulaire, lui, d’un contrat à durée indéterminée, pour lequel la rupture du contrat est soudaine et imprévisible. Ainsi, ces deux types de salariés sont dans des situations différentes, justifiant un traitement différent, et donc une indemnisation de fin de contrat différente.
Annoncée comme l’une des mesures phare et symbolique dans son programme lors de l’élection présidentiel, Emmanuel Macron et son gouvernement reviennent aujourd’hui sur l’assurance chômage universelle ouvrant la possibilité aux salariés démissionnaires de s’inscrire au Pôle emploi et d’en percevoir les allocations.
Pour mémoire, le processus de réforme du droit du travail est notamment justifié par la volonté d’adapter le droit du travail aux impératifs de sécurité de l’employeur, condition pour ce dernier d’une politique d’embauche. Le pendant de cette flexibilité devait être équilibré par une sécurité et un accompagnement accrus des travailleurs, notamment dans le cadre de leur parcours professionnel et de formation.
Aussi, en revenant sur cette mesure de l’assurance chômage universel, pour raisons essentielles budgétaires, c’est cet équilibre qui est touché.
Sans revenir sur l’idée d’une assurance chômage, celle-ci perd toute illusion d’universalité. En voulant limiter la facture, le gouvernement réduit de manière drastique les potentiels bénéfices du dispositif.
Le TGI de Nanterre statuant en référé, a dans deux arrêts récents, suspendu la procédure de consultation sur la cession de la société Mobitel par Free, et le plan de sauvegarde de l’emploi de Coca Cola.
Le juge des référés refuse de suspendre la cession et le plan de sauvegarde de l’emploi en estimant qu’il n’appartenait pas "aux juges des référés de suspendre un projet de cession", laissant ainsi au juge du fond le soin de statuer à ce sujet. Il affirme néanmoins que le comité d’entreprise doit être consulté sur les orientations stratégiques avant de lancer la consultation sur le projet de cession ou sur le PSE. Ainsi, dans ces deux ordonnances, le juge des référés suspend les procédures de consultation, en attendant la décision du juge du fond qui interviendra d’ici septembre.
 Atlantes vient d’obtenir devant la cour d’appel de Versailles, un arrêt très favorable aux intérêts des comités d’établissement en date du 7 juin dernier.
Atlantes vient d’obtenir devant la cour d’appel de Versailles, un arrêt très favorable aux intérêts des comités d’établissement en date du 7 juin dernier.
Dans cette affaire, la direction d’une entreprise à structure complexe (un comité central d’entreprise et des comités d’établissement), s’opposait au recours à expertises par un de ses comités d’établissement, en vue de sa consultation sur la situation économique et financière, d’une part, et de celle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, d’autre part.
En vain.
La cour d’appel de Versailles a en effet débouté la direction de sa demande d’annulation de tels recours à expertise par le comité d’établissement – en retenant l’intégralité de l’argumentaire du comité.
A l’appui de son arrêt très motivé du 7 juin 2018, la Cour relève en particulier que :
« Il résulte tant de la lettre que de l’esprit du texte que la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi n’a pas modifié les compétences respectives du comité central d’entreprise et du comité d’établissement en matière de consultations annuelles récurrentes.
Il s’ensuit qu’en application de la loi du 17 août 2015 le comité d’établissement conserve ses prérogatives antérieures en termes d’information et de consultation telles que précisées par la jurisprudence antérieure selon laquelle le droit du comité central d’entreprise d’être assisté pour l’examen annuel des comptes de l’entreprise dans les conditions prévues par l’article L.2323-8 du code du travail, ne prive pas le comité d’établissement du droit d’être assisté par un expert-comptable chargé de lui fournir tous éléments d’ordre économique, social et financier nécessaires à la compréhension des documents comptables de l’établissement et à l’appréciation de sa situation » (CA VERSAILLES, 7 juin 2018).
Amélie Klahr : Pour être valide l’accord d’entreprise doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives (OSR) ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’OSR au premier tour des dernières élections professionnelles. Cependant, si les OSR signataires ne représentent que 30 % des suffrages, une ou plusieurs d’entre elles peuvent demander, dans un délai d’un mois, un référendum visant à valider l’accord. À l’issue de ce délai, l’employeur peut à son tour demander la tenue d’un référendum, à condition toutefois qu’aucune OSR signataire ne s’y oppose. Huit jours après la demande des OSR ou l’initiative de l’employeur, si aucune éventuelle signature d’autre OSR n’a permis d’atteindre le taux de 50 %, la consultation des salariés doit alors être organisée sous 2 mois.
AK : Depuis le 1er janvier 2017, pour les accords portant sur la durée du travail, les repos et les congés, et depuis le 1er mai pour les autres accords.
AK : Non. La règle des 50 % est stricte (pas de possibilité de consultation des salariés en cas de signatures représentant seulement 30 % des suffrages) pour les accords de Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) et ceux qui mettent en place le Conseil d’entreprise. Elle s’applique aussi aux accords traitant du nombre d’établissements distincts, de la reconnaissance d’une Unité économique et sociale, de la mise en place des représentants de proximité, d’une commission CSSCT en dessous de 300 salariés ou de commissions supplémentaires, du nombre de réunions du CSE et du délai de consultation du CSE. Enfin, le protocole d’accord préélectoral (PAP) reste soumis aux règles particulières d’unanimité ou de double majorité en voix et en nombre d’OSR signataires, selon les sujets de négociation.
 Il résulte de l’article L 4614-13 du Code du travail issu de la loi Travail du 8 août 2016 que l’employeur dispose d’un délai de 15 jours à compter de la délibération du CHSCT pour contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise, le devis, l’étendue ou le délai de l’expertise. Or, pour la contestation du coût prévisionnel de l’expertise, la délibération du CHSCT, comme point de départ du délai de 15 jours, pose problème puisque cette délibération ne contient pas obligatoirement ce coût.
Il résulte de l’article L 4614-13 du Code du travail issu de la loi Travail du 8 août 2016 que l’employeur dispose d’un délai de 15 jours à compter de la délibération du CHSCT pour contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise, le devis, l’étendue ou le délai de l’expertise. Or, pour la contestation du coût prévisionnel de l’expertise, la délibération du CHSCT, comme point de départ du délai de 15 jours, pose problème puisque cette délibération ne contient pas obligatoirement ce coût. Cet arrêt de la Cour de cassation vient, ainsi, clarifier la situation en précisant que si la dé- libération du CHSCT contient le coût pré- visionnel, l’employeur a 15 jours, à compter de ce jour, pour le contester. Dans le cas contraire, l’employeur a 15 jours, à compter de la notification du devis de l’expert, pour contester l’expertise. Cette décision est applicable aux expertises encore décidées par les CHSCT et aux contentieux en cours. Après passage en CSE, l’employeur disposera de 10 jours, à compter de la notification du coût prévisionnel par l’expert, pour le contester devant le tribunal. L’expert a, quant à lui, 10 jours à compter de la délibération du CSE décidant du recours à l’expertise pour notifier ce coût prévisionnel.
 Dans cet arrêt, la Cour de cassation a jugé que, dès lors que « l’employeur n’a pas mis à disposition (du CE) la base de données économiques et sociales rendue obligatoire par l’article L. 2323-7-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable (…), le délai de consultation n’a pu courir ».
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a jugé que, dès lors que « l’employeur n’a pas mis à disposition (du CE) la base de données économiques et sociales rendue obligatoire par l’article L. 2323-7-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable (…), le délai de consultation n’a pu courir ». Cette décision des magistrats peut aisément s’expliquer du fait que le point de départ du délai de consultation est censé commencer à courir à compter de la communication ou de la mise à disposition des documents aux élus. Or, la BDES étant, d’après la loi, le « support de préparation » à la consultation relative aux orientations stratégiques, le délai de consultation ne peut commencer à courir, faute de BDES mise à disposition des élus.
On peut s’interroger sur le point de savoir si cette décision pourra être étendue au CSE, et aux deux autres consultations récurrentes du CE, à savoir la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et la consultation sur la politique sociale.
Plusieurs arguments plaident en ce sens, mais une confirmation de la Cour de cassation serait la bienvenue :
 Le Règlement Européen n° 2016/679 du 27 avril 2016 déclare que : « la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental ». Ce règlement relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, qui abroge la directive 95/46/CE, est applicable à partir du 25 mai 2018.
Le Règlement Européen n° 2016/679 du 27 avril 2016 déclare que : « la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental ». Ce règlement relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, qui abroge la directive 95/46/CE, est applicable à partir du 25 mai 2018.
Ce nouveau règlement s’applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier.
Cela signifie que dès lors que vous collectez des données personnelles de salariés dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturelles, de manière automatisée, ou de manière non-automatisée mais devant figurer dans un fichier, vous êtes concernés par ces nouvelles règles. Vous le serez également si votre CE/CSE est employeur (données des salariés employés).
Les règles à respecter sont sensiblement les mêmes qu’auparavant. Il y a toutefois quelques modifications :
Qui a pour mission de déterminer et mettre en place les mesures « techniques et organisationnelles » nécessaires pour assurer la confidentialité des données personnelles des employés afin d’éviter toute divulgation. Cette personne, pas nécessairement salarié de l’entreprise, aura notamment pour mission d’informer, de conseiller, de contrôler la conformité des traitements.
Ainsi, dans le cadre de ses activités sociales et culturelles (ASC), le CE/CSE devra :
- Donner aux salariés les informations suivantes :
o l’identité et les coordonnées du responsable de traitement des justificatifs collectés (en principe le secrétaire ou le trésorier) ;
o le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données (DPO) ;
o les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que le fondement juridique du traitement (activités sociales et culturelles prévues à l’article L. 2323-83 du Code du travail) ;
o le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel ;
o la durée de conservation des données (à définir par le CE/CSE mais cela doit correspondre temps nécessaire à l’attribution des ASC) ;
o le droit d’accès aux données les concernant dans le délai d’un mois et de rectification de ces données ;
o le droit du salarié de retirer son consentement à tout moment ;
o le droit du salarié d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
- Leur demander individuellement leur consentement à fournir ces données personnelles (par écrit papier ou par voie électronique). Il faudra alors préciser au salarié qu’il peut accepter ou refuser de fournir ces données. Il faudra lui préciser les conséquences en cas de refus, comme par exemple le fait de perdre le tarif réduit auquel il aurait pu prétendre ou/et qu’il se verra appliquer la tranche haute de rémunération pour le paiement des cotisations. Il devra également être informé du fait qu’il pourra retirer son consentement à tout moment. Dans ce cas, les conséquences seront les mêmes qu’en cas de refus (perte du tarif réduit, assiette de cotisations sur la tranche haute …)
- Mettre en place une procédure de demande d’accès aux données personnelles. Cette procédure doit au maximum être d’une durée d’un mois. Elle pourrait se faire par courriel auprès du responsable du secrétaire et/ou du trésorier du CE/CSE. Cela suppose que le CE/CSE ait communiqué au préalable aux salariés le courriel de cette personne et ait précisé sous quelles modalités doit se faire la demande.
La procédure peut être la suivante :
Le trésorier ou le secrétaire s’engage à y répondre dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
Enfin, un projet de loi sur le RGDP est en cours de discussion au Parlement. Etant donné que le RGPD est un règlement européen, s’appliquant directement, et sans transposition en droit interne, ce projet de loi n’a vocation qu’à préciser certaines dispositions dudit règlement.
 Dans deux arrêts du 9 mai 2018, la Cour de cassation apporte pour la première fois depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 2017 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 des précisions sur « la marge de liberté laissée aux organisations syndicales dans la constitution de leurs listes de candidats aux élections professionnelles ». A cette occasion, elle revient notamment sur les règles en matière d’égalité femme/homme à l’occasion des élections professionnelles.
Dans deux arrêts du 9 mai 2018, la Cour de cassation apporte pour la première fois depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 2017 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 des précisions sur « la marge de liberté laissée aux organisations syndicales dans la constitution de leurs listes de candidats aux élections professionnelles ». A cette occasion, elle revient notamment sur les règles en matière d’égalité femme/homme à l’occasion des élections professionnelles. Atlantes revient sur les apports de ces jurisprudences.
Un protocole préélectoral, fut-il signé à l’unanimité, qui ne comporte qu’un simple engagement non contraignant des syndicats visant « à rechercher les voies et les moyens qui permettraient de parvenir le plus possible à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes sur les listes de candidats » est contraire à l’ordre public et peut fonder à contester l’élection des candidats dont la présentation ne respecte pas les obligations relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes
La sanction de l’annulation de l’élu dont le positionnement sur la liste ne respecte pas l’obligation d’alterner successivement un candidat de chaque sexe (jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes) connait une exception lorsque la liste correspond à la proportion de femmes et d’hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats ont été élus.
Quand bien même l’art. L.2314-30 du Code du travail disposerait que « Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L.2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale… ».
Une organisation syndicale ne peut, au motif que celle-ci présente un seul candidat alors que deux sièges étaient à pourvoir, se dispenser de respecter les règles relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes. Dans cette affaire, le nombre de sièges à pourvoir était de 2 et la proportion d’hommes de 23% et de femmes de 77%.
La Cour en déduit que la liste aurait dû nécessairement comporter une femme mais en outre au moins un homme en se référant à une décision du Conseil constitutionnel (Décision n°2017-686 QPC du 19 janvier 2018) considérant que l’application de la règle de l’arrondi ne saurait faire obstacle à ce que la liste de candidats puisse comporter un candidat du sexe sous représenté dans le collège électoral.
Faut-il pour autant en déduire qu’une liste qui aurait présenté deux femmes aurait été illégale ?
Ne manquez pas le prochain n° de la Plume de l’Alouette (publication mensuelle d’ATLANTES), qui revient ce mois-ci sur les différents thèmes de l’égalité femmes hommes !
 La réponse n’est pas évidente et va dépendre de plusieurs paramètres et notamment du décompte des jours de congé (décompte en jours ouvrés ou ouvrables).
La réponse n’est pas évidente et va dépendre de plusieurs paramètres et notamment du décompte des jours de congé (décompte en jours ouvrés ou ouvrables).Le jour férié n’est pas comptabilisé dans le nombre de jours de congé à poser :
Le jour férié n’est pas comptabilisé dans le nombre de jours de congés à poser :
Pour en savoir plus sur les jours fériés, c’est par ici : Plume de l’alouette, mai 2018 : Vrai/Faux, Les jours fériés.
Parfaitement réguliers, ces contrats avaient été conclus pour remplacer divers salariés absents pour cause de maladie, maternité ou encore congés payés. Elle demande la requalification de ces contrats en CDI. La Cour d’appel applique la solution apportée jusqu’alors par la Cour de cassation : elle rappelle que la mise en œuvre de CDD successifs ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, conformément à l’article L. 1242-1 du Code du travail et requalifie ainsi les contrats de la salariée en CDI.
La Cour de cassation décide, quant à elle, d’adopter une position plus souple. Elle souligne qu’une entreprise ayant un effectif important doit inévitablement procéder à des remplacements temporaires de façon fréquente (congés maladie, maternité, parentaux, etc.). Dès lors, « le seul fait pour l’employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des CDD de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d’œuvre et pourvoir ainsi durablement à un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».
En d’autres termes, lorsque son effectif est suffisamment important, une entreprise peut confier à un même salarié plusieurs CDD correspondant à plusieurs remplacements consécutifs sans forcément que la requalification en CDI soit encourue. La Chambre sociale se calque sur la solution de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), rendue le 26 janvier 2012 (CJUE, 26 janv. 2012, aff. C-586-10). Selon cette dernière, l’utilisation – de manière récurrente ou permanente – des CDD de remplacement ne signifie pas que les CDD ne reposent pas sur une raison objective, ni qu’ils sont abusifs. Et ce, même si ces remplacements auraient pu être couverts par l’embauche d’un salarié en CDI.
S’il ressort de cette étude que les entreprises françaises sont en progrès sur un certain nombre de points, elle démontre également le manque de moyen et d’outils dédié à la prévention des risques professionnels et du respect des obligations légales en matière de santé et de sécurité au travail. Par exemple, 63% des sondés déclarent avoir au sein de leur entreprise un responsable SST (Service de Santé au Travail), contre 23% qui affirment n’avoir aucun personnel dédié.
Alors qu’avec les ordonnances Macron, les compétences du CHSCT deviendront celles du CSE, le manque de moyen actuel que révèle cette étude inquiète pour l’avenir. Faute d’une négociation de mise en place digne de ce nom, le CSE pourra se retrouver de fait avec des moyens moindres que ceux qu’a le CHSCT.
Pour en savoir plus sur l’étude : http://www.wk-rh.fr/actualites/upload/Barometre-SST.pdf
Depuis le 25 mai 2018, le nouveau règlement sur la protection des données est applicable dans tous les pays de l’union européenne.
Dans la mesure où les CE/CSE, voire également les syndicats disposent de nombreuses données personnelles sur les salariés (identité, date de naissance, coordonnées bancaires, adresse, téléphone, mail, composition familiale, revenus, nature des prestations préférées...), ils sont soumis à ces nouvelles règles.
Le RGPD prévoit notamment (en fonction de la taille de la structure et de la récurrence d’utilisation de ces données) :
Les exigences du RGPD sont nombreuses, et peuvent sembler complexes.
ATLANTES vous accompagne
Pour en savoir plus : Plume de l’alouette, mai 2018 « Dossier spécial : RGPD quand la date approche ».
Dans deux arrêts récents, marquant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a défini la masse salariale brute servant d’assiette de calcul aux subventions CE, comme « constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ».
La Chambre sociale a précisé qu’il s’agissait d’un retour à une « définition sociale de la rémunération », la masse salariale brute correspondant ainsi aux sommes déclarées chaque année par les employeurs dans le cadre de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) ou de la déclaration sociale nominative (DSN).
La Cour de cassation précise, en outre, que doivent bien être exclues de l’assiette :
– Les provisions sur congés payés.
– Les indemnités légales et conventionnelles de licenciement et les indemnités de retraite.
– Les rémunérations versées aux salariés mis à disposition par une entreprise extérieure.
– Les sommes issues de l’intéressement et de la participation.
Ces charges n’ont en effet pas la nature de rémunération et ne figurent pas en tant que telles dans la DADS ou la DSN. En abandonnant toute référence au compte 641 « rémunérations du personnel » du plan comptable général, la Cour de cassation opère ainsi un revirement de jurisprudence et anticipe sur les évolutions issues de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 (Ord. no 2017-1386, 22 sept. 2017, JO 23 sept.), en adoptant la même définition de la masse salariale brute que celle retenue pour le calcul des budgets du comité social et économique.
Cass. soc., 7 février 2018, n°16-16086 et Cass. soc., 7 février 2018,16-24231
Les budgets sont-ils désormais fongibles ?
Anne-Lise Massard : Non. Le CSE dispose toujours de deux budgets distincts, un pour les activités sociales et culturelles, à destination des salariés, et un budget de fonctionnement. En vertu du principe de séparation des budgets, il sera toujours interdit d’utiliser le budget de fonctionnement en lieu et place du budget social et inversement.
Quel est, alors, l’assouplissement prévu par les ordonnances ?
A-LM : L’ordonnance met fin à l’imperméabilité des budgets en permettant au CSE d’opérer un transfert de l’excédent annuel de son budget de fonctionnement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles et vice versa. Cette décision doit être prise par une délibération à la majorité des titulaires. Il s’agit donc d’une décision facultative pour les CSE. À noter que cette règle n’a vocation à s’appliquer que pour les CSE. Tant que l’entreprise est dotée d’un CE, ce dernier ne peut se prévaloir de cette disposition.
Existe-t-il des limites au transfert des budgets ?
A-LM : Oui. Le transfert sera possible de l’un vers l’autre des budgets mais pour le seul reliquat annuel (le résultat de l’exercice donc, pas les réserves). Le transfert du budget social vers le budget de fonctionnement est plafonné à 10% de l’excédent annuel de ce budget. La loi de ratification des Ordonnances Macron, non encore publiée à l’heure de notre bouclage, prévoit que le transfert de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles sera également limité, mais dans des conditions fixées par décret. Il précisera la part du résultat qu’il sera possible de transférer.
En effet, la réforme du Code du travail a entrepris de fusionner le comité d’entreprise (CE), les délégués du personnel (DP) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), en une instance unique du dialogue social, le conseil social et économique (CSE).
Le CSE devra être mis en place dans les entreprises au plus tard au 31 décembre 2019.
Le Ministère a fait le choix de répondre aux questions les plus courantes des acteurs de l’entreprise sur le droit nouveau, en les répartissant en 9 thématiques : Période transitoire, mise en place du comité social et économique, composition, élections, mandats, statut protecteur, missions, fonctionnement, conseil d’entreprise.
S’il apporte des précisions sur la mise en place du CSE et bien qu’émanant du Ministère du Travail, ce document est informatif et est dépourvu de toute valeur normative.
100 Questions/Réponses sur le CSE : https://bit.ly/2rqFYma
Avant la réforme, le juge estimait déjà que les marchés d’expertise des IRP (CE et CHSCT) étaient par nature non soumis au droit de la commande publique, et ainsi non soumis aux règles de mise en concurrence. Cette position se fondait sur le fait que les marchés d’expertise étaient des marchés de service non prioritaire dispensé des formalités de passation. Avec l’abandon par l’ordonnance de la distinction marché prioritaire/non prioritaire, la Cour a dû modifier son raisonnement, tout en gardant cette solution.
Désormais, elle estime que les contrats d’expertises des IRP échappent aux règles de la commande publique, non pas en raison de la nature de ces contrats, mais en raison de la nature juridique des IRP.
En effet, par deux arrêts du 28 mars 2018 et du 4 avril 2018 (Cass. Soc., 28 mars 2018, n°16-29.106 ; Cass. Soc., 04 avril 2018, n°18-70.002), la Cour considère que le CE et le CHSCT des établissements publics ne relèvent pas de la catégorie des « personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général au sens de l’article 10 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 », quand bien même il exerce sa mission au sein d’une personne morale de droit public.
Il n’est ainsi plus nécessaire de rechercher la nature juridique du contrat en cause pour déterminer l’application ou non des règles de la commande publique, mais simplement de se référer à la nature juridique même de l’entité contractante.
Pour rappel, l’article L.4614-12 du Code du travail permet au CHSCT de se faire assister d’un expert en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Mais qu’est-ce qu’un « projet important » ?
L’appréciation de cette notion s’effectue au cas par cas, et la jurisprudence a pu donner des exemples de ce qui constitue ou ne constitue pas un projet important. Cet arrêt vient alimenter cette jurisprudence et cette dernière est susceptible, à notre sens, de s’appliquer aux futurs CSE.
En l’espèce, une entreprise a introduit auprès de ses chargés de clientèle et d’affaire un nouveau programme informatique dont le but était de répondre automatiquement à des questions formulées en langage naturel.
Le CHSCT de l’entreprise a alors demandé par délibération une expertise : selon l’instance, le logiciel en question ouvrait la possibilité d’une réorganisation des missions des salariés, et par conséquent d’une modification notable des conditions de travail. L’employeur a saisi le TGI d’une demande en référé d’annulation, qu’il a obtenu.
La Cour de cassation confirme l’annulation de la délibération du CHSCT, considérant que le logiciel allait modifier de manière accessoire les conditions de travail directes des salariés : le logiciel allait surtout « faciliter » les tâches des salariés.
Elle en déduit ainsi qu’en l’espèce, il n’est pas démontré de l’existence d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés.
Depuis la publication des ordonnances (23 septembre 2017), des modifications et précisions importantes ont été apportées.
Vous trouverez ci-dessous le calendrier de mise en place du CSE, à jour de la loi de ratification des ordonnances du 29 mars 2018.
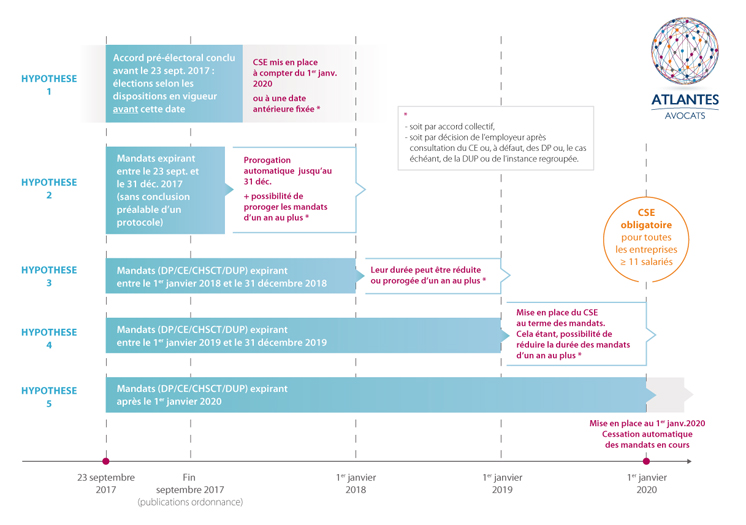
Liste des 11 décrets qui ont fait l’objet d’une publication au Journal Officiel pendant le mois de décembre
Rédigée par le Cabinet d’Avocats Atlantes, cette nouvelle édition 2017 est à jour des dernières nouveautés. S’articulant autour d’éléments à la fois théoriques et pratiques, ce Guide répond aux questions auxquelles les élus sont confrontés au quotidien, afin que chacun d’eux soit en capacité d’exercer utilement son mandat.
La loi du 8 août 2016 (loi El Khomri), a introduit un délai de 15 jours de contestation de l’expertise CHSCT, à compter de la délibération du CHSCTdécidant du recours à l’expert (contestation de la nécessité de l’expertise du CHSCT, de la désignation de l’expert, du coût prévisionnel, de l’étendue ou du délai de l’expertise).
L’actualité du droit du travail et de ses évolutions… du bout des doigts.
En savoir plus